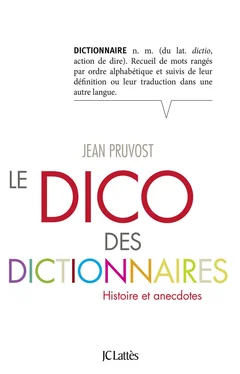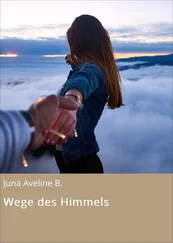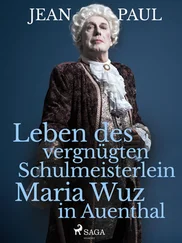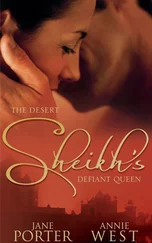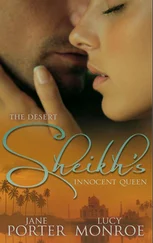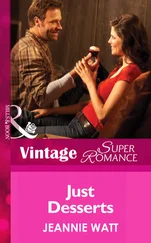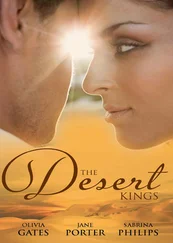Et lorsqu’on l’offre dans une chronique, aux élèves, aux étudiants, aux amis, cette pépite scintille un peu plus, elle fait rêver et incite à plonger dans ces mêmes eaux. Rien n’est plus gratifiant qu’un sourire ou un remerciement pour le moment de rêverie cristalline et fragile, offert autour d’un mot d’hier, en somme ressuscité l’espace d’un instant.
Et de se souvenir du taste-poule ? C’était celui qui allait bien gentiment, à la mode du benêt, « tâter les poules », pour savoir si elles pondaient. Une robertine ? vous dites qu’il s’agissait de la thèse passée à la Sorbonne ? Robert Sorbon, le fondateur de l’Université ! Le mistigouri ? vous n’osez pas me dire ce que c’est ? Ou d’une formule mise en scène, qui résonne encore, cristalline : les oreilles se tendent, les yeux brillent. Être tout étourdi du bateau ? Ça se disait ? Les femmes au bain-marie étaient donc des femmes insipides, sans saveur ? C’est le chemin de Villejuif, long boyau … on disait cela ? Pour tout ce qui était très allongé. Furetière l’explique ?
Ce ne sont assurément que des mots, avec leur saveur, mais, en vérité, quand tout inquiète autour de nous, l’attitude consistant à faire vibrer les mots, à les offrir en bouquets aromatisés en relâchant leur saveur cachée, c’est jouer à la fois le maître queux et le troubadour de la langue : le temps d’une chronique de langue, d’une anecdote lexicographique, n’est pas du temps perdu. Il repose, rassérène et peut-être même reconstruit. Et pendant qu’on raconte le mot, la personne se libère agréablement, s’éloignent les tensions.
Retour aux fiches : le vérificateur !
Au-delà des pierres précieuses dénichées, aux hasards des plongées dans les grands fonds des recueils océaniques de mots, raconter l’histoire d’un genre aussi particulier que celui représenté par les dictionnaires nous installe très vite dans un rôle imprévu : celui du vérificateur d’informations. Une sorte d’inspecteur « lexico ».
60 000 mots annoncés : vrai ou faux ? Qui va les compter ? 20 000 illustrations. Il paraît assurément très impressionnant, le Dictionnaire français illustré concocté par Bertet Dupiney de Vorepierre, deux gros volumes publiés en 1863, lorsque son éditeur affiche sur la page de titre : « 20 000 figures gravées sur acier par les meilleurs artistes. » Si on en reste là, il fera figure d’ouvrage novateur et d’une richesse inégalée. Cependant, même sans être inspecteur tatillon de dictionnaire, un ouvrage qui ne comporte que 2 700 pages et pour lequel sont annoncées 20 000 illustrations suppose que l’on puisse bénéficier d’environ huit illustrations par page. Patatras ! Monsieur de Nevers ! Emportés par leur enthousiasme commercial, les éditeurs ont tout simplement ajouté un zéro fautif. À l’inspecteur « lexico » de faire son rapport aux étudiants…
Dans le même esprit de vérification scrupuleuse, au détour d’un Larousse acquis en brocante, Larousse destiné à des élèves de collège, ce fut une bien plaisante surprise que de voir biffé rageusement, au gros crayon bleu d’autrefois, le nombre de mots annoncés, 30 000 mots en l’occurrence. Sans doute un élève s’ennuyant ferme au fond de la classe ou bien un adulte quelque peu grognon et suspicieux avait-il tout recompté, puisque sous le chiffre contesté, pour bien appuyer sa revendication, le dicopathe avait écrit, en gros : « Faux : 28 943. » Je n’ai pas eu le courage de vérifier s’il y en avait bien 28 943, mais voilà qui de fait est d’un côté légitime et de l’autre ridicule. Il faut savoir arrondir, mais après tout un mot est un mot !
Compter des fiches, compter les mots, radiographier un dictionnaire tout en gardant la capacité d’éveil et d’émerveillement, c’est une assez bonne école. Un constat s’impose : les très bons dictionnaires sont le fait de personnes connaissant bien leur histoire, ayant longuement arpenté ceux du passé. Deux grands lexicographes du siècle, Alain Rey et Bernard Quemada, sont d’excellents historiens du sujet. Le premier se passionna pour Littré et Furetière, le second pour la naissance des dictionnaires et leur développement jusqu’au milieu du XIX esiècle. Pour le second, ce n’est pas un mystère, il le racontait dans ses cours, avant de devenir un grand maître du sujet, son appartement était envahi de boîtes à chaussures. Avec des fiches. Et des encoches dans les fiches. Et des aiguilles à tricoter pour les séparer en fonction des thèmes. On ne s’étonnera pas qu’il fut le pionnier des fiches perforées puis de l’informatisation des dictionnaires ! « Il faut bien avoir rien à faire ! »
Dites-nous, lequel ?
Deux questions naturelles et répétitives sont sans cesse posées aux lexicographes et aux lexicologues. Quel est votre dictionnaire préféré ? Quel est le meilleur ?
Ce seraient évidemment des livres entiers qui s’imposeraient pour y répondre finement. Celui dans lequel j’essaie d’y faire écho le moins lapidairement est probablement celui qui, édité chez Ophrys, eut le prix de l’Académie française. L’obtenir sans l’avoir programmé en 2007 rime avec énorme joie : les appréciations académiques ne laissent pas indifférent.
Pour revenir à la question : quel dictionnaire choisir au milieu de milliers de dictionnaires qui nous scrutent, dès qu’on se déplace dans l’appartement qui en est tapissé ? C’est qu’ils sont impressionnants, tous là en train d’observer leur gardien, attendant impatiemment qu’on les consulte, qu’on leur rende visite. On les imagine aisément ricanant lorsque la consultation est indigne… Il faut préciser que ces compagnons de papier ont coûté cher en mètres carrés et mètres linéaires, ils ont en effet longtemps hululé la nuit, sur leurs étagères, pour se plaindre de ne pas avoir suffisamment de place, d’être trop serrés, de vivre même pour certains, les plus révoltés et les plus petits, cette suprême infamie consistant à avoir été installés sur deux rangées de la même étagère.
Aussi, dès que la voisine s’en fut allée, bien qu’elle soit une fort aimable dicophile, tout l’inverse de ma compagne de chemin de fer, ce fut une belle occasion : cette zone de respiration pour dictionnaires esquichés — « Régionalisme : comprimés, pressés, serrés, tassés » — fut immédiatement louée. Ils étaient bien sûr prêts à annexer un espace si proche, et ce fut une résurrection pour ceux qui vivaient au cachot, dans une cave très saine, mais si triste, avec un insurmontable sentiment d’abandon pour des ouvrages qui ne méritaient aucunement pareille obscurité.
Aussi, droit devant les étagères, en les regardant bien en face, impossible d’exprimer un point de vue. Oseriez-vous demander à une mère quel enfant elle préfère ? En leur présence ?
Un tout petit, en peau de porc
Alors que répondre ? Il y en a pourtant un petit, un râleur, qui m’a souvent accompagné et qui à ce titre a bénéficié d’un espace plus large de séduction que tous les autres enfants sagement rangés sur leur étagère, tous impatients d’être tripotés, caressés, aérés.
Il s’agit de l’ Essai d’un Dictionnaire universel , d’un format minuscule pour nos premiers dictionnaires, un in-dix-huit, bien proche d’un in-vingt-quatre, « Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des Arts, spécifiez dans la page suivante ». Imprimé à Amsterdam en XDCLXXXV, 1685. In-dix-huit, « où les feuilles [imprimées] sont pliées en dix-huit feuillets (ou trente-six pages) » « Recueilli et Compilé par Messire Antoine Furetière. » Repérons au passage qu’il n’était pas méprisable de compiler.
Читать дальше