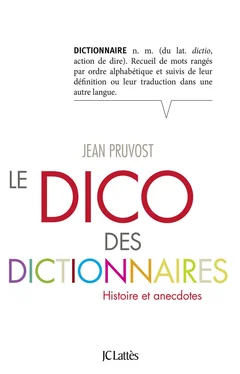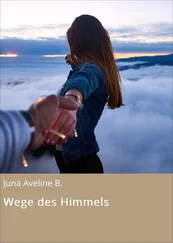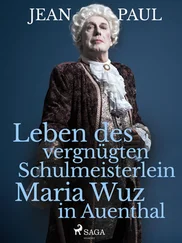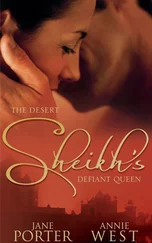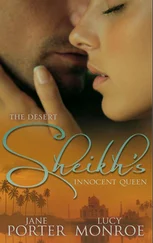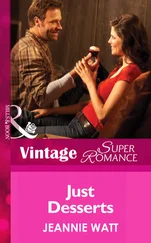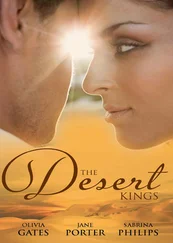Il y a des moments où, dans la traque quotidienne des mots au cœur de sa bibliothèque, pour une chronique sollicitée, on ressent l’émotion du chasseur de photographies qui, au détour d’une forêt arpentée depuis des jours et des jours, se trouve nez à nez avec le aye-aye, la grenouille poilue ou encore le crabe yéti…
Belle exaltation que celle ressentie en découvrant en effet un phénomène non répertorié, par exemple, par le Trésor de la langue française du CNRS ou par les étymologistes de tout poil ! C’est alors Nimbus découvrant une autre planète, un cyclone dans la tête du dicopathe. Et justement à propos de cyclone…
Un fléau venait de sévir au sud des États-Unis, il fallait mieux le définir, et retrouver d’où venait ce mot. Premier constat : l’absence du mot cyclone dans les tout premiers dictionnaires. Le réflexe est constant, il faut consulter un gros dictionnaire du XIX esiècle, en particulier le Grand Dictionnaire universel du XIX esiècle du prolixe Pierre Larousse, pour ne pas errer d’un petit dictionnaire à l’autre, et bénéficier tout de suite de pistes perceptibles dans la forêt d’informations qu’il apporte, en compilateur et boulimique dénicheur qu’il fut. Dès les premiers mots de la définition proposée, l’attention était éveillée :
« Cyclone : … féminin. Sorte d’ouragan qui marche en tournoyant avec une extrême rapidité, dans le sud de l’océan Indien » , écrit Pierre Larousse en 1866 dans son monumental dictionnaire. À la lecture des premiers mots, on ne peut qu’immédiatement repérer la marque du genre : « féminin ». La cyclone donc !
En vérité, impossible de trouver une définition avant la seconde moitié du XIX esiècle, le mot venait en effet tout juste d’être emprunté à la langue anglaise, tout en le féminisant. On situe d’ailleurs précisément sa date de naissance, 1848, au moment où H. Piddington a besoin d’un terme pour désigner toutes perturbations atmosphériques dans lesquelles le vent suit un mouvement circulaire. Construite sur le grec kuklos , cercle, « la » cyclone entre ainsi sans tarder, en 1878, dans le Dictionnaire de l’Académie française , avec cependant cette remarque préfigurant son prochain changement de genre : « Quelques-uns le font masculin » …
Fait rarissime, grâce à ce terme transsexuel, on assiste à une tempête dans le crâne d’un lexicographe, celui immense d’Émile Littré. Voici ce que le bon médecin et l’excellent étymologiste déclare effectivement, en remarque, dans le Dictionnaire de la langue française en cours de publication : « Au moment où s’imprimait le [volume] C [1863] de ce Dictionnaire, cyclone était généralement fait féminin, dans les livres scientifiques ; on était sans doute déterminé par la finale qui semble féminine ; je lui donnais donc ce genre. Depuis, l’usage a varié, les météorologistes l’ont fait masculin, j’ai suivi la variation et changé sur les clichés, en masculin, le féminin ; de là la discordance entre les différents tirages. » On ne peut se trouver plus en direct avec la vie de la langue !
Et là soudain, on est récompensé de ses chasses en brocantes et autres lieux qui vous font disposer de plusieurs Littré , tout simplement acquis parce qu’il vous a semblé qu’il y avait une différence de présentation matérielle, une reliure distincte, entre celui repéré sur l’étal d’un brocanteur et celui déjà installé sur vos étagères. Il n’est pas cher, à tout hasard on l’achète. C’est une folie, avec pour alibi l’idée qu’on pourra le prêter à un étudiant, ou le ranger dans la bibliothèque du laboratoire CNRS, parce que, en principe, Littré est censé n’avoir donné qu’une édition de son Dictionnaire de la langue française , restée inchangée pendant soixante-quinze ans, le temps de tomber dans le domaine public. Tout cela, au passage, parce que la fille de Littré, Sophie, refusait qu’on touche à l’œuvre de son père, ne serait-ce que pour la mettre à jour.
Donc, aux yeux de tous et aux miens : une seule édition du Dictionnaire de la langue française de Littré et point besoin d’en avoir différents exemplaires. C’est cependant oublier que le dictionnaire, comme presque tous les dictionnaires en plusieurs volumes dont la publication s’effectue sur une dizaine d’années, du premier au dernier volume, permet en fin de parcours de corriger une erreur qui se serait glissée dans un volume déjà paru, au moment où l’on édite d’un bloc l’ensemble.
C’est ce qui s’était en fait passé pour Littré, entre le fascicule envoyé aux abonnés et insérant pour la première fois le mot cyclone, puis le premier volume y correspondant, et le moment enfin où les quatre volumes sont publiés et vendus ensemble dans une édition finale. Littré avait ainsi eu le temps, pour très peu de mots certes, d’insérer un rectificatif. Or, ces modifications étant rarissimes et nulle part répertoriées, seul le chasseur fou de mots et de dictionnaires, car il faut être bien déraisonnable pour disposer de deux ou trois Littré, peut au détour d’un bosquet de mots photographier l’anomalie, le crabe-yéti qui s’était caché dans un article. Révélateur de la mutation. Et le nimbus d’être ému d’avoir ainsi vécu en direct les états d’âme lexicologiques de Littré. Raconter cela ensuite à Jean-Marc, qui tient Le Beaujolais, un café tout à côté de l’endroit où l’on va enregistrer une chronique de langue, remet évidemment les choses à leur place : on lit dans son regard à la fois de la sympathie et une certaine compassion amusée pour celui qui se passionne pour si peu de choses !
Pour en revenir au cyclone, une fois épinglé comme un papillon chez Littré, on consulte d’autres dictionnaires, entre autres le Trésor de la langue française riche de ses 450 000 citations, et on ne peut s’empêcher d’en cueillir une, comme une belle fleur au coin d’une forêt dense. Ce qui permettra de conclure la chronique demandée en rappelant que, dans la réalité, le seul cyclone sympathique reste celui décrit par Colette dans Claudine à l’école (1900), lorsque Monmond « passe, avec une brutalité de cyclone, emportant sa danseuse comme un paquet », car il a parié un « siau de vin blanc » qu’il ferait « la longueur de la salle en six pas de galop ». Il y réussit, le voilà admiré, mais hélas la danseuse est furieuse ! Pas la moindre tendresse en effet dans un cyclone, quel qu’il soit.
DICTIONNAIRE s. m. Livre qui contient les mots d’une langue, d’un art, ou d’une science par ordre alphabétique. Un bon dictionnaire est tres-dificile à faire .
Pierre Richelet, Dictionnaire françois, 1680.
DAYE DANDAYE : C’est un mot qu’on peut dire de l’invention de M. Scarron, puisqu’il ne se trouve en aucun autre auteur. Il s’en sert pour se moquer et a la même signification que la relanlère , à d’autres, zest ou tarare . Je ne dis que daye dandaye .
Le Roux, Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, 1718.
Le troupier français est débrouillard .
Exemple du Petit Larousse 1905, Article débrouillard.
Sans religion, une date !
Cela a déjà été dit : au moment même de la naissance de ma première fille, je venais de dénicher le Dictionnaire universel de Furetière, la toute première édition de ce dictionnaire datant de 1690. La mienne datait de 1702. J’ai donc longtemps pensé que je bénéficiais du Furetière, ce qui était forcément exact, mais d’une certaine façon seulement : je ne disposais que du Furetière de 1702.
Читать дальше