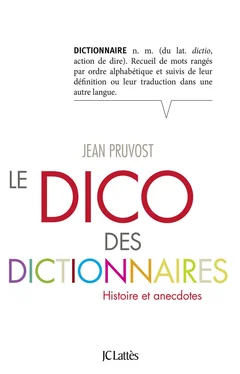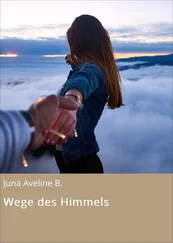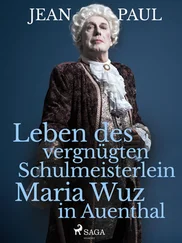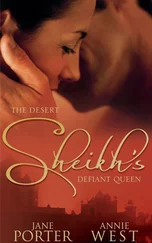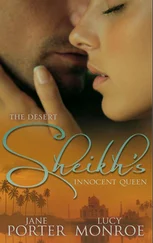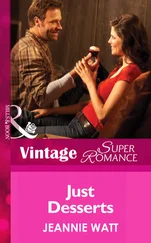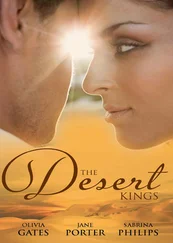Au XVIII esiècle, lorsque, au cœur de De la philosophie de la nature (1769), Delisle de Sales déclare peu aimablement de son personnage féminin que « son dictionnaire sans doute est fort stérile », c’est de son « vocabulaire » très limité qu’il est question. Attention à ne pas faire disparaître le dictionnaire, dans ce sens ancien, « vocabulaire » propre à quelqu’un. Ainsi Charles Bonnet, dans les Contemplations de la nature (1704), nous en prévient. Que déclare-t-il en effet dans la douzième partie de son ouvrage ? « Comme l’on a accordé de l’intelligence aux bêtes, il s’en faut de peu qu’on ne leur ait accordé aussi la parole, et qu’on n’ait entrepris de nous donner leur dictionnaire »…
Dictionnairique,
Dictionnariste
Dictionnairique : adj. Qui concerne le dictionnaire.
Première entrée du mot
dictionnairique dans le
Petit Larousse illustré 1989
Laids comme tout !
Qu’ils sont laids ces mots ! Comment avez-vous pu les adopter ? C’est une mésalliance. On aurait pu l’éviter. Pourtant, je ne peux pas m’en passer. On trouvera ces mots dans les colonnes du Petit Robert ou du Petit Larousse illustré . Si dictionnairique et dictionnariste existent dans les dictionnaires, c’est donc au moins qu’ils existent… selon la mauvaise formule qui laisserait penser que les mots qui ne sont pas dans les dictionnaires n’auraient aucune existence.
Le dictionnariste
Dictionnariste : auteur de dictionnaire.
Dictionnaire de Trévoux, 1732.
Tout d’abord, si ce qui date d’assez longtemps réduit le sentiment d’agacement contre ce qui est perçu comme un modernisme inélégant, il faut alors d’emblée rappeler que le dictionnariste ne date pas du XX esiècle. La première trace qu’on a effectivement dudit mot date de 1694. Le dictionnariste est ainsi attesté dans Les Pensées critiques, historiques et morales de M. de Valois dans lequel il désigne la personne élaborant un dictionnaire. Le dictionnaire était alors en effet de la dernière mode, du dernier cri, en tant qu’outil d’information pour tous ceux qui savaient lire. Aussi, sur le mot dictionnaire en pleine vogue pouvait-on facilement forger le dictionnariste . Ce néologisme entrait dans la troisième édition du Dictionnaire de Trévoux , en 1732, avec une définition pour le moins sobre : « Auteur de dictionnaire. » En fait, le mot lexicographe , peu transparent, prendra rapidement le relais en termes savants, mais il ne sera attesté dans un dictionnaire qu’en 1762, dans la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française .
Le dictionnariste semble avoir été de mise auprès des jésuites qui l’ont intégré en même temps qu’ils offraient avec le Dictionnaire de Trévoux un grand dictionnaire encyclopédique.
Au passage, qui trouve laids aujourd’hui les mots paratonnerre, actualité, vacancier ? C’était pourtant à boulets rouges, au moment de leur apparition dans la langue française — en 1779 pour le premier ; au milieu du XIX esiècle pour le deuxième ; dans son sens journalistique, en 1925 pour le dernier —, que les amateurs du beau langage tiraient sur ces nouveaux venus. Il ne fait pas toujours bon être nouveau-né pour un mot dont la figure ne revient pas d’emblée…
Première interrogation
Qui s’interrogera sur le mot dictionnariste ? L’abbé Jean-François Féraud, soucieux de pédagogie et auteur du Dictionaire critique de la langue française , publié en 1787, à peine deux ans avant la Révolution française, dans une orthographe révolutionnaire, avec en l’occurrence un seul n au dictionaire .
Quel point de vue exprime l’abbé Féraud sur le sujet : « Dictionariste . s. m. Auteur de Dictionaire. Ce mot est dans le Trévoux. […] On dit, depuis quelque temps, Lexicographe ; mais ce mot est trop savant, et ne se dit que parmi les Gens de Lettres. Il semble que Dictionariste serait plus propre pour le discours ordinaire ; mais l’usage ne l’a pas adopté. »
L’usage courant ne lui a pas fait place en effet, ce qui ne signifie pas qu’il ait disparu, il en va ainsi de certains mots qui traversent les siècles sans être sur le devant de la scène, en s’abritant dans les niches réservées aux mots spécialisés. Il faut se souvenir par exemple que la formule qui peut en faire frémir quelques-uns, « ordre dictionnairique », tout en restant une combinaison rare, demeurait toujours en vigueur pour désigner tout ce qui était présenté dans l’ordre alphabétique, c’est-à-dire dans « l’ordre du dictionnaire », comme en témoigne encore, en 1843, le « Tarif par ordre dictionnairique des droits d’enregistrement des greffes … » de Despréaux. On sera d’accord pour admettre que les droits d’enregistrement n’ont rien de bien plaisant…
La résurrection et l’effet cravate…
Mal aimés, dictionnairique et dictionnariste ont donc, nonobstant cet ostracisme, résisté au temps. Comme ces arbres rabougris qui grandissent, se développent, sans jamais être l’objet de beaucoup d’attention. Si dictionnariste et dictionnairique connaissent même dans leur niche spécialisée une vigueur particulière à la fin du XX esiècle, c’est qu’en réalité, tout rabougris qu’ils étaient, ils se sont révélés indispensables pour la majorité des linguistes.
Soulignons-le au passage, les mots ne sont pas soumis au vieillissement des cellules, ils peuvent être oubliés, mais ils restent toujours prêts à un nouvel envol.
Pour bien comprendre ce qu’est la dictionnairique , on passera par l’ effet cravate … Cette formule m’est venue lors d’un cours pour expliquer la différence entre la lexicographie , étude objective, sans limite, d’un ensemble de mots, et la dictionnairique incluant les contraintes d’un objet à fabriquer, le dictionnaire. Non, ne quittez pas la lecture : vous rateriez un effet, celui de la cravate disparue.
Cette formulation née spontanément autour de la cravate venait à point pour dévoiler un tour de passe-passe couramment pratiqué dans les dictionnaires, et dont personne ne prend conscience, à part les professionnels qui se gardent bien de l’expliquer pour ne pas casser le mythe. Chaque année dans mon université est donc explicité l’ effet cravate auprès de ceux qui viennent s’initier aux secrets de fabrication de nos dictionnaires, or, symptôme d’une formule peut-être heureuse, il n’est pas rare qu’on m’écrive ensuite du fin fond de la planète lexicographique pour me demander où trouver la trace écrite de cet effet cravate . À dire vrai, je crois bien ne l’avoir jamais publié… Ce sera donc chose faite.
Pour bien saisir l’effet en question, en guise de première étape, il faut tout d’abord imaginer une page du Petit Larousse , du Dictionnaire encyclopédique Hachette ou du Quillet , ou encore du Petit Robert des noms propres . On l’aura compris, il faut avoir en main un dictionnaire encyclopédique, doté d’illustrations, pour que l’ effet cravate prenne toute sa dimension.
Il convient ensuite d’examiner une série de l’un de ces dictionnaires millésimés, donc modifiés chaque année, de 1980 à 2000 par exemple. C’est évidemment ici la chance des maisons d’édition, car à part les dicopathes qui ? qui, pouvant se dire sensé, dispose d’un mur de plus de trente Hachette ou de cent Petit Larousse illustré ?
Читать дальше