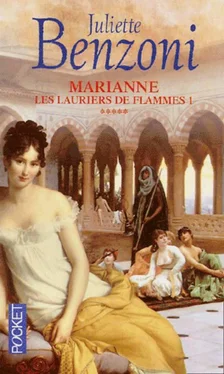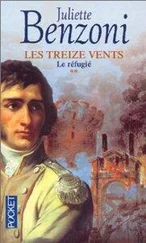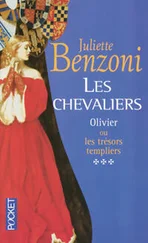Juliette Benzoni
Les lauriers de flammes (1 èrepartie)
Le caïque doré, emporté par la fougue de ses vingt-quatre rameurs, volait littéralement sur les eaux calmes de la Corne d'Or. Devant son étrave, les autres embarcations se dispersaient comme des poules affolées, dans la crainte de gêner le canot impérial.
Assise à l'arrière, sous un tendelet de soie rouge, la princesse Sant'Anna regardait se rapprocher les sombres murs du Sérail, cependant que la nuit, lentement, commençait à prendre possession de Constantinople. Dans un moment, elle l'envelopperait de cette ombre où se perdaient déjà les rues étroites encaissées entre les maisons de Stamboul.
A mesure que l'on avançait, d'ailleurs, les barques se faisaient rares car, après le coup de canon qui marquait le coucher du soleil, il était interdit de traverser la Corne d'Or. Mais, naturellement, cette interdiction n'était pas valable pour les bateaux du palais.
Dans la robe de cour, en satin vert feuille, qu'elle avait revêtue, un peu au hasard, en vue de la circonstance qui l'attendait, Marianne transpirait. Ces premiers jours de septembre gardaient toute la chaleur humide de l'été. Depuis une semaine, la ville trempait dans une sorte de bain de vapeur dont les brumes jaunâtres estompaient les contours des monuments et rendaient pénible le port de tout vêtement un peu lourd. A plus forte raison, celui d'un fabuleux métrage d'épaisse soierie lyonnaise renforcé par de longs gants de peau montant jusqu'au ras des courtes manches ballons.
Mais, dans un laps de temps indéterminé, quelques instants peut-être, la jeune femme se trouverait enfin en présence de la souveraine qu'elle était venue, sur l'ordre secret de Napoléon et au prix de tant de peines, chercher ainsi aux confins de l'Europe. Qu'allait-il advenir de la mission dont elle était chargée et dont l'importance semblait peser un peu plus lourdement sur ses épaules à chacun des coups de rames de l'équipage ? Obtenir que la guerre, engagée entre la Sublime Porte et la Russie depuis des années pour la possession des principautés danubiennes[1] se poursuivît assez longtemps pour retenir au nord des Balkans une grande partie de l'armée russe, tandis que l'empereur des Français franchirait la frontière de l'empire tsariste et marcherait sur Moscou... Cela lui paraissait maintenant terrifiant, impossible ! D'autant plus que, depuis son arrivée à Constantinople, elle n'avait pas été sans apprendre que, sur le Danube, les choses allaient très mal pour l'armée turque. Et l'entrevue qui se préparait, même voilée sous l'aspect rassurant d'une visite familiale, lui semblait singulièrement épineuse...
Comment la sultane réagirait-elle quand elle s'apercevrait que cette lointaine cousine voyageant sur ses terres « pour son plaisir », et si désireuse de la rencontrer, portait en fait des lettres de créance et venait lui parler politique ? Mais, au fond, était-elle dupe ? Trop de gens étaient au courant de ce voyage qui aurait dû être gardé secret : les Anglais d'abord, qui avaient su, le Diable seul savait comment, que Napoléon avait envoyé une « ambassadrice occulte ». Mais grâce à Dieu, tout le monde ignorait quelle pouvait être la nature exacte de sa mission.
Il y avait maintenant quinze jours que Marianne attendait une audience que l'on ne semblait guère pressé de lui accorder. Quinze jours que, fuyant la frégate anglaise où l'on prétendait la retenir prisonnière pour la ramener au pays de son enfance comme otage de guerre, elle était arrivée à l'ambassade de France, évanouie et véhiculée sur l'épaule d'un rebelle grec notoire, comme un vulgaire sac de farine. Un rebelle qui, après l'avoir tirée des griffes anglaises, l'avait tout bonnement sauvée du désespoir et qui maintenant était son ami.
Elle avait vécu ces deux semaines enfermée dans le « palais » de France, tournant en rond comme une bête en cage, malgré les exhortations à la patience que lui prodiguait son ami Jolival. L'ambassadeur, comte de Latour-Maubourg, préférait, en effet, qu'elle ne quittât pas l'enceinte protectrice de ce minuscule territoire français, parce que, depuis le malheureux divorce de l'empereur Napoléon, ses compatriotes n'étaient plus aussi bien vus des Ottomans que dans un passé encore récent.
Les sympathies du Sultan Mahmoud II et de sa mère, une créole, cousine de l'impératrice Joséphine, jadis enlevée par les pirates barbaresques et portée par sa beauté au rang suprême de Sultane Haseki, se tournaient maintenant vers l'Angleterre dont le séduisant représentant, Stratford Canning, ne reculait devant rien quand il s'agissait des intérêts de son pays.
— Tant que la Sultane Mère ne vous aura pas reçue, insistait Latour-Maubourg, il vaut mieux éviter tout risque inutile. Canning fera n'importe quoi pour empêcher cette entrevue qui l'inquiète. Les moyens qu'il a employés contre vous démontrent clairement combien il vous craint. N'êtes-vous pas cousine de Sa Hautesse ?
— Cousine à un degré fort mince !
— Cousine tout de même, puisque c'est à ce titre que nous espérons vous voir reçue. Croyez-moi, Madame, restez ici jusqu'à ce que l'audience vous soit accordée. Cette maison, je le sais, est surveillée, mais Canning n'osera rien tenter tant que vous demeurerez à l'intérieur. Alors que, si vous sortiez, il est tout à fait capable de vous faire enlever.
Ces conseils, vigoureusement appuyés par un Joli-val trop content d'avoir récupéré sa « fille adoptive » pour risquer de la reperdre aussitôt, ces conseils, donc, étant ceux-là mêmes de la sagesse, Marianne s'y était pliée. Pendant des heures, rongeant son frein et espérant la bienheureuse convocation, elle avait arpenté tantôt sa chambre, tantôt le jardin de l'ambassade. Celle-ci, un ancien couvent franciscain du XVI esiècle et l'une des plus vieilles demeures de Péra, possédait un charmant cloître que l'on avait converti en jardin. Malgré l'absence de femme – diplomate à l'ancienne mode et fils de la sévère Bretagne, Latour-Maubourg n'avait pas jugé convenable de faire venir femme et enfants en terre infidèle – l'ambassadeur avait donné à ce jardin, comme à ses vieux bâtiments, une élégance toute française, à laquelle Marianne était sensible et qui lui adoucissait les rigueurs de la captivité.
Outre Arcadius de Jolival, Marianne y avait également retrouvé son cocher, Gracchus-Hannibal Pioche, l'ex-commissionnaire de la rue Montorgueil. En revoyant saine et sauve une patronne qu'il croyait bien au fond de la Méditerranée, le brave garçon, fondant en larmes, était tombé à genoux puis, ce fils de la Révolution athéiste avait remercié le Ciel à mains jointes avec une ferveur que lui eût enviée un chouan. Après quoi il avait fêté l'événement en compagnie du cuisinier de l'ambassadeur et de quelques bouteilles de raki, bombance dont il avait pensé mourir.
En revanche, Marianne n'avait pas retrouvé sa femme de chambre. Agathe Pinsart avait disparu. Pas très loin, d'ailleurs, et sans qu'il y eût pour cela la moindre tragédie. Contrairement à ce que l'on pouvait craindre, la pauvre fille avait parfaitement résisté au traitement, aussi barbare que répugnant, auquel Leighton et ses mutins l'avaient soumise à bord de la Sorcière. En revanche, son charme acidulé avait subjugué le reis qui, en s'emparant du brick, avait libéré les prisonniers. Et comme, pour sa part, Agathe avait été profondément impressionnée par la prestance, les vêtements de soie et les superbes moustaches du jeune capitaine turc, le voyage vers Constantinople avait revêtu, pour ces deux-là, l'aspect réconfortant d'un long duo d'amour au terme duquel Achmet avait offert à sa douce amie de l'épouser. Persuadée de ne jamais revoir Marianne en ce bas monde et, d'ailleurs, fort tentée par la vie douillette des dames turques, Agathe n'avait résisté que pour la forme et pour donner plus de prix à son accord. Et, quelques jours avant l'arrivée de sa maîtresse, elle avait, avec enthousiasme, embrassé l'Islam, embrassé aussi Achmet et, avec tout le cérémonial requis, fait son entrée dans la belle maison que son époux possédait à Eyoub, auprès de la grande mosquée fraîchement reconstruite par Mahmoud II, pour abriter l'empreinte du pied du Prophète.
Читать дальше