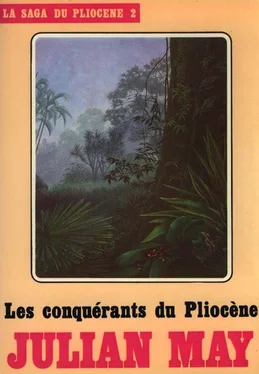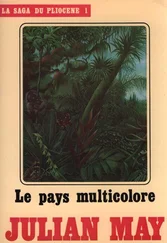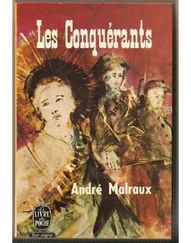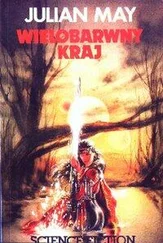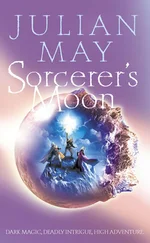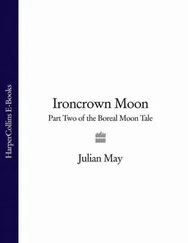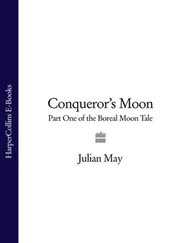— Il faut partir, dit Felice. Il fait assez sombre, à présent. Il faut que nous ayons franchi le fleuve avant que la lune ne se montre au-dessus des montagnes.
— Avec Richard, dit Claude, vous allez aider Martha à descendre.
Il tendit la main à Angélique Guderian. Ensemble, ils atteignirent le pied de l’arbre et marchèrent vers la berge.
La Forêt Noire de la Terre Future était une région entièrement aménagée. De loin, les étendues de pins et de sapins formaient une vaste couverture sombre mais, durant le vingt-deuxième siècle, la forêt était devenue verte, plaisante et douce, avec des sentiers bien entretenus qui n’attiraient que les plus paresseux des marcheurs, ceux qui aimaient la flânerie mais redoutaient les inconvénients de la nature. Ce n’est qu’au sud du massif, autour du Feldberg et des pics voisins que l’altitude dépassait mille mètres. Au vingt-deuxième siècle, le Schwarzwald avait été littéralement truffé de châteaux restaurés, de stations fantasques, de Kurhäuser et de villages montagnards peuplés d’habitants costumés toujours prêts à accueillir les touristes des autres mondes et à les gaver de Kirschtorten.
Au Pliocène, la Forêt Noire, c’était autre chose.
Longtemps avant que ne commence l’érosion des grands glaciers du Pléistocène, le massif était plus haut et plus rude. En face du rift de la vallée du proto-Rhin se dressait un escarpement qui devait culminer à mille cinq cents mètres, coupé de gorges où coulaient des torrents venus des hauteurs. Ceux qui arrivaient du fleuve devaient escalader ces crevasses en suivant les pistes abruptes ou en se hissant à la force des mains entre les blocs de granité couverts d’une mousse qui restait humide au plus fort de l’été, baignée en permanence par les embruns des cascades. On disait que les plus robustes des Firvulag avaient franchi l’escarpement qui barrait la route aux voyageurs en huit heures. Pour madame Guderian et ses compagnons, cela prit trois jours.
Au-dessus du horst oriental, la Forêt Noire commençait vraiment. Près du fleuve, là où des vents puissants soufflaient à travers l’auge des Alpes, les sapins et les épicéas avaient pris des formes grotesques. Certains arbres évoquaient des dragons à l’affût, des pythons lovés, ou bien encore des géants humanoïdes à jamais figés dans l’agonie, leurs plus hautes branches formant un véritable toit sylvestre à plus de trente mètres du sol.
Plus loin à l’est, la Forêt Tordue se transformait, ses formes changeaient et les branches redevenaient normales. Le Schwarzwald du sud s’élevait peu à peu pour atteindre quelque deux mille mètres de haut, avec trois éminences. Sur le versant ouest, le voyageurs rencontrèrent des sapins argentés et des épicéas de Norvège aux proportions gigantesques, hauts de soixante-dix mètres parfois, si denses que les arbres morts n’avaient pas la place de tomber et se desséchaient lentement entre leurs voisins avant de tomber en miettes. Les clairières étaient rares et Richard ne pouvait que rarement faire le point sur l’Etoile Polaire ou le soleil. Il n’existait plus aucune piste visible et l’ex-navigateur spatial dut en tracer une, entre des points de repère fragiles, jamais espacés de plus de quinze ou vingt mètres à cause de la densité de la végétation.
Le soleil pénétrait à peine dans les sous-bois. Les plantes vertes étaient rares dans la sinistre pénombre bleutée. Les saprophytes nourris par la décomposition des grands arbres régnaient en maîtres. Certaines de ces choses qui se repaissaient de la décomposition était des plantes à fleur dégénérées, avec de longues tiges livides qui portaient des boutons fantomatiques et blêmes, terreux, jaunâtres ou bien translucides et tachetés de roux. Mais c’était avant tout les champignons et les lichens qui se nourrissaient de la mort des grands conifères. Pour les cinq voyageurs humains qui traversaient cette forêt du Pliocène, ils constituaient la forme dominante de vie.
Ils cheminaient entre des feuilles tremblotantes et transparentes, ou bien orange et blanches, des écharpes de gelée qui rampaient sur le tapis d’épines et l’écorce pourrissante comme de grandes amibes. Il y avait des champignons en touffes, des plus petits, roses, pareils à des oreilles de bébés, aux plus grands qui montaient parmi les troncs comme des escaliers et qui pouvaient supporter le poids d’un homme. Il y avait des masses spongieuses ocellées de noir et de blanc qui couvraient des centaines de mètres carrés comme pour dissimuler d’innommables atrocités. Il y avait des filaments aériens, pourpres, écarlates ou ivoire, qui pendaient des branches mortes comme de longues dentelles trouées. La forêt abritait des globes gélatineux de plus de trois mètres de diamètre, et d’autres qui n’étaient pas plus grands que des perles. Une variété de champignon recouvrait des choses putréfiées qui s’érigeaient en cloques évoquant un popcorn multicolore. Des organes obscènes apparaissaient un peu partout, semblables à des cancers, à des rangées d’éventails, à des tranches de viande encore saignante, à des étoiles d’ébène, à des phallus mauves et suintants, à des parasols gonflés, à des saucisses velues. Et les champignons à chapeau, en forme de parapluie ou de massue, proliféraient de toutes parts.
Avec la nuit, ils devenaient phosphorescents.
Au bout de huit jours, les voyageurs eurent franchi la Forêt des Champignons. Pendant tout ce temps, ils n’avaient pas aperçu un animal qui fût plus grand qu’un insecte. Mais jamais ils n’avaient perdu l’impression que des observateurs invisibles les guettaient. Madame Guderian n’avait pas cessé de les rassurer. Cette région, malgré son apparence sinistre, était sûre. Dans le royaume de mort et de vie des fongus, il n’existait aucune proie pour les prédateurs, encore moins de ressource pour les Firvulag, qui étaient un peuple de chasseurs avides. L’épaisse couverture végétale les mettait à l’abri de la Chasse Volante. Les quelques groupes de Moins-que-rien qui s’étaient déjà aventurés dans de telles forêts, plus au nord, avaient rapporté qu’elles étaient désertes, que seuls les habitaient les champignons, les mousses et les parasites.
Mais la sensation ne les quittait pas.
Ils continuaient à progresser dans les profondeurs affreuses des bois, ils souffraient et ahanaient en pataugeant dans les fondrières qui cachaient des pièges redoutables et humides. Richard, à un moment, déclara qu’il étouffait à cause des spores. Martha s’abîma dans un silence absolu après avoir invectivé madame Guderian à propos d’une chose invisible qu’elle avait vu ramper sous les grands champignons. Claude fut pris d’une terrible démangeaison aux testicules qui lui gagna bientôt les aisselles. Même Felice finit par se plaindre à haute voix : elle était certaine que quelque chose lui poussait dans les oreilles.
En sortant enfin de la Forêt des Champignons, ils poussèrent tous un profond soupir. Ils se trouvaient en haut d’une prairie alpine ensoleillée qui s’étendait au nord et au sud, sur le versant d’une crête ondulée. A leur gauche se dressait un pic dénudé et, à leur droite, deux grands dômes gris culminaient. Loin devant eux, à l’est, apparaissait la masse ronde du Feldberg.
— Le ciel bleu ! L’herbe verte ! s’exclama Martha.
Oubliant son handicap, elle s’élança devant les autres et escalada la pente vers l’est.
— Eh ! Il y a un petit lac, là en bas ! A moins d’un kilomètre ! Et plein de jolis arbres bien normaux ! Je crois que je ne vais pas tarder à me baigner et à me nettoyer à fond. Ensuite, je me ferai griller sous le soleil. Et qu’on ne me montre plus jamais un champignon !
Читать дальше