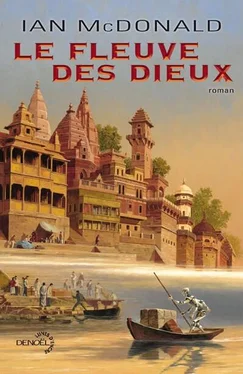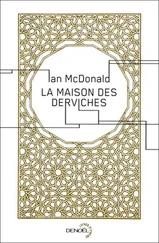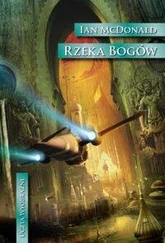Son palmeur vibrait, message sur message sur message. Elle ne voulait pas les voir. Elle ne voulait même par regarder derrière elle, de peur qu’il l’ait suivie. Elle traverse l’esplanade jusqu’à la route. Des taxis. Il doit toujours y avoir des taxis, un jour de match. Elle s’immobilise sur les fissures au bord de la chaussée, lève son ombrelle. Des phut-phuts et des taxis de la ville passent sans s’arrêter. Où allez-vous, qui conduisez-vous à ce moment de la journée ? Ne voyez-vous pas qu’une dame vous hèle ?
Quelqu’un qui veut être une dame. Qui n’en a jamais été une. Qui ne pourra jamais en être une.
Un taxi-motocylette traverse la circulation en direction du trottoir. Le chauffeur est un jeune homme aux dents proéminentes, avec un vague duvet en guise de moustache.
« Pârvati ! » crie une voix dans son dos. C’est pire que la mort. Elle grimpe à l’arrière et le chauffeur accélère, passe devant l’homme aux yeux écarquillés de stupéfaction vêtu d’un pantalon noir et d’une chemise immaculée bien repassés. Tremblant de honte, souhaitant mourir, Pârvati regagne son appartement, où elle trouve les portes déverrouillées et sa mère campée dans la cuisine avec ses bagages.
Le barrage est une longue courbe basse de terre passée au bulldozer, immense comme un horizon, aux extrémités invisibles l’une de l’autre, ancrée dans les paisibles contours de la vallée du Gangâ. L’appareil à réacteurs basculants de l’armée de l’air bhâratîe approche de Kundâ Khâdar par l’est. Il survole à basse altitude les javâns qui le saluent de la main et tourne au-dessus du lac, serré de trop près, au goût de Shahîn Badûr Khan, par les hélicoptères d’assaut aeais. Ceux-ci volent comme des oiseaux, osant par instinct et par incarnation des manœuvres inaccessibles aux pilotes humains. L’ARB vire sur l’aile, les appareils-aeais plongent d’un coup pour le couvrir, et Shahîn Badûr Khan pose les yeux sur une large étendue d’eau peu profonde que tachent les algues, entourée à perte de vue par du gravier sale et sablonneux, aussi blanc et toxique que du sel. Une fosse limoneuse à laquelle même une vache refuserait de s’abreuver. De l’autre côté de l’allée, Sajida Rânâ secoue la tête. « Magnifique », murmure-t-elle.
Si seulement ils avaient écouté, songe Shahîn Badûr Khan, si seulement ils ne s’étaient pas précipités pour envoyer les soldats, la tête pleine de Jaï Bhârat ! Le peuple veut une guerre , avait affirmé Sajida Rânâ pendant le Conseil des ministres. Le peuple en aurait une, maintenant.
L’appareil gouvernemental se pose sur un terrain aménagé à la hâte en bordure d’un village, à dix kilomètres du barrage côté bhâratî. Les hélicoptères-aeais tournent au-dessus de lui comme des oiseaux de proie au-dessus d’une tour du silence. La force d’occupation a établi là ses quartiers généraux de division. Des unités mécanisées creusent des tranchées vers l’est, des robots sèment un champ de mines. En costume de ville, Shahîn Badûr Khan qui cligne des yeux dans la lumière crue malgré ses lunettes de soleil de marque voit les villageois debout au bord de leurs champs réquisitionnés et dévastés par l’armée. Vêtue quant à elle d’un treillis sur mesure, Sajida Rânâ avance déjà d’un pas décidé vers V.S. Chaudhuri, les officiers et les gardes alignés en comité d’accueil. Elle veut être la pin-up numéro un sur les murs des baraquements, Mâmâ Bhârat, avec Nina Chandra. Les officiers saluent la Première ministre et son principal conseiller d’un namasté, puis les escortent dans la poussière jusqu’aux hummers. Sajida Rânâ s’y rend à grandes enjambées, le ministre Chaudhuri trottant pour s’efforcer de rester à sa hauteur afin de lui communiquer quelques informations. Un petit chien-chien en train de japper, songe Shahîn Badûr Khan. Au moment de monter dans l’étouffant compartiment passager du hummer, il jette un coup d’œil par-dessus son épaule à l’ARB, juché sur ses roues et ses moteurs comme s’il craignait une contamination. Le pilote semble une tique à visière noire enfoncée dans la tête de l’appareil. Sous le museau recouvert de senseurs, le long canon automatique évoque le rostre d’un insecte tirant sa subsistance des fluides d’un autre. Un tueur raffiné.
Shahîn Badûr Khan revoit la boîte de nuit aux bananes, le sourire de la vieille aveugle identifiant ses invités à leurs phéromones, les sombres alcôves où les voix se mélangent et rient, où les corps se détendent l’un dans l’autre. La magnifique créature étrangère sortant doucement de l’obscurité et du rythme des dhôls comme une danseuse de nâch.
Le hummer sent le désodorisant Arbre Magique. Shahîn Badûr Khan se déplie en clignant des yeux dans la lumière réfléchie par le béton de la chaussée. Ils sont sur la route qui passe au sommet du barrage. Cela empeste la terre morte et l’eau stagnante. Il préférerait presque l’Arbre Magique. De la buse du déversoir s’écoule un mince filet d’eau pisseuse. C’est Mère Gangâ.
Les javâns se précipitent pour former une garde d’honneur. Shahîn Badûr Khan remarque les robots à missiles antiaériens et les regards nerveux qu’échangent les officiers subalternes. Dix heures plus tôt, c’était la République awadhîe et les soldats portaient des tenues caméléon identiques, mais avec le triple symbole vert, blanc et orange du yin et du yang. Ils sont largement à portée de mortier de ces villages fantômes révélés dans leur nudité architecturale par la baisse du niveau de l’eau. Ou même d’un simple tireur isolé. Sajida Rânâ avance à nouveau à grands pas, ses brodequins façonnés à la main cliquetant sur la route. Les troupes sont rassemblées en formation de l’autre côté de l’estrade. Quelqu’un teste la sonorisation, produisant une série d’effets Larsen. Quand ils repèrent la Première ministre en treillis, les cameramen des chaînes d’informations se ruent dans sa direction. La police militaire sort ses lâthîs pour les repousser. Shahîn Badûr Khan attend au pied des marches que la Première ministre, le ministre de la Défense et le commandant de division montent sur l’estrade. Il sait ce que va dire Sajida Rânâ. Il y a mis lui-même la dernière touche dans la matinée à bord de la limousine qui les conduisait à l’aéroport militaire. Le bruissement collectif d’hommes rassemblés sous un soleil de plomb disparaît quand ils voient leur commandante en chef prendre le micro. Shahîn Badûr Khan hoche la tête de plaisir muet en constatant qu’elle garde le silence.
« Jaï Bhârat ! »
Ce n’était pas prévu. Le cœur de Shahîn Badûr Khan se fige dans sa gorge. Les hommes le savent aussi. Le silence dure un instant, puis explose. Deux mille voix éructent la réponse. Jaï Bhârat ! Sajida Rânâ renouvelle à deux reprises son cri, obtenant chaque fois le même répons, puis prononce son discours. Pas pour les soldats debout au repos sur le barrage ou penchés sur leurs armes dans les transports de troupes blindés. Mais pour les caméras, les micros, les rédacteurs des réseaux d’informations. Avons cherché une résolution pacifique. Bhârat pas une nation assoiffée de guerre. Tigresse réveillée. Rentre ses griffes. Espoir de solution diplomatique. Paix négociée dans l’honneur encore possible. Noble proposition à nos ennemis. L’eau aurait toujours dû être partagée. Pas pour une seule nation. Gangâ notre artère vitale commune.
Les soldats ne bougent pas. Ne remuent pas. Leur arme pesante à la main, dans leur tenue de combat et l’énorme chaleur, ils écoutent ce discours en poussant des acclamations aux moments où il le faut, en se taisant quand Sajida Rânâ les calme des yeux et des mains, et quand elle les laisse sur une chute meurtrière : « Et pour finir, je vous apporte un nouveau grand triomphe. Messieurs, le Bhârat a marqué 387 pour 7 ! », ils explosent de joie et se mettent à psalmodier Jaï Bhârat ! Jaï Bhârat ! Sajida Rânâ reçoit leurs applaudissements et redescend de l’estrade avant qu’ils faiblissent.
Читать дальше