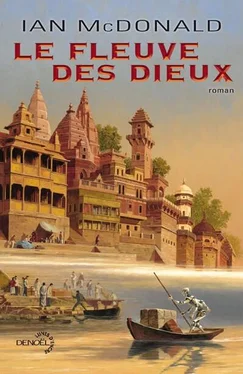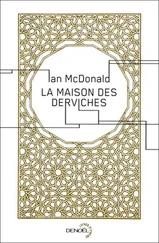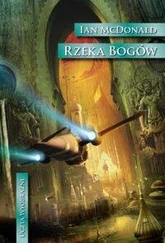« Qu’est-ce qui vous prend ? C’est du désherbant.
— Il faut que ça disparaisse, que tout disparaisse. » Pârvati s’éloigne, semant de la poudre blanche sur les plates-bandes et les pots de géraniums trempés. Krishân va pour lui saisir la main, mais elle lui jette la poudre au visage. Il recule en titubant. Des éclairs illuminent l’ouest, il profite de leur lumière pour lui agripper le poignet.
« Je ne comprends pas ! crie-t-il. Vous m’appelez en pleine nuit, venez, vous me dites, il faut que je vous voie tout de suite. Il y a la loi martiale, ici, Pârvati. Des soldats dans les rues. Ils tirent sur n’importe quoi… J’ai vu. Non, je ne veux pas vous dire ce que j’ai vu. Mais je suis venu, et je vous trouve assise dans la pluie, avec ça…» Il lève la main de Pârvati. La pluie a délayé le désherbant en traînées blanches, négatif d’une main teinte au henné. Il lui secoue le poignet pour essayer d’introduire un peu de rationalité dans ce morceau du monde qu’il peut comprendre. « Qu’est-ce qu’il y a ?
— Il faut que ça disparaisse. » Elle s’exprime d’une voix atone, puérile. « Tout doit disparaître. Mon mari et moi, on s’est disputés, et vous savez quoi ? Ce n’était pas horrible. Oh, il criait, mais je n’avais pas peur parce que ses paroles n’avaient aucun sens. Vous comprenez ? Toutes ses raisons, je les ai entendues et elles n’avaient aucun sens. Et donc il faut que je parte, maintenant. Que je parte d’ici. Il n’y a rien, ici. Que je parte loin d’ici, loin de Vârânacî et de tout. »
Krishân s’assied sur le rebord en bois d’une plate-bande surélevée. Un tourbillon dans le microclimat apporte une poussée de colère de la ville.
« Partir ? »
Pârvati serre ses mains entre les siennes.
« Oui ! C’est si facile. Quitter Vârânacî, quitter le Bhârat, partir. Il a chassé ma mère, vous le saviez ? Elle est quelque part dans un hôtel, elle appelle, elle appelle, elle n’arrête pas d’appeler, mais je sais ce qu’elle va me dire : je ne suis pas en sécurité ici, comment peux-tu m’abandonner au milieu d’une ville dangereuse, il faut que tu viennes me sauver, me ramener. Je ne sais même pas dans quel hôtel elle est, vous imaginez ? » Pârvati rejette la tête en arrière et lance son rire vers la pluie. « Il n’y a rien pour moi là-bas à Kotkhaï et rien pour moi ici à Vârânacî, non, je ne pourrais jamais faire partie de ce monde, je m’en suis aperçue au match de cricket, quand elles ont toutes ri. Où puis-je aller ? Rien que partout, vous voyez, c’est si facile quand on pense n’avoir nulle part où aller, parce que n’importe où devient alors possible pour vous. Mumbaï. On pourrait aller à Mumbaï. Ou au Karnataka… ou au Kerala, on pourrait aller au Kerala, oh, j’adorerais aller là-bas, les palmiers, la mer, l’eau. J’adorerais voir la mer. J’adorerais découvrir son odeur. Vous ne voyez pas ? C’est une chance, que tout sombre dans la folie autour de nous, au milieu de tout ça, nous pouvons filer sans que personne ne s’en aperçoive. M. Nanda me croira partie à Kotkhaï avec ma mère, ma mère me croira toujours à la maison, mais on n’y sera pas, Krishân. On n’y sera pas ! »
Krishân sent à peine la pluie. Il veut plus que tout éloigner Pârvati de ce jardin mourant, la faire sortir de là, descendre dans la rue et ne jamais se retourner. Mais il ne peut pas accepter ce qui lui est offert. Il n’est qu’un modeste jardinier de banlieue qui s’est établi dans une pièce de la maison de ses parents et possède une petite camionnette à trois roues ainsi qu’une boîte à outils, un modeste jardinier qu’une femme magnifique vivant dans une tour a appelé un jour pour qu’il lui construise un jardin dans le ciel. Un jardinier qui a donc construit le jardin sur le toit pour la femme magnifique et solitaire dont les meilleurs amis vivaient dans des fictions, et qui ce faisant était tombé amoureux d’elle, pourtant mariée à un homme puissant. Et voilà qu’au milieu d’une grande tempête, elle lui demande de s’enfuir avec elle dans un autre pays pour qu’ils vivent heureux jusqu’à la fin de leurs jours. C’est trop grand, trop soudain. Trop simple. C’est Town and Country.
« Et pour l’argent ? Sans compter qu’on aura besoin de passeports pour sortir du Bhârat. Vous en avez un ? Moi, non, comment en obtenir un ? Et qu’est-ce qu’on fera une fois là-bas, de quoi vivrons-nous ?
— On trouvera un moyen », et par ces quatre mots, Pârvati Nanda ouvre la nuit pour Krishân. Il n’y a pas de règles pour les relations, pas de plans pour aménager, planter, alimenter, tailler des jardins. Un foyer, un emploi, une profession, de l’argent. Peut-être même un bébé brâhmane.
« Oui, dit-il. Oui. »
Un instant, il croit qu’elle n’a pas compris ou pas entendu, car elle ne bouge pas, ne réagit pas. Krishân prend dans le sac de désherbant deux poignées de poudre blanche qu’il jette en l’air dans la mousson, en une fontaine toxique.
« Qu’il disparaisse ! crie-t-il. Il y a d’autres jardins à faire pousser. »
Sur le dos de l’éléphant géant qui vole trois mille mètres au-dessus du Sikkim et des contreforts de l’Himâlaya, N.K. Jîvanjî adresse un namasté à Nadja Askarzadah. Il est assis sur un musnud traditionnel, un trône de traversins et de coussins sur une simple dalle de marbre noir. Derrière le bastingage de cuivre, des sommets enneigés luisent dans le soleil de l’après-midi. Pas de brume, de smog, de nuage brun d’Asie, pas de mousson obscure.
« Madame Askarzadah, mes excuses les plus sincères pour le vilain tour de passe-passe, mais j’ai pensé préférable d’adopter une forme qui vous semble familière. »
Nadja sent sur sa peau des vents de haute altitude et sous ses pieds le pont en bois de l’éléphant-aéronef qui dérive dans les courants aériens. Elle est là tout entière. Elle s’installe jambes croisées sur un coussin à glands. Elle se demande si c’est un de ceux de Tal.
« Pourquoi, quelle forme prenez-vous en général ? »
N.K. Jîvanjî écarte les mains.
« N’importe laquelle. Toutes et aucune. Je ne dis pas cela pour être gnomique, c’est la réalité.
— Alors lequel êtes-vous, N.K. Jîvanjî ou Lâl Darfan ? »
N.K. Jîvanjî incline la tête comme pour s’excuser de l’affront.
« Ah, vous voyez, vous recommencez, madame Askarzadah. Les deux et ni l’un ni l’autre. Je suis Lâl Darfan. Je suis Aparna Chaula et Ajaï Nadiadwala… Vous ne vous doutez pas à quel point je suis impatient de m’épouser moi-même. Je suis chacun des personnages secondaires et mineurs, chacun des figurants et chemises rouges. Je suis Town and Country. N.K. Jîvanjî est un rôle dans lequel je semble être tombé… à moins qu’il me soit tombé dessus ? C’est un visage authentique que j’ai emprunté… Je sais que vous devez toujours avoir le corps.
— Je pense que je comprends cette devinette. » Nadja Askarzadah remue les orteils dans ses super-baskets. « Vous êtes une aeai. »
N.K. Jîvanjî bat les mains de ravissement.
« Ce que vous appelleriez une aeai de Génération Trois. C’est exact.
— Entendons-nous bien. Vous me dites que Town and Country, rien de moins que le programme télévisé le plus populaire en Inde, est un être intelligent ?
— Ayant interviewé ma manifestation Lâl Darfan, vous avez une idée de la complexité de cette production, sauf que vous n’avez même pas entrevu le sommet de l’iceberg. Town and Country est bien plus grand qu’Indiapendent, bien plus grand même que le Bhârat. Town and Country est réparti sur plus d’un million d’ordinateurs dans tous les recoins de l’Inde, de Kannyâkumâri jusqu’au pied de l’Himâlaya. » Il affiche un sourire fourbe. « À Vârânacî, à Delhi et à Hyderâbâd, il y a des sundarbans dont la seule occupation consiste à faire fonctionner des acteurs aeais rayés du scénario, au cas où ils réapparaîtraient un jour dans l’intrigue. Nous sommes partout. Nous sommes légion.
Читать дальше