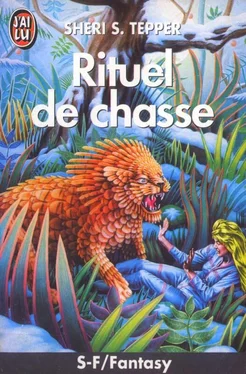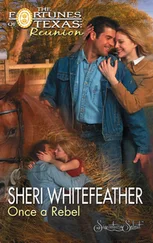— Que célébrons-nous ? demanda-t-il.
— Marthamay est enceinte.
— À la bonne heure ! Ce n’est pas trop tôt. Elle doit être soulagée.
— Pas vraiment, figure-toi. Il lui suffisait d’être une femme et une épouse, si ce n’était pas sa lassitude d’entendre ses sœurs lui seriner qu’une union sans enfant n’était pas concevable.
— Alverd va devoir prendre la pelle et la truelle du maçon.
— Ce surcroît de travail ne l’enchante guère, surtout en ce moment.
Kinny avait un appétit délicat ; elle piqua un peu de chou du bout de sa fourchette et ne put s’empêcher de sourire, imaginant l’infortuné Alverd Bee, grand échalas impétueux, en train de creuser les fondations de la nouvelle chambre, comme c’était l’usage avant la naissance du premier enfant. Dans une semaine se dérouleraient les élections municipales, et le futur papa avait toutes les chances d’être élu maire. Bah ! Les hommes de la famille lui donneraient un coup de main, en souvenir de l’aide qu’il leur avait apportée dans les mêmes circonstances.
— Parle-moi des nouveaux hôtes de Opal Hill, dit-elle soudain. À quoi ressemblent-ils ?
Roald lui fit le récit de ses différentes entrevues, dans l’ordre, sans omettre les mèches folles et la lumière, « nacrée comme l’intérieur d’un coquillage ».
Kinny fit entendre un claquement de langue apitoyé.
— Pauvre Lady Westriding.
Son époux acquiesça d’un triste hochement de tête.
— N’est-ce pas ? Une femme séduisante, pourtant, mais d’une beauté froide, qui ne doit pas s’émouvoir facilement. Avec elle, il faut se donner un peu de mal.
— Notre ambassadeur, sans doute, n’est pas homme à s’accommoder de ces lenteurs ? Il a le sang chaud, il aime brûler les étapes ?
Kinny avait mis dans le mille, comme d’habitude. Brûler les étapes, ce devait être le péché mignon de Roderigo Yrarier. Or les obstacles sont insupportables pour l’impatient ; gare à ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues ! Cette fois, le Terrien au tempérament fougueux aurait affaire à forte partie. Il pourrait bien lui en cuire, s’il ne mettait pas un peu d’eau dans son vin. Roald chassa ces pensées pessimistes.
— Marthamay a-t-elle dit comment ils comptaient appeler l’enfant ?
Deux jours plus tard, l’homme chargé d’enseigner à Lady Westriding le « sabir de la Prairie » se présenta à Opal Hill sous le nom de Persun Pollut. Le professeur et son élève s’installèrent dans le bureau non encore aménagé de la maîtresse de maison. Autour d’eux, les ouvriers vaquaient à leurs occupations. Marjorie confessa qu’elle n’avait encore jamais habité de demeure coupée en deux, dans laquelle on déménageait du rez-de-chaussée à l’étage au gré des saisons.
— Nos hivers sont interminables, il faut le reconnaître, soupira Persun Pollut en fronçant d’admirables sourcils. Rien que de songer à cette épreuve, nous sommes transis. L’air devient si froid qu’il semble autour de nous comme une présence ennemie. Nous épuisons notre moral et nos forces à le braver, jour après jour. Nous vivons sous terre, à la manière des Hipparions, en regrettant de ne pouvoir tomber dans le même engourdissement. Si seulement nous pouvions dormir, nous aussi, jusqu’au retour du printemps !
Persun Pollut était un jeune homme aimable et neutre, avec un certain air rat de bibliothèque, le regard précis et les manières gentiment effacées. Il avait pris pension dans le village voisin, annonçant à qui voulait l’entendre qu’il avait été engagé afin de sculpter des panneaux de boiserie destinés au « boudoir de Madame l’ambassadrice ». Roald Few, décida-t-elle, avait eu la main heureuse.
— Que faites-vous donc, pour oublier le froid et passer le temps ? Une fois de plus, elle se demanda ce qu’il adviendrait des chevaux, si par malheur il devenait inévitable de passer un hiver sur cette planète rébarbative.
— Dans la Zone Franche, la vie suit son cours, presque inchangée. L’hiver est la saison des festivals, art dramatique et poésie. Un orchestre s’est constitué ; nous avons ouvert une école de chant et de danse. Quelques-uns se sont spécialisés dans le dressage des animaux, et nous donnons toutes sortes de spectacles. L’université ouvre ses portes et la plupart d’entre nous en profitent pour accumuler un savoir qui sans cette longue parenthèse leur serait demeuré inconnu. Aussi l’hiver a-t-il ses bons côtés, d’une certaine façon. Nous, les roturiers, tout en nous donnant beaucoup de mal pour n’en rien laisser paraître, nous sommes plus cultivés que les bon, vous le constaterez vous-même. Le sous-sol de notre ville est sillonné de galeries, truffé d’entrepôts et de salles de réunion. Autant dire que nous habitons au-dessus d’une éponge !
— Que font les aristocrates ? Restent-ils cloîtrés sur leurs terres ?
— Où iraient-ils ? Une centaine d’hommes et de femmes, tout au plus, vivent dans chaque domaine en compagnie de leurs domestiques. Cette vie confinée offre peu de ressources. Ils s’ennuient ; leurs traditions figées ne les prédisposent guère à tirer parti de la longue claustration imposée par le climat. Ils s’ennuient ; les passions s’exaspèrent, et les inimitiés.
Le silence s’établit entre eux, silence courtois, empreint de réserve et de discrète curiosité de part et d’autre.
— Les œuvres de bienfaisance existent-elles sur la Prairie ?
— Je vous demande pardon ?
— Des institutions charitables dont le but serait de prêter assistance aux plus démunis. Nulle lueur d’entendement ne s’alluma dans le regard de Persun Pollut. Marjorie se souvint d’une expression chère à Rigo. Que faites-vous des veuves et des orphelins ? demanda-t-elle.
Le jeune homme comprenait de moins en moins.
— Les veuves, ce n’est pas ce qui manque, et nous avons même quelques orphelins, mais pourquoi devrions-nous les confier à des institutions ? Chez les roturiers, quand une personne se trouve dans le besoin, son entourage ou sa famille en prend soin le plus naturellement du monde, pour des raisons de simple bon sens où la charité n’intervient pas. Le soulagement des malheureux serait-il l’une de vos occupations favorites ?
Marjorie fit signe que oui, d’une certaine façon, en essayant de ne pas sourire et de ne pas grincer des dents. Oui, elle avait passé beaucoup de temps à se « montrer charitable » envers les malheureux. En pure perte, semblait-il. D’ailleurs, lorsqu’elle avait annoncé son départ, personne n’avait jugé nécessaire de la remplacer.
— J’appréhende l’inaction des longs mois d’hiver, dit-elle, comme si cela fournissait une explication à sa question saugrenue. Le désœuvrement encourage la mélancolie.
— Certains trouvent à s’occuper ; ils en viennent même à redouter le retour à l’activité normale. Les aristocrates ont un proverbe : Prin g’los dem aufnet haudermach. Que l’on pourrait traduire par : « L’intimité de l’hiver se dissout au printemps. » Ou bien : « Les liaisons nouées en hiver ne résistent pas aux beaux jours. » Un Terrien emploierait plus volontiers le mot « mariage ». Voyons… « Le printemps desserre les liens des mariages hivernaux. »
Marjorie acquiesça.
— Vous avez raison, dit-elle avec gravité. Avec ce mot-là, votre phrase sonne beaucoup plus vrai. Comment avez-vous été amené à apprendre le dialecte diplomatique ?
— Mais tout le monde le parle ! Tous les habitants de la Zone Franche. Notre spatioport est très actif, dans les deux sens. Nous sommes devenus la plaque tournante du système. À longueur d’année, pour le besoin de nos échanges, nous communiquons avec d’autres mondes, nous envoyons des messages, nous en recevons. Nous parlons la langue des diplomates et celle du négoce, le semla et bien d’autres dialectes. Nous sommes tous polyglottes. Les aristocrates de la Prairie ont forgé un idiome obscur et peu malléable, plus proche d’un code à usage interne que d’un véritable véhicule de la pensée. Je vous l’enseignerai de mon mieux, mais préparez-vous à découvrir le système linguistique le plus rudimentaire et le plus farfelu.
Читать дальше