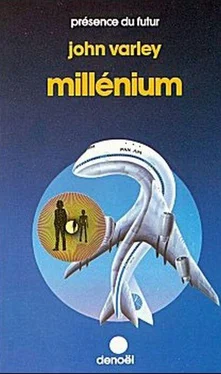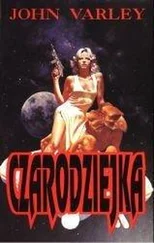La B semblait la moins prometteuse. L’éventualité la plus probable, durant ce laps de temps, était l’audition des bandes de la boîte noire du 747. Je supposai que j’y retournerais si et seulement si ma première option avait échoué puisque c’était encore celle-ci qui engendrait le minimum d’interférence.
Quant à la fenêtre C…
J’étais la seule à avoir lu le message de ma capsule temporelle et déjà même à ce stade des préparatifs, je m’étais mise à la redouter. Je ne saurais vous dire pourquoi. Je savais simplement que l’idée de retourner passer une nuit à Oakland me mettait plus que mal à l’aise. Parle-lui de la gosse. Ce n’est qu’un légume.
Non merci.
Coventry défendait l’option D. Son sentiment était qu’il fallait prendre le taureau par les cornes. Je me demandais s’il n’avait pas commencé à se prendre pour Lars, le Fendeur de crânes – homme d’action s’il en fut – plutôt que pour un historien. Et s’il professerait la même assurance au cas où ce serait à lui de remonter le temps pour affronter le paradoxe sur les lieux mêmes.
Là aussi, non merci.
Je votai pour A, en réitérant mon vote autant que faire se pouvait et en y mettant le maximum d’insistance, je finis par faire passer mon point de vue. Je décidai par la suite que l’effectif de l’expédition serait aussi réduit que possible : à savoir, une seule personne. Coventry dut admettre la sagesse de ce choix. Quand on se met à jouer avec le temps, on tâche de faire le moins de vagues possible.
Et quand on veut être sûr que le boulot sera bien fait, il n’y a qu’une seule personne au monde en qui on peut se fier.
Au rythme de deux siècles à l’heure, nous n’avions pas plus de huit jours pour plancher sur le problème. Ça ne faisait pas des masses de temps. D’un autre côté, c’était suffisant pour que je me sente obligée d’exploiter tous les avantages disponibles. Aussi, plutôt que de me ruer par la Porte vers le matin du 12 décembre pour aller bêtement fouiner parmi les décombres, je décidai de prendre le temps de parfaire mon éducation.
Ce furent dix heures bien employées :
Je les consacrai à subir un intensif bourrage de données dans les trois mémoires cybernétiques temporaires implantées dans mon cerveau. Le G.O. prit tout ce qu’il avait en stock concernant le XXe siècle jusqu’au début des années 80 et le déversa dans mes microprocesseurs cérébraux.
Je ne devrais pas me moquer des capacités mentales des natifs du XXe. Ils faisaient de leur mieux avec ce qu’ils avaient. En cinq cents siècles, le cerveau humain avait évolué quelque peu – je pouvais apprendre une langue par les méthodes conventionnelles en deux jours environ – mais il n’y avait eu guère de changement qualitatif. Une bonne comparaison pourrait être le temps mesuré pour courir le mile : à une époque, la barrière des quatre minutes avait semblé hors de portée. Plus tard, c’était devenu de la routine et les gens avaient visé les trois trente. Mais personne n’escomptait le réaliser en deux secondes pile.
Pourtant, parcourir le mile en une seconde ne constitue pas un problème avec l’aide d’un moteur à réaction.
De la même manière, apprendre à parler le swahili en une minute ou absorber le contenu d’une bibliothèque en l’espace d’une heure n’a rien d’un exploit pourvu qu’on dispose des capacités adéquates de stockage, traitement et recherche de données intégrées sous le crâne.
C’est là un outil puissant grâce auquel vous apprenez à parler une langue de manière idiomatique, comme un autochtone, tout en disposant d’un vaste contexte culturel pour vous exprimer.
Ces trois minuscules mémoires cristallines ingurgitaient encyclopédies, informations, films, émissions de télé, modes, spectacles, tendances et tout le baratin avec un égal bonheur. L’opération achevée, j’avais au bout des doigts les us et coutumes de tout un siècle. Je pourrais me sentir comme chez moi au milieu des années 80.
Comme tout outil, le cyber-ampli mental avait ses inconvénients. Il était plus à l’aise avec les langues et les données qu’avec la reconnaissance des formes. Je ne serais toujours pas capable, en regardant simplement une robe, de savoir, comme n’importe quel autochtone, si elle datait de 1968 ou de 1978. Je pouvais évoluer à travers le XXe siècle avec une raisonnable aisance. Que j’y reste assez longtemps et je soulèverais immanquablement quelque lièvre anachronique.
Mais que pouvait-il bien m’arriver en une heure ?
C’était une journée épouvantable. Il avait plu toute la nuit ; le seul point positif était que la pluie avait fini par cesser. Mais simultanément avait disparu la couverture nuageuse et, pis, les précipitations avaient nettoyé l’air de la plupart de ses parfums. Le ciel arborait un bleu monstrueux, orageux, extraterrestre et semblait distant d’un milliard de kilomètres. Le soleil était si brillant que je pouvais le regarder sans risquer d’endommager ma rétine. Ça suffisait déjà qu’il me baigne de ses radiations malsaines ; comment ces gens pouvaient-ils vivre avec un tel poids oppressant suspendu au-dessus de leur tête ? Et l’air était si clair et fade que je pouvais voir jusqu’à Marin County.
Les mots sont une drôle de chose. Je me rends compte que je viens de décrire ce qui était certainement pour un homme du XXe une matinée superbe. L’air vif, frais, vivifiant ; un soleil superbe et radieux ; si éclatant qu’on pouvait voir à l’infini.
Et moi j’étais là, haletante, me sentant toute nue sous ce ciel affreux.
Mon essoufflement tenait à quatre-vingts pour cent à l’anxiété. Pourtant, je me sentis considérablement soulagée après quelques inhalations du tube Vicks que j’avais pris soin d’emporter sur moi. N’importe qui d’autre l’aurait prisé qu’il aurait eu une désagréable surprise : les composés chimiques qu’il contenait pouvaient tuer les cafards et piquer l’inox.
La Porte m’avait crachée près du flanc est du gigantesque hangar d’acier qui servait à recevoir les restes des deux appareils. Du moins, telle avait été la théorie. En me dirigeant vers la façade métallique, je découvris les portes grandes ouvertes. À l’intérieur se trouvaient deux PSA 727 et une flopée de mécanos.
Je n’aimais pas du tout ça. Ça signifiait une rupture dans la ligne temporelle. En regardant autour de moi, pour me repérer, j’aperçus le bon hangar à quatre cents mètres de là. Le même écart dans l’autre direction m’aurait fait atterrir au beau milieu de la baie. Et bien sûr, il y avait encore une troisième direction. J’aurais fort bien pu me matérialiser quatre cents mètres au-dessus du terrain…
C’étaient quatre cents longs mètres. Je me sentais comme un pou sur une assiette. Rien que cette interminable étendue de béton encore humide de l’averse nocturne et ce ciel affreux, infini. On aurait pu croire qu’au bout de cinq siècles on aurait été capable de mettre au point une pilule contre l’agoraphobie.
L’une des premières choses que j’aperçus en entrant, ce fut deux femmes habillées exactement comme moi. C’était rassurant, ça me mettait sur un terrain familier. J’avais passé pas mal de temps à me mêler à d’autres femmes en uniforme. Je les étudiai pour voir ce qu’elles faisaient et cela se révéla merveilleusement prosaïque : les sauveteurs avaient travaillé toute la nuit, la plupart sans prendre le temps de s’arrêter pour grignoter un morceau. Aussi United avait-il dépêché quelques femmes pour servir le café et les beignets. Rien n’aurait pu mieux coller avec mon expérience. Escamoter un avion de ligne consiste pour quatre-vingt-dix-neuf pour cent à servir du café et pour un pour cent à escamoter.
Читать дальше