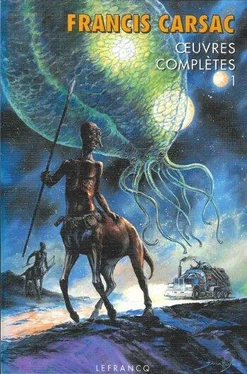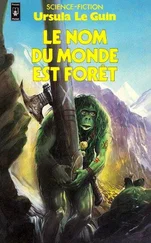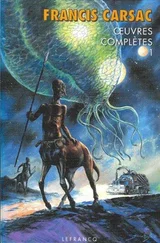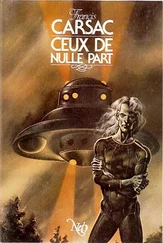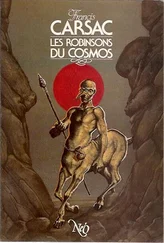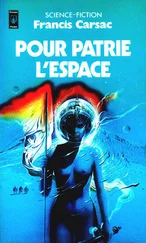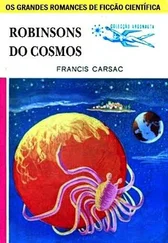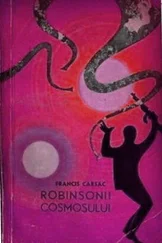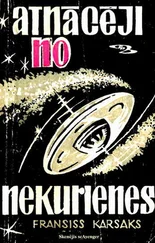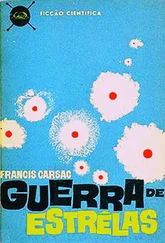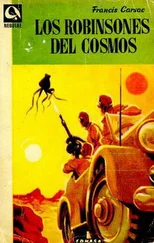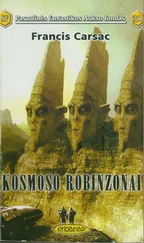Arrivant en Indochine à la fin de 1936, il vit très vite ce qu’étaient racisme, colonialisme et xénophobie, et la multiplicité des formes qu’ils peuvent prendre, des plus évidentes aux plus subtiles.
Peu après son arrivée, une scène l’a marqué profondément. Il me l’a racontée plusieurs fois{La première fois, j’avais 7 ou 8 ans, et j’étais en train de lire Le Lotus bleu d’Hergé. Les tintinophiles comprendront pourquoi.}. Il allait à la poste (à Saïgon ?). Au guichet, une courte file d’attente. Un vieil homme effectuait une opération (envoi de mandat ? de colis ? de lettre recommandée ? je ne sais). À part mon père, tout le monde était « indochinois ». Entra une femme française d’une quarantaine d’années qui, négligeant la file d’attente, se dirigea vers le guichet, bouscula le vieil homme qui manqua de tomber, qui serait tombé si quelqu’un ne l’avait retenu, et dit au préposé : « Je suis pressée, tu t’occupes de moi » ou quelque chose approchant… Le préposé protestant, elle l’injuria et exigea de nouveau qu’il le serve immédiatement. Ce qu’il fit dans un silence de mort. Mon père était horrifié, d’autant plus que la femme était l’épouse d’un fonctionnaire de la République française, qui venait apporter en Extrême Orient la civilisation européenne, et que l’homme bousculé était un vieillard et un lettré, ce qui le rendait doublement respectable…
Mais à côté de ce racisme individuel, et disons-le « stupide », il y existait surtout, à l’époque, une situation explosive et complexe, pour ne pas dire inextricable{Dans ce qui suit, je vais être, par nécessité, très — trop, beaucoup trop — superficiel . Mais sauf à écrire au moins 20 pages sur le sujet, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement . }.
En un sens, la « Guerre d’Indochine » n’a pas commencé en 1946, mais au moins 20 ans avant. Au début des années 30, l’armée française a bombardé des villages, procédé à des déportations et à des exécutions sommaires, en représailles contre des grèves. Le « Parti colonial » (le baron Nétal…) – aussi bien à Paris qu’en Indochine – voyait dans le pays une mine d’or qu’il s’agissait de ne pas laisser échapper. Si certains gouvernements de la 3 ème République avaient essayé d’introduire des réformes favorables aux « indigènes », elles furent pour la plupart sans portée réelle, étouffées sur le terrain. Certes il existait parmi les colons ceux qui étaient favorables à un développement « indigène », que ce soit pour des raisons humaines (le comte de Roan…), ou par simple bon sens. Mais ils étaient semble-t-il une minorité et de toute façon « la mèche de la bombe était déjà allumée », si je peux m’exprimer ainsi.
Mais il y avait une seconde chose que l’on oublie trop souvent : c’est que les colonisés d’alors avaient été eux-même des colonisateurs qui s’étaient emparés, par la force souvent, des terres, des « mondes », d’autres populations. Et ces colonisations, ces conquêtes, sont parfois relativement récentes. Pour ne prendre qu’un seul exemple, il y a 10 siècles, il n’y avait pas de « vietnamiens » dans l’actuel Viêt-Nam (qui en 1936 était formé du Tonkin, de l’Annam et de la Cochinchine). Et jusqu’au 15 ème siècle il n’y en avait pas dans ce qui fut un moment le Sud-Viet Nam où existait alors le royaume du Champa, de population malaisienne de langue, qui fut définitivement conquis par les « vietnamiens », venus du sud de la Chine, au 18 ème siècle. Les Cham (habitants du Champa) furent tués ou s’exilèrent, principalement au Cambodge. Mais les Cham eux-même avaient probablement chassé ou détruit d’autres populations pour s’emparer des riches régions côtières et du delta du Mékong… Et de toute façon, c’est encore plus compliqué que çà…
Habitant chez sa sœur et son beau-frère (qui était alors administrateur civil en Cochinchine), voilà ce dont François Bordes entendait parler quotidiennement quand il avait 16 ans, et ce qu’il a alors en partie vu. Il a vu aussi le mépris réciproque entre les différentes ethnies, mépris des vietnamiens envers les chinois de Cholon, et des chinois envers les vietnamiens, des vietnamiens envers la minorité khmer de Cochinchine, et des khmers envers les vietnamiens, de presque tout le monde envers les minorités des montagnes (les « moï » comme ils étaient alors appelés), des français envers les « indigènes » et des « indigènes » envers les français. Et j’ajouterai : etc.
Enfin, s’il en est besoin, le cadre de « Ce monde est nôtre », là où se trouvent les trois populations des Bérandiens, de Brins et des Vasks, est une péninsule orientée Nord-Sud, où dans les basses-terres dominent les forêts denses et les marais… et où il y a une rivière qui s’appelle la rivière Claire…
En 1978, Francis Carsac écrivait à un de ses correspondants : « … En réalité, comme je l’ai dit, le squelette de ce roman était déjà debout avant que la guerre d’Algérie ne commence, et j’avais en tête la guerre du Vietnam (première phase). Je ne connais pas l’Algérie, mais je connais le Vietnam, le Cambodge et le Laos, pays que j’aime beaucoup, et que j’ai vu avec tristesse déchirés par des guerres inutiles. De même la « brousse » dont je parle dans divers livres n’est point la brousse africaine, que j’ignore, mais celle de l’Indochine, assez différente. Je sais que les français n’ont pas la « tête asiatique » et sont plutôt tournés vers l’Afrique, c’est sans doute ce qui explique ce point de vue (que « Ce Monde est nôtre » a été inspiré par l’Algérie. G.B.). Pour moi, l’Asie m’attire davantage. »
Mais est-ce dire que « Ce monde est nôtre » a été uniquement inspiré par la situation indochinoise ?
III. La guerre des Boer
L’Indochine de 1936 a fournit à François Bordes une expérience directe, vécue, de la réalité de la colonisation et l’a inspiré quant au cadre géographique. Mais si on y regarde bien, le schéma de base de « Ce monde est nôtre » n’est pas vraiment celui de la guerre d’Indochine{Pas plus, d’ailleurs, que ne l’est celui de la guerre d’Algérie.}.
Résumons ce schéma. Sur la planète Nérat se trouvent trois populations :
— les Brins, des « indigènes » qui en définitive n’en sont pas ;
— les Vasks, des colons issus d’un petit groupe initial, ayant un mode de vie agro-pastoral et une idéologie « primitiviste » qui fonde une civilisation traditionnaliste ;
— les Bérandiens, colons venus plus nombreux, ayant une civilisation de la ville et des visées expansionnistes, qui déclenchent une guerre en vue de se rendre maître de la planète ;
— et enfin, pour mémoire, les « vrais indigènes » qui ont disparu.
Or à la fin du 19 ème siècle on trouvait en Afrique du Sud :
— Les Bantous (Xhosas, Zoulous, Sothos, Swazis), « indigènes » qui ne le sont pas vraiment car il s’agit de populations venues de l’Afrique centrale et qui sont descendues vers le sud au cours d’une migration qui a duré des siècles. C’est vers le 17 ème siècle que cette migration a commencé à franchir le fleuve Limpopo, qui marque la limite nord de l’actuelle Afrique du Sud.
— Les Boers, descendant des premiers colons hollandais, et d’un certain nombre de protestants français qui s’étaient exilés à la suite de la révocation de l’Édit de Nantes. La colonisation hollandaise a commencé au milieu du 17 ème siècle, et à la fin du 18 ème siècle la colonie s’étend au nord jusqu’au fleuve Orange. Dans les années 1820-1830, pour se soustraire à la domination anglaise et pour conserver leur identité culturelle et leur mode de vie traditionnel, les Boers émigrent massivement vers le nord en dépassant les limites de la colonie et fondent deux républiques Boers, l’État libre d’Orange et la République Sud-Africaine (qui correspond au Transvaal). Cette migration dans de lourds charriots tirés par des bœuf, où les familles avaient embarqué tous leurs biens, est connue comme « le Grand Trek », et est mythique chez les Boers.
Читать дальше