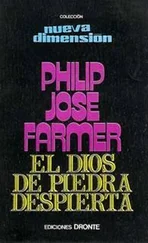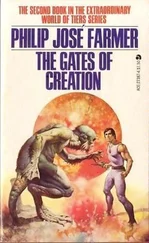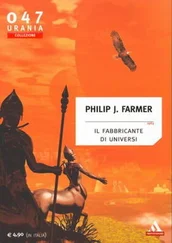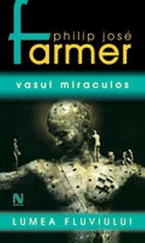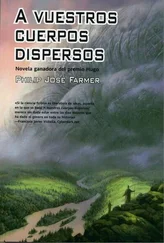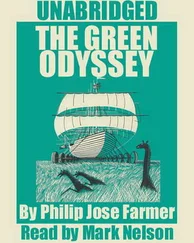— Pourquoi ne tentes-tu pas ta chance avec une goy ? lui avait demandé Frigate.
— J’ai essayé, avait répondu Lev en haussant ses épaules étroites. Mais tôt ou tard, il y a forcément une scène de ménage et elles finissent par vous traiter de « sale youpin ». C’est la même chose avec les femmes juives, mais venant d’elles, à la rigueur, je peux l’accepter.
— Ecoute, mon vieux. Il y a des milliards de goyim au bord de ce Fleuve qui n’ont jamais su ce que c’était qu’un Juif. Pourquoi ne pas essayer une de leurs femmes ? Elle ne pourra pas avoir de préjugé.
— Entre deux maux, je préfère celui que je connais.
— Tu es une vraie tête de mule, avait conclu Frigate.
Burton se demandait parfois pourquoi Lev Ruach restait avec eux. Bien qu’il n’eût plus jamais fait allusion au livre intitulé Le Juif, le Gitan et l’Islam , il avait souvent questionné Burton sur certains autres aspects de son passé. Il se montrait amical, mais sans se départir d’une indéfinissable réserve. Malgré sa petite taille, il se comportait comme un lion au combat et avait fourni à Burton une aide précieuse en lui enseignant le judo, le karaté et le jukado. La mélancolie qui émanait de lui, même quand il riait, ou faisait l’amour, selon Tanya, venait des cicatrices mentales que lui avaient laissées les terribles camps de concentration russes ou allemands, du moins d’après ce qu’il disait. Selon Tanya, toujours, Lev Ruach était simplement né triste. Il avait hérité les gènes de la mélancolie du temps où ses ancêtres s’asseyaient à l’ombre des saules de Babylone.
Monat, aussi, était un cas, bien que ses accès de vague à l’âme fussent plus aisément explicables. Le Tau Cetien était à la recherche de ses compagnons, les trente mâles et femelles qui faisaient partie de l’expédition et qui avaient été lynchés par la foule en folie. Lui-même ne s’accordait pas beaucoup de chances à vrai dire. Trente individus sur trente-cinq ou trente-six milliards, selon leurs estimations, essaimés au bord d’un fleuve qui avait peut-être vingt ou trente millions de kilomètres de long, cela rendait une rencontre hautement improbable. Mais il ne perdait rien à essayer.
Alice Hargreaves était assise de l’autre côté du gaillard d’avant. Seule sa tête dépassait. Chaque fois que le bateau s’approchait suffisamment d’une rive, elle scrutait anxieusement les visages, dans l’espoir de découvrir son mari, Reginald, mais aussi ses trois fils, sa mère, son père, ses frères et ses sœurs. Il était implicitement entendu qu’elle quitterait le bateau dans une telle éventualité. Burton n’avait rien dit, mais il ressentait un étrange malaise au creux de l’estomac chaque fois qu’il pensait à cela. Il souhaitait à la fois qu’elle parte et qu’elle ne parte pas. Loin de ses yeux signifierait inévitablement loin de son cœur. Mais il n’était pas sûr de vouloir que l’inévitable s’accomplisse. Il éprouvait pour elle le même amour que pour sa Persane. S’il la perdait aussi, il connaîtrait, sa vie durant, les mêmes affres que dans son existence terrestre.
Pourtant, il ne lui avait jamais fait part de ses véritables sentiments. Il se contentait de bavarder avec elle, de plaisanter avec elle et de lui manifester une sollicitude qui l’emplissait d’humiliation amère, car Alice ne le payait jamais de retour. A la longue, cependant, elle avait fini par se montrer détendue en sa présence. Ou plutôt, elle était souriante et détendue s’il y avait du monde autour d’eux. Mais dès qu’ils étaient seuls, elle se raidissait de nouveau.
Elle n’avait jamais voulu utiliser la gomme après leur première nuit. Burton l’avait utilisée trois fois en tout. Le reste du temps, il mettait sa part de côté pour pouvoir l’échanger contre des objets plus utiles. La dernière fois qu’il avait mâché de la gomme, c’était avec Wilfreda, dans l’espoir de connaître avec elle des moments d’amour extatiques. Mais contrairement à son attente, la drogue avait eu pour effet de lui faire revivre les moments les plus atroces de sa maladie des « petits fers », qui avait failli l’emporter lors de son expédition au lac Tanganyika. Speke était présent dans son cauchemar, et il l’avait tué. Dans la réalité, Speke était mort d’un « accident » de chasse que tout le monde avait interprété comme un suicide, bien que personne ne l’eût dit. Speke, tourmenté de remords parce qu’il avait trahi Burton, s’était tué d’une balle. Mais dans le cauchemar de Burton, celui-ci avait étranglé Speke quand son compagnon s’était penché sur lui pour lui demander comment il allait. Ensuite, au moment où la vision avait commencé à s’estomper, Burton avait embrassé le cadavre sur les lèvres.
Pourquoi le nier ? Il savait qu’il aimait Speke tout en le détestant, pour de bonnes raisons d’ailleurs. Mais il le savait de manière éphémère et épisodique, et il n’avait jamais pensé que cela pourrait l’affecter ainsi. Dans le cauchemar provoqué par la drogue, il avait été horrifié de découvrir la profondeur de ce sentiment caché et il avait poussé un hurlement. Wilfreda, affolée, l’avait secoué par les épaules jusqu’à ce qu’il se réveille et lui avait demandé en tremblant ce qui se passait. Wilfreda avait eu l’occasion de fumer de l’opium, ou d’en boire dans sa bière quand elle se trouvait sur la Terre. Mais ici, après avoir mâché de la gomme une seule fois, elle n’avait plus jamais accepté d’y toucher. Son aversion était due au fait que la drogue lui avait fait en même temps revoir la mort de sa petite sœur, emportée par la tuberculose, et revivre sa première expérience de prostituée.
— C’est une substance psychédélique aux propriétés pour le moins curieuses, avait déclaré Ruach. (Il avait expliqué le terme « psychédélique » à Burton, et ils en avaient ensuite discuté pendant des heures.) Elle semble faire émerger des incidents traumatiques d’une manière qui mêle étroitement le symbolisme à la réalité. Mais elle n’agit pas toujours ainsi. Parfois, c’est un aphrodisiaque. Parfois, comme on disait, elle fait accomplir un merveilleux voyage. Mais si on me demandait mon avis, je dirais qu’elle nous a été fournie dans un but thérapeutique, voire cathartique. C’est à nous, en fait, de découvrir la meilleure façon de l’utiliser.
— Pourquoi n’en prends-tu pas plus souvent ? demanda Frigate.
— Pour la même raison que les gens qui refusaient la psychothérapie, ou abandonnaient en cours de traitement. Parce que j’ai peur.
— Moi aussi, dit Frigate en hochant la tête. Mais un de ces jours, quand on fera une assez longue escale, je vais me mettre à en mâcher chaque soir, et il arrivera ce qu’il arrivera. Même si je dois crever de trouille. Bien sûr, je sais que c’est facile à dire.
Peter Jairus Frigate était né vingt-huit ans à peine après la mort de Burton. Pourtant, il y avait un fossé entre leurs deux époques. Sur d’innombrables questions, leurs points de vue étaient radicalement différents. Ils auraient eu de violentes discussions, si Frigate avait été capable de discuter violemment. Pas sur des points pratiques, comme l’organisation ou la discipline à bord du bateau, mais sur la façon de voir le monde en général. Le plus curieux, dans tout cela, c’était que, sous bien des rapports, les deux hommes étaient étrangement semblables. C’était là, sans doute, la raison pour laquelle, sur la Terre, Frigate avait été tellement fasciné par Burton. En 1938, il avait déniché par hasard une édition à bon marché du livre de Fairfax Downey intitulé : Burton, l’Aventurier des Mille et Une Nuits . L’illustration de première page représentait l’explorateur à l’âge de cinquante ans. Le visage farouche, le haut front aux arcades orbitaires saillantes, les épais sourcils noirs, le nez droit à l’arête incisive, la cicatrice qui lui barrait la joue, les lèvres épaisses et sensuelles, les grosses moustaches tombantes, la barbe taillée en fourche, tout cela, en même temps que l’agressivité bourrue qui se dégageait du portrait, avait incité Frigate à acheter le livre.
Читать дальше