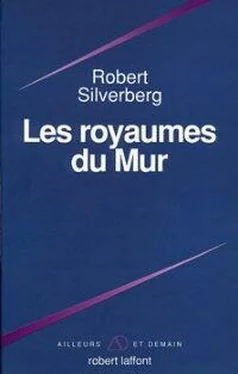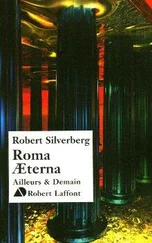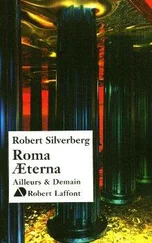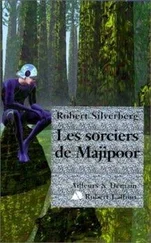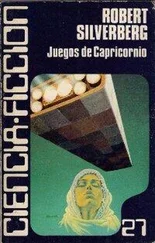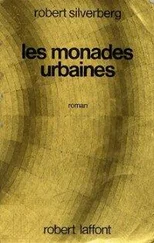Je hochai la tête en souriant à mon tour et il lança la pierre, mais manqua sa cible. Le singe poussa un rire strident et lui envoya une grêle de petits cailloux. Kilarion siffla de rage, jura et lança une autre pierre, aussi inefficace que la première. Au bout d’un moment, les singes se désintéressèrent de nous et nous ne les vîmes plus pendant le reste de la matinée.
Il n’y avait plus rien qui ressemblât à une route, ni même à un véritable sentier de montagne. Il nous fallait ouvrir notre propre piste au fur et à mesure de l’ascension. Nous étions parfois obligés de nous hisser au faîte d’escarpements semblables à des escaliers faits pour des géants, constitués de blocs de pierre du double de la hauteur d’un homme, qu’il fallait franchir avec cordes et crampons. Il nous fallut traverser un éboulis de rochers aux arêtes tranchantes, provoqué par l’effondrement d’une corniche. Je vis Traiben se démener en ahanant pour gravir ce périlleux amas rocheux. À un moment, il tomba et je m’arrêtai près de lui pour le soutenir pendant qu’il reprenait son souffle, puis je gardai le bras autour de ses épaules jusqu’à ce qu’il soit en mesure de continuer seul.
Mais, dans l’ensemble, la montagne était à cette altitude plus facile à escalader que nous ne l’avions imaginé et ce qui, du pied du Mur, paraissait être une muraille de pierre verticale se présentait en réalité comme une suite de larges replats rocheux, pentus, certes, mais pas aussi abrupts qu’on ne l’aurait cru de loin. Au total, la déclivité était forte, mais, pris l’un après l’autre, ces replats n’exigeaient qu’une marche lente et régulière.
Je ne voudrais pas vous laisser croire que nous progressions avec facilité. Quand il y avait une piste que nous pouvions suivre sans utiliser les cordes, elle était de pierre effritée, comme l’est une grande partie de la surface de Kosa Saag, et nous dérapions et glissions constamment sur ce sol caillouteux, risquant à chaque pas de nous tordre une cheville. Nos sacs étaient très lourds et le soleil tapait fort. L’insoutenable éclat blanc d’Ekmelios nous éblouissait, nous brûlait le visage et le cou et transformait les replats de roche que nous traversions en miroirs aveuglants. Nous avions l’impression de griller avec cette chaleur au lieu de mijoter, de cuire à petit feu comme dans les basses terres. Nous avions l’habitude de cette autre sorte de chaleur qui nous enveloppait comme un manteau humide et nous la regrettions vivement. Il n’y avait plus à cette altitude d’épaisses brumes chaudes pour faire écran à l’ardeur du soleil éclatant, plus de ces nappes humides et cotonneuses. La moiteur étouffante de notre village nous paraissait maintenant très loin.
L’air n’était pas seulement beaucoup plus limpide ; il paraissait aussi moins riche : sec, raréfié, pénétrant, désagréable. Il nous fallait respirer deux fois plus profondément qu’à l’accoutumée afin d’emplir nos poumons, ce qui nous faisait mal à la tête et nous irritait la gorge et les narines. Nos corps s’adaptaient à la raréfaction de l’air à mesure que nous montions et je percevais de légères modifications dans mon organisme : dilatation des conduits respiratoires, augmentation du volume des poumons, accélération de la circulation du sang. Au bout d’un certain temps, j’eus la certitude d’avoir réussi, au moins partiellement, à m’adapter à cette nouvelle atmosphère. Mais je n’avais encore jamais soupçonné à quel point l’air de la plaine est un fluide riche et grisant. Comme un vin capiteux en comparaison de l’air sec de la montagne.
En revanche, l’eau était à cette altitude beaucoup plus pure et bien meilleure que celle du village. Elle avait une limpidité magique et était toujours fraîche et pétillante. Mais il n’y en avait pas beaucoup. Sources et cours d’eau étaient rares et espacés sur ces pentes. Chaque fois que nous en trouvions un, nous nous débarrassions de nos sacs pour nous agenouiller au bord et boire avidement. Puis nous remplissions nos récipients, car nous ne savions pas combien de temps il nous faudrait attendre avant de trouver un autre point d’eau.
Il nous était maintenant impossible de distinguer le territoire de notre village. En contrebas, tout était enseveli sous un épais brouillard blanc. Comme si un grand manteau de fourrure blanche avait été jeté sur notre vallée familière. De loin en loin une trouée nous permettait d’apercevoir de la verdure, mais pas question de reconnaître quoi que ce fût. Il n’y avait donc plus rien en bas pour nous ; il ne nous restait plus qu’à grimper, à grimper toujours plus haut.
Kosa Saag était devenue notre monde, notre unique univers. Nous avions commencé à découvrir que la grande montagne que nous avions baptisée le Mur n’était pas en réalité une seule montagne, mais un grand nombre, un océan de montagnes, chacune s’appuyant sur ses voisines à la manière des grosses vagues qui s’élèvent au cœur d’une mer démontée. Nous n’avions aucune idée de l’endroit où se trouvait le sommet. Nous avions parfois l’impression d’avoir atteint le pic le plus élevé, car il n’y avait plus au-dessus de lui qu’un ciel dégagé, mais il n’en était rien, car, lorsque nous arrivions en haut, c’était pour découvrir d’autres sommets qui se dressaient plus loin. Un pic conduisait à un autre et encore à un autre. En levant les yeux, nous découvrions un spectacle d’une déroutante complexité : flèches et gorges, parapets et boucliers de roche rose. Un ensemble qui semblait s’élever jusqu’au Ciel. Il n’y avait pas de sommet. Rien que la montagne aux flancs sans fin qui se dressait à perte de vue au-dessus de nos têtes, tandis que nous cheminions patiemment, à la file, comme des fourmis, sur ses premières pentes.
Depuis le début de notre ascension, nous étions restés sur les flancs du Mur en suivant les ravins, les sentiers et les ressauts en saillie sur les parois colossales de la montagne. Il m’était donc facile de tracer chaque jour notre itinéraire : une voie étroite et continue qui se déroulait devant nous en serpentant sur la face du Mur. Il n’y avait pas à s’interroger sur le meilleur chemin, puisqu’il n’y en avait qu’un. Mais il ne nous était plus possible de poursuivre notre progression de cette manière, car nous venions d’arriver au pied d’une infranchissable barrière rocheuse qui se dressait devant nous et s’élevait aussi haut que la vue portait. Même après l’avoir longuement étudié, aucun de nous ne vit le moyen de franchir l’obstacle. Aucun chemin ne semblait en contourner la base et il était impensable de l’escalader.
Il nous fallut donc suivre le seul itinéraire possible qui nous faisait obliquer vers l’est pour nous engager dans une vallée intérieure de Kosa Saag. Nous y fîmes halte, dans une sorte de forêt fraîche et ombreuse qui s’étendait dans ce repli du Mur. Je dis « une sorte » de forêt, car les plantes qui y poussaient, bien qu’aussi hautes que des arbres, n’avaient absolument rien à voir avec les arbres des basses terres que nous connaissions. Dépourvues de tissu ligneux, elles évoquaient des brins d’herbe géants ou plutôt des touffes d’herbe, car chaque tronc semblait constitué d’une douzaine ou plus de tiges minces réunies à la base. Tout le long de ces tiges aux arêtes vives, à la place des feuilles, jaillissaient des dizaines de pousses cunéiformes, ressemblant à des lames de hachette.
Quand on touchait l’un de ces arbres, on ressentait une démangeaison dans la main. Si l’on prolongeait assez longtemps le contact après le début de la démangeaison, la peau commençait à brûler.
Il y avait dans ces arbres de petits oiseaux verts d’une espèce inconnue, perchés par groupes de deux ou trois sur le tranchant des lames de hachette. Ils avaient un corps rond et dodu, avec de drôles de petites pattes écarlates, à peine visibles sous le ventre, et des ailes si courtes et fluettes qu’elles ne leur permettaient que de voleter d’un fer de hache à l’autre. Il était difficile, après avoir vu les terribles faucons du Mur, d’imaginer oiseaux plus dissemblables. Il fallait pourtant se garder de prendre à la légère ces petits oiseaux à l’aspect si comique, car ils avaient des yeux ardents, d’étranges globes blancs brûlant comme des soleils en miniature. Il y avait de la haine dans ces yeux, une menace. Quand Gazin le Jongleur s’avança sous l’un de ces arbres pour appeler en riant les oiseaux dont la rondeur potelée l’amusait, ils réagirent en déversant sur lui un liquide visqueux qui lui fit pousser des hurlements de douleur et nous le vîmes s’élancer à toutes jambes dans la forêt pour aller se jeter dans le ruisseau qui la traversait.
Читать дальше