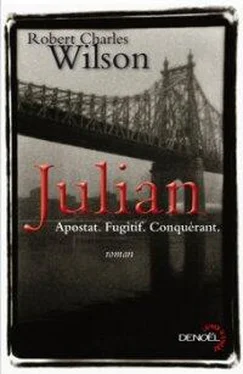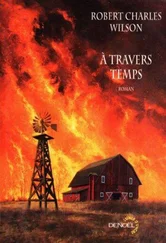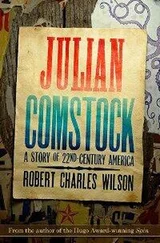La brise semble émettre un commentaire muet en feuilletant les pages d’un calendrier accroché au mur. J’ai du mal à croire que huit ans seulement nous séparent du vingt-troisième siècle ! Le temps m’est mystérieux… je m’habitue difficilement à sa manière de s’écouler. Peut-être suis-je devenu vieux jeu, peut-être resterai-je à jamais un Homme du Vingt-Deuxième Siècle.
Voilà que Calyxa traverse mon bureau pour aller dans le jardin.
Notre villa est située sur un haut promontoire et il ne pousse guère chez nous que du fenouil de mer et du sable, mais Calyxa a depuis longtemps fait ériger un mur protecteur autour d’un carré de bon terreau, dans lequel elle plante chaque année de la lavande, du mimosa et des tournesols. Elle m’a été d’une aide inestimable pendant que je rédigeais ma biographie de Julian… en complétant les phrases en français dont je ne gardais qu’un vague souvenir, en les recopiant avec les accents grave # et aigu # ou autres fioritures.
Elle s’arrête pour m’adresser un sourire énigmatique. « Tu es l’homme le plus gentil et le plus innocent que je connaisse. Tu rends supportables les laideurs de la vie. Sans toi, elles seraient insoutenables #. »
Sans doute une petite plaisanterie à mes dépens, car Calyxa est sceptique de nature et formule souvent ses ironies en français, langue qu’au bout de seize ans dans ce pays, je ne comprends toujours pas très bien. « C’est ce que tu crois », je lui réponds, et elle part en riant, sa jupe blanche virevoltant autour de ses chevilles.
J’ai l’intention d’abandonner ma machine à écrire pour la suivre. L’après-midi est trop tentant. Nous ne vivons pas au Paradis, loin de là, mais le mimosa est en fleur et un agréable souffle frais monte de la mer. Par des journées comme celle-ci, je pense à ce pauvre Magnus Stepney et à son Dieu vert en évolution qui nous incite tous à le rejoindre dans l’Éden. La voix du Dieu vert est si faible que nous sommes très peu nombreux à l’entendre correctement, et c’est ce qui fait notre malheur, j’imagine, en tant qu’espèce… mais je l’entends haut et clair, en ce moment. Elle me demande de sortir au soleil, et j’ai l’intention d’obtempérer.
FIN
Julian n’aurait pu être écrit sans la générosité et le soutien d’un trop grand nombre de personnes pour que je les cite toutes (parmi lesquelles, une fois encore, mon épouse Sharry à l’infinie patience). Des bouquinistes que j’ai consultés par légions au cours de mes recherches, deux méritent une mention spéciale : Jeffrey Pickell, de Kaleidoscope Books & Collectibles à Ann Arbor, le premier à attirer mon attention sur l’œuvre d’« Oliver Optic » (William Taylor Adams), et Terry Grogan, de BMV Books à Toronto, qui jouit du très étrange talent de trouver le bon livre au bon moment. Merci beaucoup aussi à Mischa Hautvast, Peter Hohenstein, Mark Goodwin et Claire-Gabriel Robert pour leur aide sur les passages en hollandais et en français… bien entendu, les éventuelles erreurs sont toutes de mon fait. Enfin et surtout, mes sincères remerciements à Peter Crowther, de PS Publishing, dont la jolie édition indépendante de ma novella « Julian : un conte de Noël » a ouvert la voie à ce travail beaucoup plus volumineux.
La citation de Herman Melville est tirée de Moby Dick, traduction Henriette Guex-Rolle, GF-Flammarion, Paris, 1989.
Les chapitres 1 à 7 constituaient, sous une forme très proche, la novella « Julian : un conte de Noël » paru en 2008 chez le même éditeur dans le volume Mysterium. La traduction en a été retouchée et adaptée.
Que j’ai rencontré par la suite alors qu’il avait soixante ans et que je débutais dans le métier littéraire… mais n’anticipons pas.
Notre représentant local du Conseil du Dominion… dans les faits, le maire de la ville.
J’implore la patience du lecteur si je détaille des sujets qui lui semblent déjà bien connus. Je me permets de croire à un public étranger, ou à une postérité pour qui nos dispositions actuelles n’iraient pas de soi.
La nature quelque peu féminine de Julian lui avait valu une réputation de sodomite parmi les autres jeunes Aristos. Qu’ils puissent le croire sans la moindre preuve témoigne de la teneur de leurs pensées, en tant que classe. Mais j’en avais bénéficié de temps à autre. À plus d’une occasion, les connaissances féminines de Julian — des filles raffinées de mon âge, voire davantage — m’ont pris pour le compagnon intime de Julian, au sens physique. Sur la base de quoi elles entreprenaient de remédier à ma déviance, et de la manière la plus directe. Je coopérais avec joie à ces «thérapies», qui se révélaient systématiquement efficaces.
L’illusion était vraiment saisissante avec des Exécutants professionnels, mais leurs écarts de conduite pouvaient être tout aussi stupéfiants. Julian m’a raconté un jour une adaptation cinématographique new-yorkaise du Hamlet de W. Shakespeare dans laquelle l’un était arrivé ivre dans la salle, si bien que le malheureux Danemark avait semblé s’exclamer «Mer d’ennuis — (un juron grossier) — j’ai moi-même des ennuis», tirade accompagnée d’autres obscénités, de nombreux carillonnements inappropriés et coups de sifflet vulgaires, qui avaient duré jusqu’à ce qu’on pût dépêcher une doublure pour le remplacer.
Non un talent venu plein et entier au monde, toutefois. Je n’avais montré ma première nouvelle terminée à Sam Godwin que deux ans auparavant, «Un Garçon Américain: ses Aventures dans l’Europe Ennemie». Sam en avait loué le style et l’ambition tout en soulignant un certain nombre de défauts: les éléphants, par exemple, n’étaient pas originaires de Bruxelles et leur masse leur permettait en général d’éviter de se retrouver cloués au sol en cas de lutte contre des garçons américains; un voyage de Londres à Rome ne pouvait s’accomplir en quelques heures, même sur «un cheval très rapide»… et Sam aurait pu continuer dans cette veine, si je n’avais trouvé une excuse pour quitter les lieux.
«Attrape-le à l’endroit où devrait être son cou, derrière la tête, ne t’occupe pas de la queue même si elle s’agite très fort et tant qu’il résiste, n’arrête pas de lui taper violemment sur le crâne.» J’avais répété ces instructions à Julian, qui avait bien davantage horreur des serpents que moi. «Oh, je ne pourrai jamais le faire!» s’était-il exclamé. Manifestation de pusillanimité qui pourrait surprendre les lecteurs au fait de sa carrière ultérieure.
Ou «cul-de-sac»? Je n’ai que quelques rudiments de français.
Même si l’ancien Miami ou Orlando pourraient commencer à faire l’affaire.
Julian avait un sens exquis du timing, qui lui venait peut-être de ses penchants pour le théâtre.
Autrefois confinées au Sud-Est, les couleuvres des blés s’étaient répandues dans le Nord avec le réchauffement climatique. J’ai lu que certains des Profanes de l’Ancien Temps en gardaient comme animaux domestiques… exemple supplémentaire de la perversité délibérée de nos ancêtres.
Et sans doute guère davantage qu’un trou de souris pour l’Église des Signes, bien que ce codicille ne fût point explicite.
Читать дальше