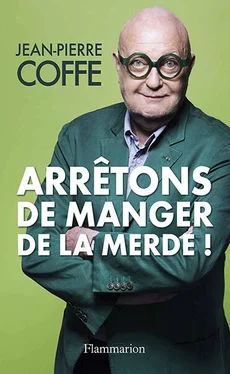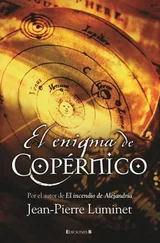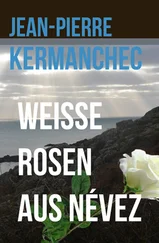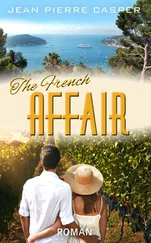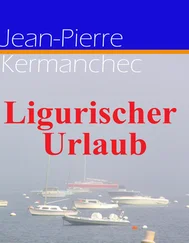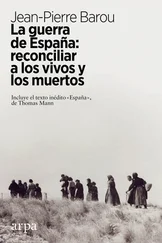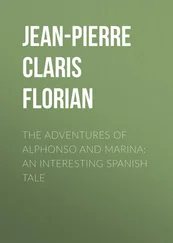Des truites, du bar, de la dorade, du turbot, du cabillaud, tous les jours à la cantine. Vous voyez déjà la vie en rose, demain vous la verrez en blanc !
Nous venons d’évoquer les poissons de mer, mais les poissons d’eau douce ne sont pas épargnés. Examinons un peu les méthodes d’élevage du panga et du tilapia. Cela risque de vous mettre en appétit ! Rêvez un moment. Vous êtes sur une jonque qui se balance mollement dans les méandres du delta du Mékong, autour de vous frétillent des millions de pangasius, eh bien ce sont eux que vous retrouvez sur les étals des poissonniers et de la grande distribution. Ce poisson est devenu l’un des principaux produits d’exportation du Viêt Nam. Il a toutes les qualités requises, top standard ! Vendu sous forme de filet blanc de grande taille, il n’a aucun goût, une chair insipide et molle, et miracle, grâce à la main-d’œuvre locale bon marché, son prix de revient au kilogramme est de l’ordre de 0,60 euro. Non je ne me suis pas trompé de zéro : 60 centimes, je dis bien. En dix ans, la production est passée de quelques dizaines de milliers de tonnes à plus d’un million ! Vous dire que cette production de masse ne crée pas de problèmes de pollution, et qu’elle n’utilise pas fréquemment des produits pharmaceutiques interdits en Europe serait vous induire foncièrement en erreur. Mais si vous voulez en manger, libre à vous.
Autre symbole de l’aquaculture intensive, le tilapia. Un poisson d’eau douce, originaire des lacs et des grands fleuves d’Afrique. Il doit être migrateur puisqu’il a maintenant quitté ses eaux d’origine pour être élevé dans toutes les zones chaudes de la planète. Il manifeste un intérêt particulier pour la Chine. Rappelons, pour mémoire, que la Chine est le premier « fabricant » de poisson au monde. L’Asie produit 80 % des poissons d’élevage, dont 63 % rien qu’en Chine. Pour l’élevage, le tilapia est une petite merveille, il avale n’importe quoi, et il est principalement herbivore. Cela tombe vraiment très bien : il ne coûte presque rien à produire. Toujours tenté ?
Revenons en eau salée. Un nouveau parasite est arrivé : la crevette. L’élevage de la crevette a été artisanal pendant longtemps. Mais quand les stocks de crevettes sauvages ont fortement diminué, l’industrialisation de la filière a commencé. En dix ans, la consommation a explosé de 300 % aux États-Unis, au Canada et en Europe, et pour répondre à cette demande croissante, les pays asiatiques — Thaïlande, Taïwan, Viêt Nam, Indonésie et Inde — se sont lancés dans l’élevage intensif, talonnés par le Brésil, le Mexique et l’Équateur. Les bassins d’élevage sont installés sur les littoraux tropicaux, comme les mangroves ou les forêts de palétuviers. La taille des exploitations est passée tranquillement de quelques dizaines à plusieurs centaines d’hectares, avec une densité pouvant atteindre les deux cents crevettes au mètre carré. Leur alimentation, industrielle évidemment : farine animale d’origine maritime ou terrestre. Selon le grand principe de l’industrie aquacole, « t’as pas faim, tu manges quand même », elles sont suralimentées. Dans leurs étangs, il fait jour 24 heures sur 24. Pour produire 30 tonnes de crevettes, il faut environ 90 tonnes de farines, donc de poissons. Comme la crevette n’échappe pas aux règles élémentaires, son univers concentrationnaire crée des maladies, des parasites et quelques autres contagions quand on ne traite pas. Action, réaction : puissants traitements d’antibiotiques, agents conservateurs pour les empêcher de noircir, lavage à l’eau javellisante pour tuer les bacilles. Ainsi, toute proprette, la crevette peut tranquillement se présenter congelée sur nos étals. Dois-je vous préciser que derrière ces petits crustacés se dissimulent de gigantesques trusts de l’industrie agroalimentaire, qui fournissent à la fois l’alimentation et les produits phytosanitaires ?
Le problème est le même, quelle que soit la variété des poissons et des crustacés élevés : que faire des vidanges des bassins de production ? Vous avez maintenant compris que cette « soupe immonde » composée de boue aux antibiotiques, pesticides et autres produits chimiques est encombrante. Mais il faut bien la rejeter, pourquoi pas sur les terres, aux alentours de ces fermes ? Il est certain que les cours d’eau et les sols vont être pollués, mais quand il faut se débarrasser de cochonneries, on n’hésite pas ! Le Vietnam Institut for Economics and Marin Planning, après une étude récente, précise que chaque hectare d’élevage de crevette produit 8 tonnes de déchets solides par an et que les fermes d’élevage vietnamiennes, à elles seules, rejettent 7 millions de tonnes de déchets. Ça donne envie de se baigner ! Que dire du respect des écosystèmes ? Bien peu de chose : d’importantes surfaces de mangroves disparaissent au fil des années, mettant en danger les côtes devant les cyclones et les tsunamis qui affectent ces régions. La Thaïlande, par exemple, premier producteur mondial, a détruit 70 % de toutes ses forêts de mangroves. Tout cela vous paraît choquant, bien sûr, révoltant même. Vous voulez de la crevette sauvage, sachez quand même que la pêche de ces dernières est particulièrement dévastatrice. Les crevettiers sont des bateaux destructeurs, les « terminators » des mers. En Malaisie, pour une tonne de crevettes pêchées, quatre tonnes d’oiseaux marins, de tortues, de requins, et autres poissons sont rejetés.
À quoi sert toute cette pollution ? À nous faire manger des crevettes toute l’année, à nous donner l’illusion de nous nourrir « sainement », de « manière équilibrée » grâce à des produits frais… Une rengaine que vous entendez régulièrement.
Vous voulez vraiment manger des crevettes ? Soyez raisonnable, optez pour la qualité. Offrez-vous une poignée de bouquets, oui, des Palaemon serratus , péchés au large de Granville, à la saveur unique, délicate. Certes, vous les paierez plus cher que les autres, mais vous n’en mangerez qu’une fois ou deux par an, vous découvrirez la saveur, les délices, le dépaysement, un instant de bonheur rare.
Il existe des productions plus responsables (Label rouge, bio). Elles sont essentiellement originaires de Madagascar. Là-bas les élevages sont moins intensifs : de cinq à dix crevettes au lieu de deux cent quarante, une alimentation garantie sans OGM, ni farines animales terrestres, ni colorants ajoutés à la cuisson, et sans usage excessif d’antibiotiques. Là aussi, vous pouvez y aller.
Pour le moment, en France, nous sommes les leaders spécialistes de l’élevage du bar, de la dorade et du thon. La plus grande ferme piscicole au monde est dans le Pas-de-Calais, cocorico ! Créé en 1983, AquaNord produit 2 500 tonnes de bars et de dorades par an. Les poissons sont vaccinés et traités aux antibiotiques, « en cas de nécessité seulement », nous précise-t-on. Pour élever un bar, 4 kg de poissons sont nécessaires alors qu’il en faut 25 pour un saumon. Outre la pollution et l’utilisation de produits toxiques pour la santé humaine, le véritable drame de l’aquaculture est là : il faut beaucoup de nourriture pour alimenter tous les produits d’élevage. La farine et les huiles sont pour la plupart issues de poissons pélagiques, poissons vivant proches de la surface, comme les anchois, capturés par millions de tonnes au large du Pérou ou du Chili grâce à des pêches ultramodernes. « Ils sont tellement suréquipés qu’il leur suffirait d’à peine plus d’une quinzaine de jours pour vider tous les bancs. » Philippe Cury, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement, est formel. Si l’essor de l’élevage perdure, ces espèces ne suffiront pas à subvenir à la demande. Certaines ont déjà disparu à cause des excès de la pêche minotière. Le même Philippe Cury constate : « Il n’y a plus un poisson pélagique le long des côtes du Namibie. »
Читать дальше