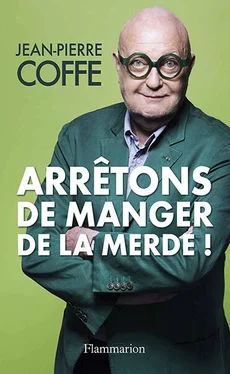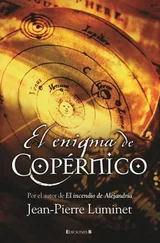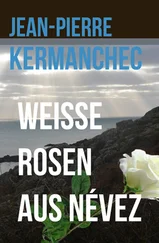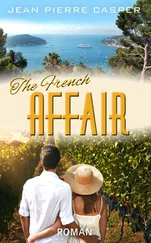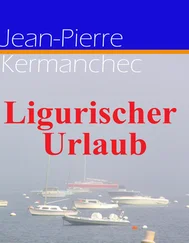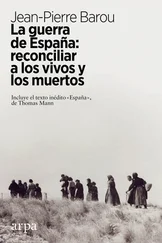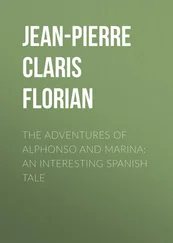Quel bel enjeu : transformer tous les poissons d’élevage en végétariens. Les recherches sont en cours mais ne sont pas encore probantes. Quid alors des omégas 3 ? Il faudra trouver de nouveaux discours pour faire avaler des poissons guimauves. Adieu les poissons gras. Au régime, comme tout le monde !
Bruxelles a tranché le débat, en autorisant la réintroduction des protéines animales dans l’aquaculture. Cette nouvelle aurait dû faire l’effet d’une bombe, en ces temps troublés de crise alimentaire. Rien n’a explosé, ni vu, ni connu, consommateur on t’embrouille… Quelques associations ont quand même réclamé un étiquetage clair à poser sur un poisson ou un crustacé qui aurait été élevé avec ces farines, rien de plus. Les professionnels de la filière, les producteurs ont des mines effarouchées : « Des farines animales dans nos filières ? Jamais ! » Même Marine Harvest a mis son veto. Belle pudeur ! Jusqu’à quand ? Philippe Cury, excellent scientifique, affirme que ce sera inéluctable, que la biomasse est insuffisante pour nourrir des poissons d’élevage qui devront nourrir la population croissante. Pour le moment, saumons, bars et dorades peuvent se régaler avec des protéines animales transformées de porc et de poulet. Voilà ce qu’on a trouvé pour « améliorer la durabilité à long terme du secteur de l’aquaculture ». D’autres solutions sont envisagées, utilisées, même : une farine alternative issue des coproduits de la pêche — vous vous souvenez, coproduits = déchets. Les Chinois s’en servent déjà pour alimenter leurs anguilles. Une probable manne encore peu exploitée qui permettrait l’optimisation de la ressource. En attendant, Bruxelles a légiféré, elle impose à tous les pêcheurs français de ramener, dès 2014, tous leurs déchets à terre. À défaut de pêche miraculeuse, la filière est à la recherche d’une denrée qui pourrait faire tourner l’industrie des poissons. Si vous trouvez, votre fortune est faite ! En Pologne, les truites d’élevage sont nourries à la farine d’hémoglobine. Ne soyez pas choqués ! Les farines de sang d’animaux non ruminants sont à nouveau autorisées en Europe. Vous ne saviez pas que des farines de plumes de volaille et des farines de sang étaient permises ? Pourtant, « elles sont très digestes et très abordables », selon les aquaculteurs. Pas d’étiquette pour le préciser, pas de vantardise, discrétion absolue. Les professionnels français ne se risquent pas encore à les utiliser. Ça viendra, rassurez-vous.
Alors, qu’est-ce qu’on mange ?
Les achats de poissons et de crustacés « frais » ont diminué de 4,8 % en 2011. Cette baisse affecte toutes les familles des produits de la mer, à l’exception des produits traiteur. Les produits traiteur, c’est avant tout du surimi, des poissons panés, élaborés à partir de pulpe de poisson, des bouillies d’arêtes passées à la centrifugeuse, des plats préparés à partir de poisson globe-trotteur, congelé, décongelé selon les besoins. Ce sont les vedettes de la malbouffe, les stars de la fainéantise cuisinière : pâté en croûte, carpaccio, paupiette, rôti, terrines, il existe même des gaufres aromatisées au poisson. De quoi être émerveillé par l’imagination délirante des industriels.
Est-il trop tard pour changer, pour essayer de consommer avec bon sens ? Non, on peut encore acheter du poisson frais au rythme des saisons de pêche, il sera moins cher, changer de menu, essayer des huîtres, les moules, les crevettes grises. Rayez de votre alimentation les crevettes roses, les thons rouges, les grenadiers, les grands prédateurs, requins, espadons, chargés de mercure, soyez inventifs, téméraires, variez les espèces, essayez les poissons oubliés, choisissez des produits locaux, français, de pêche plus responsable.
La « pêche durable » est tendance, tout le monde y va de son écolabel, aussi marketing que responsable, bien sûr. Passons sur toutes les horreurs que nous avons évoquées et essayons de voir s’il y a encore des raisons d’espérer.
Encourageons les bonnes pratiques. Le plus répandu des écolabels est anglo-saxon : MSC (Marine Stewardship Council). Cette ONG est basée à London et a été créée par le groupe Unilever, premier acheteur mondial des produits de la mer, et par le WWF (World Wide Fund for Nature). Rassurez-vous, cette ONG a pris son indépendance à l’égard des fondateurs, exit Unilever. Le MSC a développé une norme pour une pêche durable et responsable, c’est-à-dire dans le respect de la gestion des stocks. Soyons précis, c’est un label de durabilité, pas de qualité. Toutefois, ils sont très exigeants et la certification qu’ils octroient prend du temps, vingt mois avant d’autoriser l’apposition de leur logo sur les produits. Le respect du cahier des charges est contrôlé au moins une fois par an. Cinq pêcheries françaises ont obtenu leurs qualifications dernièrement : la pêcherie du lieu noir en mer du Nord, la sardine de bolinche en Bretagne du Sud, une pêcherie franco-britannique de homard, la pêcherie d’églefin et de cabillaud, la pêcherie de lieu noir de la Scapêche (Intermarché) et la compagnie des pêches de Saint-Malo. C’est peu, mais ça a le mérite d’exister.
Une autre bannière flotte sur les étals : « pavillon France » ; depuis l’année 2010 FranceAgriMer, successeur de l’Ofimer, et Ifremer s’attachent à promouvoir les produits d’une pêche 100 % française. Certains pêcheurs aussi ont fait le choix de la qualité : filière Opale, Bretagne Qualité Mer, Normandie Fraîcheur Mer, Fraîcheur du littoral, l’Association des producteurs méditerranéens. Ces regroupements imposent un cahier des charges extrêmement strict à leurs adhérents : trait de chalut limité dans le temps pour ne pas abîmer les poissons, des cales identifiées pour éviter le mélange des espèces, un entreposage en chambre froide sitôt la pêche débarquée, un étiquetage assurant la traçabilité du poisson et la vente au premier acheteur en moins de 24 heures. Vous voyez, tout n’est pas perdu. D’autres labels s’efforcent de défendre le mode de capture, comme l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne, qui pare ses poissons d’une petite étiquette orange. Cinq pour cent du marché, voilà ce que représentent ces signes de qualité, si on ne les aide pas, ils disparaîtront. La balle est dans notre camp — saisissons-la avant qu’il ne soit trop tard.
Pêche durable demande quand même un peu de vigilance. Par exemple, une grande enseigne de la distribution commercialise des filets surgelés de flétan, dorade et loup de mer, arborant fièrement le logo « pêche responsable ». Ce label correspond précisément à trois garanties : la qualité alimentaire, avec à la clef la sécurité sanitaire, la protection et la gestion de la ressource, et la protection de l’environnement. Voilà qui est bel et bon ! L’enseigne oublie de préciser que c’est elle qui vérifie le respect de ces bonnes pratiques, sans aucun contrôle indépendant. Une autre enseigne a choisi de frapper fort, en supprimant le thon rouge de ses linéaires, mais en privilégiant, a contrario, sous prétexte de faible empreinte écologique, le tilapia et le pangasius. On n’est jamais assez vigilant.
On peut toutefois se demander s’il y a des contaminants dans la mer.
Les contaminants susceptibles de se trouver dans les poissons (PCB — polychlorobiphényles, anciennement utilisés dans les transformateurs et les gros équipements électriques —, les dioxines, les retardateurs de flamme polybromés, le mercure) sont des composés chimiques peu réactifs, et donc persistants. Ils sont peu solubles dans l’eau et, au contraire, solubles dans les graisses. Mais des concentrations maximales admissibles dans les produits de la mer ont été fixées, et d’une manière générale, les teneurs mesurées dans les espèces destinées à la consommation sont bien inférieures aux limites de résidus. Enfin, c’est ce qu’affirment scientifiques et organismes d’État.
Читать дальше