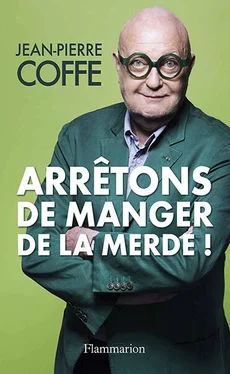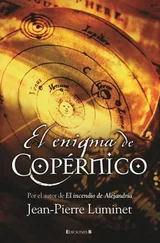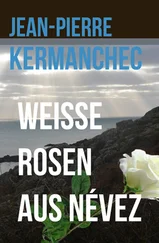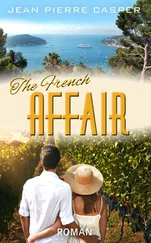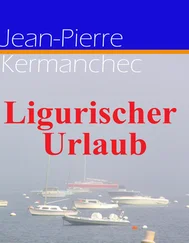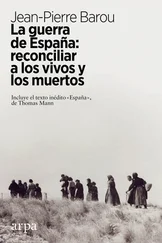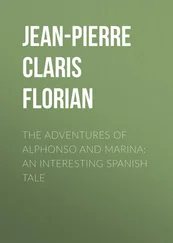En 1958, les industriels ont eu un coup de génie, trouver une solution pour se débarrasser des parties avant : le steak haché. Inventé pour nourrir les troupes françaises stationnées sur le front algérien, il s’appelait alors « roty-steak ». Devant le succès, les industriels ont vite compris qu’il fallait en faire un plat national.
Mais que faire des os et des carcasses ? De la farine pour nourrir les animaux. Voilà comment on en est arrivé à la dramatique épidémie de la vache folle. Nous n’étions pas les seuls, en Europe, à avoir trouvé cette technique ingénieuse : les Britanniques s’y étaient mis aussi, mais sans respecter les règles élémentaires. En 1991, on découvrit quelques cas de vache folle dans nos étables, cinq, mais aucun en 1992, un en 1993, quatre en 1994, trois en 1995. Statistiquement, rien de significatif. On alluma quand même un premier contre-feu, trois lettres : VBF (viande bovine française). On pensait ainsi qu’il n’y avait aucun risque à manger du bœuf français… jusqu’au 21 mars 1996, quand les Français mirent l’embargo sur la viande britannique. Panique ! 60 % de baisse de la consommation de la viande. Vite, vite, vite, deuxième contre-offensive : la traçabilité. Bizarrement, les industriels furent capables de nous donner très rapidement des garanties sur ce qu’ils ignoraient la veille. En moins de 24 heures les étiquettes valsèrent, « filière qualité » par-ci, « produit français garanti sans farine animale » par-là. On trouva des responsables : les fabricants britanniques, qui avaient insuffisamment chauffé les farines aux bonnes pressions et aux bonnes températures, ce qui leur permettait de vendre moins cher. En France, les équarrisseurs affiliés à des groupes publics furent exemptés de tout reproche, officiellement, d’ailleurs, aucune enquête ne fut jamais diligentée pour retrouver les coupables.
Qu’est-ce qu’on mange, en France ?
Un professionnel de la filière affirme : « Aujourd’hui, on produit tout et n’importe quoi en France. » On loue les qualités gustatives de la vache montbéliarde. Bien que son lait soit de belle qualité gustative et idéal pour le fromage, sa viande n’a rien de comparable. Elle n’est pas de même niveau que celle d’une race à viande, il ne faut pas confondre. Certes, pour ne pas confondre, il faudrait qu’on apprenne ou qu’on nous informe que la viande peut être issue de deux troupeaux, celui des races laitières et celui des races à viande, dites allaitantes, mais les pouvoirs publics et la filière viande n’ont aucun intérêt à nous informer de ce qu’il y a réellement dans nos assiettes. Ni vu, ni connu.
La filière bovine est si complexe, si opaque ! De l’animal à l’assiette, il y a de nombreuses étapes, et des opérateurs de tous les horizons se succèdent. Sur les étals, les viandes proviennent d’animaux qui n’ont pas les mêmes origines, pas le même âge, ni les mêmes caractéristiques physiques. Admettons d’abord, une bonne fois pour toutes, que nous ne mangeons pas du bœuf, mais principalement de la vache. Cette vache est issue d’un cheptel bovin de 18 992 000 têtes (chiffres Eurostat, d’après SSP 2011), le plus important de l’Union européenne, soit 20 % de l’ensemble du cheptel européen.
Nous nous trouvons donc en présence de deux troupeaux :
— un troupeau de race laitière, qui comptait 3,6 millions de vaches en 2011, situé principalement de la Bretagne aux Pays-de-la-Loire jusqu’aux contreforts du Massif central. L’icône de cette production laitière est la Prim’Holstein, dont nous avons pu voir les méfaits dans un chapitre déjà traité, « Le lait ». Cette vache « porte-manteau », génétiquement programmée pour pisser du lait, est très résistante et facile à élever. Subsistent à ses côtés quelques races mixtes, normandes et montbéliardes. Ce troupeau laitier ne va plus au pré, les vaches vivent selon les principes américains du « no grazing », en stabulation sur du ciment (de 2 à 3 m 2par vache), cantonnées à produire, dépendantes de leurs robots de traite dans les usines à lait les plus modernes. L’animal est pour ainsi dire dressé, il se présente spontanément au robot, qui lui offre une petite récompense en échange de sa docilité. Son alimentation est composée essentiellement d’ensilage (méthode de conservation du fourrage par fermentation), de maïs, riche en énergie mais peu protéique. Cette gourmandise est complétée avec de grosses quantités de tourteaux de soja (ce qui reste après l’extraction de l’huile). Le soja vient du Brésil à 56 % et d’Argentine à 38 %. L’Union européenne importe 80 % de ces protéines principalement destinées à l’élevage. La France tient le pompon du plus gros importateur, elle ne produit que de 2 à 3 % de sa consommation de soja. On le sait, le prix du soja fluctue, aussi, quand il est à la hausse, les agricultures jouent sur les sous-produits (comme la pulpe de betterave) pour nourrir leurs bêtes, auxquelles ils ne demandent pas d’aimer mais de s’adapter.
— Le troupeau des races à viande ou allaitantes tire son nom des femelles qui allaitent leurs petits. Ce troupeau compte un peu plus de 4 millions de vaches, principalement des charolaises, des limousines, des blondes d’Aquitaine, l’aubrac et la salers. Quelques autres races locales subsistent, mais elles sont malheureusement en voie de disparition. L’alimentation de ce troupeau est plus appétissante, composée d’herbe, l’été, et de foin et d’ensilage d’herbe, l’hiver, quand celui-ci rentre à l’étable.
Ces deux troupeaux fournissent plusieurs catégories d’animaux.
— Les laitières donnent des veaux destinés à l’élevage industriel. Les jeunes femelles de ce troupeau, environ 20 %, sont sélectionnées pour le renouvellement des troupeaux.
— Les allaitantes donnent des génisses de 12 à 30 mois. Elles ne connaissent pas l’humiliation de l’insémination artificielle, n’ont pas de veaux et sont principalement destinées à l’exportation vers l’Espagne. Une autre catégorie du troupeau allaitant produit des veaux qui sont en partie exportés, à l’âge de 8-10 mois, vers l’Italie et l’Espagne ; les autres sont engraissés en France. Ce troupeau allaitant produit également des mâles. Castrés à 18 mois, ils deviennent du bœuf. Parmi les mâles, comptons le taureau, qui peut être destiné, puisqu’il est entier, à la reproduction, mais l’insémination prive la plupart du temps la vache de ce plaisir.
Comme on s’en rend compte, la viande bovine est issue d’animaux de toutes races et à des degrés divers, auxquels il faut bien ajouter, pour être complet, les vaches elles-mêmes, mères du troupeau. En effet, après plusieurs années à donner des veaux, et par conséquent du lait, les vaches sont réformées et commercialisées pour faire de la viande. À la fin de leur carrière, vers 6 ou 7 ans pour les laitières, et 7 à 10 ans pour les reproductrices, elles partent à la réforme. Toutes les réformes ne sont pas identiques. Les reproductrices, issues du troupeau à viande, ont été élevées pour faire de la viande, alors que les laitières sont des machines à produire du lait dont la viande est un sous-produit. Avant d’être envoyées à l’abattoir, les vaches laitières doivent être taries jusqu’à la fin du cycle de lactation. Elles sont en principe isolées et ré-engraissées avec des farines, des céréales, et parfois même remises à l’herbe, pour « refaire du muscle ». Cette période de réforme peut durer quatre mois. J’ai pu constater par moi-même, en visitant des abattoirs, que l’exigence du tarissement n’était pas toujours respectée. Quant à la période de réforme, elle est peu fréquente, à l’exception de quelques éleveurs très sérieux mais rares. Une bonne vache de réforme retrouve une viande superbe, persillée et goûteuse, mais comme l’engraissement n’est pas payé à sa juste valeur, on fait rapidement tourner les animaux pour économiser de la nourriture.
Читать дальше