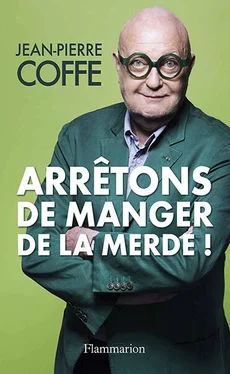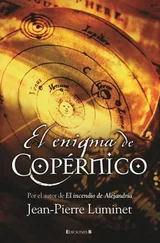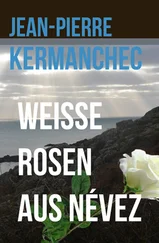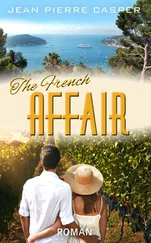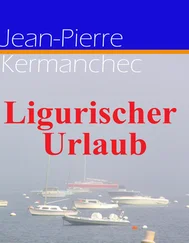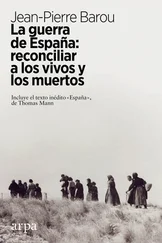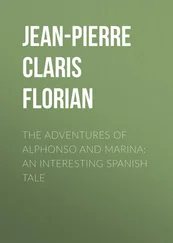Revenons à l’œuf. En s’acharnant à vouloir des DLC (date limite de consommation) de plus en plus longues, des goûts spécifiques, différents du goût naturel, à un prix toujours plus bas, quitte à ajouter de l’eau et de l’air dans les produits, le consommateur paie une coquille vide. Il peut toujours se plaindre qu’il y ait en France une trop grosse production d’œufs standard, même si elle est de plus en plus pauvre en matière sèche (jaune), on prend le risque de supprimer les œufs de notre alimentation.
Le marché de l’œuf est paradoxal. D’un côté, il vend du rêve, de la poule élevée au grain, des fermières sur les emballages et encourage le consommateur à l’illusion. Et ça marche dans les magasins, tous les magasins, y compris la grande distribution. Les achats d’œufs de poules en cage ne cessent de baisser, par comparaison avec ceux de plein air, qui occupent 50 % des parts de marché. Un bémol s’impose : comme il faut alimenter les usines d’ovoproduits, la production d’œufs standard, pour elles, ne diminue pas.
Les productions les plus dynamiques sur les cinq dernières années sont celles des œufs biologiques et des pondeuses élevées au sol. Leur taux de croissance annuel atteint en moyenne 11 %. En Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, nous l’avons déjà vu, les distributeurs ont fait une croix sur la production d’œufs de batterie. L’Italie et le Royaume-Uni semblent suivre le même exemple. Pourquoi, en France, traînaille-t-on, pinaille-t-on ? Qu’est-ce qu’on attend ? Les sondages sont éloquents : « 75 % des Français sont prêts à payer leurs œufs plus chers s’ils ont la garantie qu’ils ne proviennent pas de poules élevées en cage » ! Soyons patients. Attendons les résultats de l’expérience que tente l’enseigne Monoprix. Depuis le 1 eravril 2013, elle ne commercialise sous sa marque que des œufs français, certifiés issus de poules élevées au sol, en plein air, ou en agriculture biologique.
J’espère vous avoir donné les clefs pour faire un choix qualitatif. Si vous voulez vraiment faire plaisir aux poules, allez acheter des œufs plein air. L’autre paradoxe est que, dans le même temps, on continue à produire des ovoproduits en remplaçant les œufs par de l’eau et de l’huile de palme.
À bon entendeur.
Les Français sont inattendus ! Lisez plutôt : 89 % d’entre eux apprécient les pêcheurs, et 72 % la pêche. Ces chiffres sont le résultat d’un sondage effectué par Ipsos, en 2011, pour le CNPMEM (Comité national des Pêches Maritimes et des Élevages Marins). Plus de huit Français sur dix considèrent que le secteur fournit des services et des produits de qualité, selon FranceAgriMer (Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer). Il y a de quoi se réjouir, la consommation des produits de la mer est en hausse constante : 31 kg par habitant, en 2000, 36,8 kg par habitant, en 2011. Il n’y a apparemment aucune raison de se priver de poisson, d’autant que les publicitaires nous rappellent régulièrement qu’il est diététiquement correct, recommandé pour tous, et surtout, qu’il est naturel. Essayons de regarder ce qui se cache derrière ce tableau idyllique : une triste et sombre réalité. Vous êtes naïf, alors ? Vous croyez vraiment que votre saumon a remonté le courant des rivières, que votre sushi au thon rouge est vraiment fabriqué avec du thon rouge ? Que le bar ou la dorade royale que vous vous apprêtez à déguster dans un restaurant « chic » se baladait en pleine mer avec d’autres espèces, que vos crevettes ont été pêchées en pleine mer ? Éclairons votre lanterne. Le monde de la mer est devenu un miroir aux alouettes, entre illusions et fumisteries. Ne vous étonnez pas qu’un jour vos enfants vous affirment que les poissons carrés nagent ou naissent dans un congélateur.
Rendons-nous sur le port de Boulogne-sur-Mer, au petit matin, quand le soleil se lève timidement. Les poissons ont été débarqués un peu plus tôt dans la nuit, la criée va bientôt commencer. Il n’y a pas foule dans cette salle ultramoderne aux allures d’amphithéâtre universitaire, peu de pêcheurs sont rentrés au port. Il est 6 heures, les acheteurs se tiennent prêts derrière leur pupitre, l’œil braqué sur trois ou quatre cadrans sur lesquels sont indiqués le nom et les origines des espèces, les quantités disponibles et les prix. Vingt minutes plus tard, la vente est expédiée dans un silence de morgue. Les offres ont été faites d’une simple pression du doigt sur des boutons. La criée telle qu’on se l’imaginait n’existe plus, criée ne veut plus dire crier. Depuis quelque temps les acheteurs effectuent leurs achats à distance, reliés aux bateaux par ordinateur. Ils se renseignent sur la provenance, la quantité, proposent un prix, topons-là, la vente est faite, inutile d’aller vérifier la qualité de la marchandise.
Ce matin-là, à l’exception de deux bars majestueux, peau brillante, quelques merlans et rougets de pêche française, la plupart des navires qui déchargeaient étaient étrangers, britanniques, norvégiens, islandais, néerlandais, asiatiques, africains… les mêmes poissons qu’on retrouve sur les étals. Quelques anciens se lamentent : « Il n’y a plus de poisson à Boulogne-sur-Mer, ni ailleurs. » Les ports français ont perdu leurs gros armements et la moitié de leurs bateaux. Il y a dix ans, le drapeau tricolore flottait sur environ 8 000 bateaux, il en reste 5 815. Seule la Scapêche (Intermarché) détient une vingtaine de gros navires à Lorient. Face à ce délitement, on s’imagine une profession solidaire, une filière française au coude à coude. Si c’était le cas, à Bruxelles, embarqués dans la même galère, ils feraient front commun pour batailler, défendre leurs intérêts ensemble, unis.
Pas du tout ! Chaque pêcheur mène sa barque de son côté, c’est la guerre entre Bretons et Boulonnais, entre ceux du Nord et ceux du Sud. Chacun défend son littoral. Pourtant, la cohésion nationale serait indispensable pour défendre une filière fortement soumise aux aléas du marché. Moins de bateaux, moins de pêcheurs : de moins en moins de jours de pêche. Nos pêcheurs français sortent en moyenne deux fois par semaine pour des campagnes de 24 à 48 heures. Ils jettent l’ancre le vendredi pour passer le week-end en famille, les temps changent, le pêcheur ne travaille plus le dimanche, certains autres restent même à quai. Les quotas ! Le gros mot est lâché. Une décision inique, injuste selon eux, car pendant ce temps-là, les Britanniques remplissent leurs cales.
Le constat est terrible, les poissons issus de la pêche française représentent seulement 10 à 20 % de ce qu’on voit sur les étals, donc de ce que nous mangeons. Il n’est pas facile de savoir d’où ils viennent. Est-ce que nous serons contraints, comme les Américains, de nous méfier ? Là-bas, un tiers des poissons portent une étiquette frauduleuse. Par exemple, on vend du tilapia pour du rouget. En France, le Service de la répression des fraudes nous dit que ce type d’escroquerie est marginal. Doit-on le croire ? Il est vrai que dans la filière poisson il y a moins d’intermédiaires que dans celle de la viande. En France, depuis 2002, l’étiquetage est supposé fiable puisqu’il impose de mentionner sur les étiquettes la zone de capture. Vous avez déjà lu : « péché en Atlantique Nord-Est », « péché en Atlantique Nord-Ouest », « péché en Atlantique Centre-Ouest ». Ces zones de pêche délimitées l’ont été par la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Qu’est-ce que ça veut dire : « Zone Atlantique Nord-Est », « zone 27 » pour la FAO, couvre grosso modo une portion de mer qui partirait du Groenland au nord de la Russie, pour s’étendre jusqu’au sud de l’Espagne, Islande incluse. Vous pourriez aussi imaginer que la « Zone Atlantique Centre-Est », « zone FAO 361 », touche les côtes françaises. Vous avez perdu, il s’agit du Canada ; quant à l’Atlantique Centre-Ouest, elle longe les côtes de l’Afrique de l’Ouest. Eh bien oui, constatez, comme moi, que votre poisson a souvent fait un long périple avant d’atterrir dans votre poêle ou votre court-bouillon.
Читать дальше