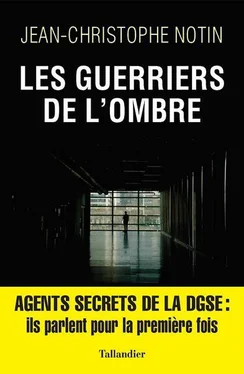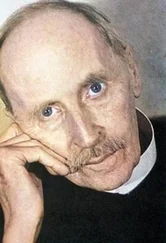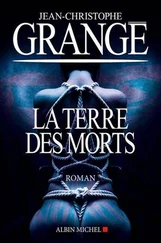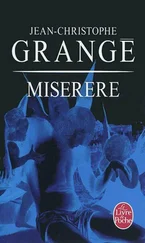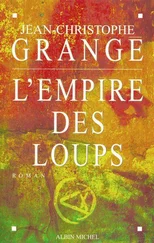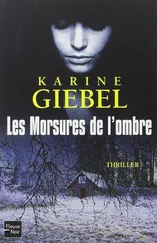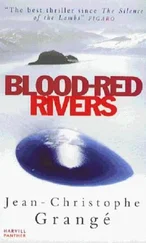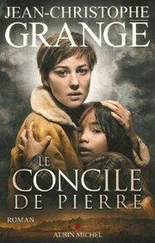La DGSE est faite pour les dilemmes. La montée de certains périls dans le monde, et le boom technologique phénoménal qui est censé permettre de les combattre, obligent depuis plusieurs années à augmenter les effectifs. Mais comment attirer les meilleures recrues sans, de prime abord, rien pouvoir leur dire de ce qui les attend… ? Un peu comme si un magnat russe voulait enrôler les meilleurs joueurs de la planète, mais sans leur annoncer pour quel sport. C’est encore plus vrai avec les services de la DGSE qui font de la clandestinité leur ressort principal : toute atteinte au secret y est à proscrire, même avec du personnel déjà au sein de l’institution.
JCN : Comment un Service clandestin, qui a la plus grande discrétion pour ADN, peut-il donc se dévoiler pour attirer à lui des recrues ?
Patrick : J’ai pris un service qui était en plein développement — d’ailleurs c’est ce qui m’a intéressé, quitter le Service action pour créer quelque chose. Donc, le recrutement s’est fait à la base, soit avec des anciens du Service action qui sont venus avec moi, soit [avec] des jeunes OT de la DGSE pour qui nous avons fait une présentation de ce que nous voyions, nous, du renseignement de crise et de ce que nous voulions développer. [Cela] s’est fait au coup par coup, de manière très sporadique. Il n’y avait pas un stage et cinq places réservées pour le Service clandestin. Ensuite, la sélection a été très sévère parce qu’à la différence d’un OT de la Direction du renseignement, qui est dans un bureau au début, qui va démarrer au milieu de ses collègues, apprendre le métier, l’OT du Service clandestin, lui, se retrouve tout de suite immergé dans l’action clandestine.
JCN : Que dites-vous aux éventuels candidats pour « vendre » le Service clandestin ?
Patrick : Je ne veux pas être arrogant dans ma réponse, surtout pas, mais on n’a pas à vendre. C’est plutôt eux qui ont à se vendre, à nous convaincre qu’ils veulent venir chez nous et qu’ils veulent vraiment faire du renseignement clandestin. [Car] c’est quelque chose qui demande beaucoup d’investissement personnel, et nous, on doit être convaincus que ce sont les bonnes personnes, parce qu’on prend des risques avec leur vie. Et on doit être sûrs de leur motivation.
Quand il quitte le commandement du Service clandestin, Patrick a considérablement développé ses activités, lui conférant une place à part entière dans l’organigramme de la DGSE. Quelques temps plus tard, Grégoire s’installe aux commandes, en provenance lui aussi du Service action. Il met en place un nouveau processus de sélection car, selon les souhaits de rationalisation du nouveau directeur des opérations, le général Champtiaux, le Service clandestin change de nature. L’effectif des officiers traitants va croître, même si ce constat peut être trompeur. Avec Patrick, le Service clandestin comptait en effet moins d’officiers traitants, mais plus d’agents, c’est-à-dire des personnes n’appartenant pas à la DGSE, mais collectant du renseignement, en général, contre rémunération. C’est ce qui lui a permis de se placer en de multiples points chauds de la planète. En quelque sorte, en accédant au commandement, Grégoire a charge de consolider, puis d’agrandir, une maison dont les fondations et les premiers étages ont été bâtis par Patrick, ainsi que par son prédécesseur.
Grégoire : Le DO [27] Directeur des opérations.
, je le découvrirai plus tard, a déjà dans la tête d’en développer les capacités car il a conscience que le renseignement clandestin est […] un savoir-faire d’avenir. Préalablement, j’aurai beaucoup discuté avec [lui] car c’est lui qui aura décidé de cette impulsion en accord avec le directeur général. Il me demandera de réaliser un plan d’action pour la montée en puissance de ce service, d’essayer d’en estimer un volume définitif en termes d’effectif, d’évaluer un budget de fonctionnement. À partir de là, il me donne carte blanche dans tous les domaines […] — finance, administration, soutien, opérations. Je mettrai pratiquement trois ans pour arriver au format définitif.
JCN : Pour quel type de poste cherchez-vous à recruter ?
Grégoire : Il y a deux types d’emplois au sein de ce Service clandestin. Les chefs de mission, qui sont plutôt des militaires, avec une expérience opérationnelle, sont destinés à traiter les dossiers déjà existants, les missions de contact avec des chefs de groupes armés ou de factions. Et les officiers traitants qui, eux, sont destinés aux missions strictement clandestines. Les premiers pourront, le cas échéant, être connus comme des agents de la DGSE par leurs interlocuteurs ou, en tout cas, une partie d’entre eux. Les seconds ne se dévoileront jamais. Deux profils totalement différents qui requièrent des qualités spécifiques. Le recrutement des chefs de mission se fait principalement chez les militaires qui sont déjà à la DGSE ou qui y entrent, [sur] des critères classiques de connaissance des théâtres d’opérations extérieures, d’habitudes de vie dans des conditions difficiles.
Patrick : L’intérêt du Service clandestin, c’est qu’il est à la frontière de deux origines différentes : les militaires du Service action et le savoir-faire du milieu civil. Ce creuset est excellent parce que c’est un mariage : chacun apporte à l’autre des connaissances différentes et ça donne plus de force dans la formation des officiers du Service clandestin.
Fabrice : Au début des années 1990, des masses de civils sont entrées, bien sûr issues essentiellement des sciences politiques. Elles vont participer à changer l’ADN du service. Ces jeunes civils vont monter dans les échelons et donner une nouvelle façon de travailler, plus adaptée au monde d’aujourd’hui parce que la chute de l’Union soviétique a totalement rebattu les cartes. C’est tellement flou, tellement multipolaire que le renseignement en tant que tel doit donner à l’exécutif des guides, des informations pour prendre des décisions. Ce service a été très longtemps militarisé, en tout cas dans les hauts échelons, et ça donnait une culture relativement homogène. Trop homogène. Au contraire, il faut donner des points de vue très différents, il faut avoir des cultures très différentes. Et en un sens, il faut accepter d’être l’avocat du diable et de porter une voix différente de ce qu’auraient envie d’entendre nos maîtres politiques.
Norman : Bien souvent, les militaires ne s’adaptent pas aussi facilement que les civils sur le terrain.
François : Le métier de renseignement n’est pas l’apanage militaire, bien au contraire. Les recrutements à la DGSE sont de deux tiers de civils pour un tiers de militaires. Mais le fait d’avoir une formation militaire est à mon sens un atout supplémentaire puisqu’il apporte toute la rigueur nécessaire au processus, à la méthode de raisonnement. Il y a une chose qui est très bien faite dans nos armées, c’est la méthode de raisonnement tactique. C’est une méthode de raisonnement militaire, mais elle est [surtout] managériale. Elle permet de prendre en compte l’état des lieux, la menace, le terrain, les contraintes et, en fonction de tous ces paramètres, cette méthode amène à prendre la bonne décision. Je n’ai pas cessé de l’employer.
Grégoire : Ce qui prévaut pour le recrutement d’un OT, c’est la facilité [de] pouvoir construire une légende. D’une manière synthétique, il est plus simple de construire une légende pour quelqu’un qui a 26–27 ans, et qui sort d’études supérieures, que pour quelqu’un qui a 30–35 ans, un passé militaire bien étoffé. Pour les OT, on va donc chercher des jeunes qui ont le niveau d’études suffisant, mais généralement c’est le cas puisque [c’est] le réservoir des gens qui ont présenté le concours de la DGSE. On va chercher des gens qui ont déjà une expérience de l’étranger car ils sont issus d’une famille qui a vécu en expatriation pendant des années. Et on va chercher des gens qui ont des savoir-faire ou des expériences exploitables pour le service. Il y a [par exemple] des jeunes en marge de leurs études qui travaillent comme journalistes à la petite semaine. C’est typiquement le genre d’expériences qui nous intéresse. D’autres qui sont investis dans l’humanitaire, ou tout simplement ils ont des savoir-faire techniques — je vais prendre l’exemple de quelqu’un qui est passionné de photo.
Читать дальше