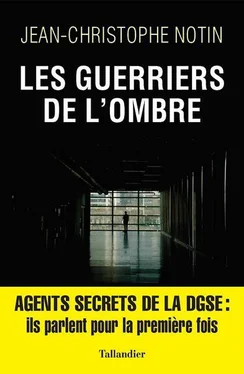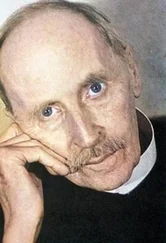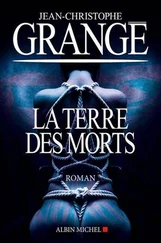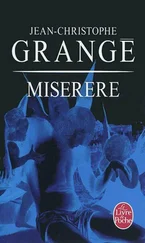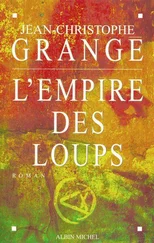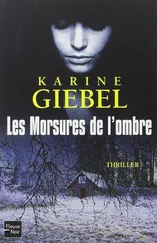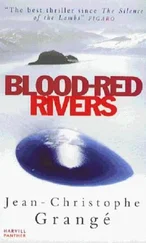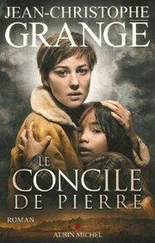Fabrice : La règle était tacite : si vous avez des relations intimes, c’est votre problème, mais il est évident […] qu’il ne faut pas qu’elles aient connaissance de la seconde vie… Et c’est tout le risque : plus on va dans l’intimité, plus on a envie de partager. C’est un risque personnel, évident, et, par pudibonderie ou par frilosité, ce n’est pas un risque très identifié et très détaillé, et très pris en compte au départ. En fait, on nous jette un peu dans le bain, et on nous parle de communication, de sécurité, de ceci, de cela, mais ça, c’est mis un peu de travers. Comme si les hommes et les femmes […] clandestins étaient des anges dénués de sexe, alors que par définition, quand on est clandestin, la dose d’adrénaline est très supérieure à ce qu’on a globalement dans le quotidien lorsqu’on prend le métro parisien…
Patrick : Les failles font partie des risques inhérents à la vie de clandestin. Il peut y avoir d’autres relations, liées à l’argent, à d’autres choses… Je pense que le gros avantage d’un agent clandestin, c’est qu’on lui fait confiance, parce qu’on est sûr de lui au départ, parce qu’on l’a testé. Après, cette confiance peut être trahie, et à nous de savoir évaluer et jauger le risque de trahison […].
Victor : La difficulté, c’est qu’une fois qu’on a déconseillé [aux] gens de le faire, s’ils le font, ils se sentent un peu en faute. Donc, il y a ceux qui ne disent rien et si ça se passe bien, personne n’est au courant. Il y a ceux qui s’aperçoivent qu’ils ont peut-être un peu merdé, donc ils vont en parler, car ils se disent que, peut-être, ça engage la sécurité de la mission, donc la leur, donc celle d’autres personnes. Et puis, il y a ceux qui ne gèrent plus rien du tout, et à qui ça fait commettre des fautes. Là, ça remonte plus ou moins rapidement au service, et forcément, ça ne se passe pas bien…
Grégoire : J’ai été confronté à des cas où un OT pouvait se retrouver dans une situation difficile parce qu’on avait su par une indiscrétion qu’il avait une liaison avec une personne locale. J’ai dû monter au créneau, en disant qu’annuler une mission qui fonctionne bien, parce qu’il y a eu soi-disant une erreur de comportement, que je ne considère pas, moi, comme une erreur, ça serait aberrant et ça mettrait encore plus en danger nos OT car on ne peut pas plier une structure du jour au lendemain, sans raison.
JCN : Cela lui a coûté cher, à l’OT en question ?
Grégoire : Ça lui a coûté en termes de carrière, oui.
JCN : Ça fait donc quand même partie de ce qui est considéré à la DGSE comme une faute.
Grégoire : Absolument. En tout cas, pour les autorités. Mais pas pour moi.
Fabrice : C’est arrivé plusieurs fois, ce cas où des [OT] ont rencontré des gens sur le terrain et ont dit : « Bon, j’arrête, parce que je ne peux pas vivre cette vie clandestine avec ma future épouse, et donc il faut que je me mette dans une seule existence, et rompre avec cette schizophrénie. » J’ai au moins deux cas de figure où ils ont arrêté leur travail de clandestin parce que, finalement, ce n’était pas compatible avec les personnes qu’ils avaient rencontrées sur place. De toute façon, notre service de sécurité interne était perturbé par cette situation, donc ça arrangeait tout le monde.
Hervé : Je pense que la moralité du personnel est à l’image de la société dans laquelle on vit […]. Tout dépend [de l’endroit] où l’État place la barrière de la moralité au regard de l’intérêt supérieur de la Nation. En tout cas, en France, on est dans un pays démocratique, et je pense que les pays démocratiques qui utilisent les clandestins les utilisent dans un mode assez similaire au nôtre […]. Je suis moins catégorique sur ce que peuvent faire par exemple les Russes, mais on le voit aussi avec les mouvements terroristes qui utilisent des techniques assez semblables à celles des clandestins.
Patrick : Nous, on n’est pas là non plus pour donner des leçons de morale. Je ne me sens pas l’âme d’un père de famille ou d’un aumônier. Je considère que la formation est telle dans les services que tout a été déjà vu de ce côté-là. On n’a pas de conseils à donner, ça fait partie de l’essence même de l’agent clandestin d’avoir un comportement adapté à sa mission. Donc, on laisse tomber tout l’aspect moralité et, en revanche, on s’assure que la mission est bien assimilée et que les points qui sont demandés seront bien étudiés et transmis par l’agent. Ensuite, sur le terrain, on est seul, livré à soi-même, c’est pour ça que la sélection est importante car les tentations existent.
Sandra : La moralité est propre à chacun. Chacun respecte les valeurs qu’il se donne, mais c’est d’abord une question de sécurité pour la mission. Il faut connaître les limites, et savoir où s’arrêter pour ne pas griller la couverture. Donc, on dose, on essaye certaines choses…
Hervé : Je pense qu’il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Dans les relations professionnelles, vous n’êtes pas obligé de franchir la moralité en permanence. Il n’y a pas une seule bonne solution, il y en a de multiples, certaines qui sont plus faciles que d’autres, certaines qui sont plus morales que d’autres. Après, c’est à chacun de voir où il place le curseur. La moralité pour moi, c’est un faux débat. Ceux qui invoquent ça pour franchir la ligne jaune, c’est souvent parce qu’ils en ont envie [ Hervé sourit ]… En tout cas, il n’y a pas de consignes, en disant que tous les moyens sont bons. Non, ce n’est pas vrai, tous les moyens ne sont pas bons. On est là pour recueillir du renseignement. On n’est pas là pour forcer quelqu’un à le donner. Au contraire, c’est vraiment à l’antithèse du Service clandestin qui agit par la ruse. Et la ruse est souvent intellectuelle. Elle ne passe pas par le sexe, ou par la contrainte.
JCN : Quelles sont les ficelles utilisées pour obtenir du renseignement ?
Daniel : La première qualité pour un officier traitant, ça va être l’empathie, c’est-à-dire attirer la confiance, que les gens aient envie de discuter, qu’il y ait un échange.
Vincent : Le traitement de sources humaines oblige à comprendre l’autre. On ne peut pas juste lui imposer sa volonté. Il faut parler, manger, travailler avec lui.
Daniel : Les Anglo-Saxons ont une terminologie bien connue : le MICE.
Norman : M comme money . La source, on la recrute, et on la rémunère, c’est un des facteurs de motivation […]. La plupart des sources sont rémunérées, pour les tenir, si j’ose dire un peu trivialement, pour les fidéliser.
Michel : Il n’y a pas une somme qui part d’un OT vers une source, normalement, sans que ça soit répertorié à la centrale par un compte rendu, et normalement l’OT doit faire signer un reçu. Le reçu peut évoquer une raison bidon, mais il doit y avoir un reçu. Dans certains cas extrêmes, si la source est vraiment très importante, et refuse, on peut s’en affranchir, mais c’est très mal vu. L’argent est incontournable, quoi qu’on en dise. Il faut bien penser que, dans beaucoup de pays où nous opérons, les gens ont un niveau de vie de 20 dollars par mois.
Daniel : L’argent, ça attire toujours maintenant il faut éviter de faire de votre source, pardonnez-moi l’expression, mais un bon fonctionnaire. Parce que le renseignement sera forcément moins bon, il va s’habituer, et être enchanté de récupérer de façon régulière de l’argent, mais le renseignement risque d’être de moins bonne qualité. Si le renseignement est bon, on paye, s’il est moins bon, on paye moins ou on ne paye pas.
Читать дальше