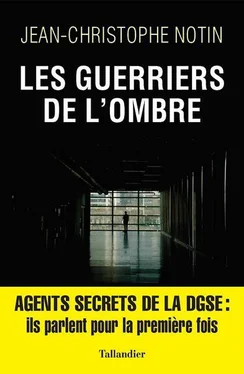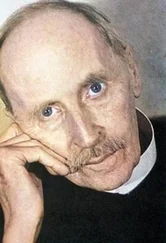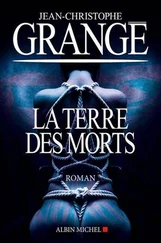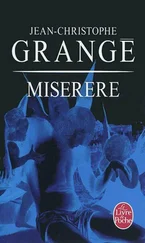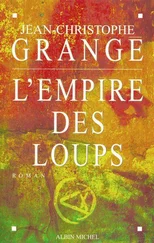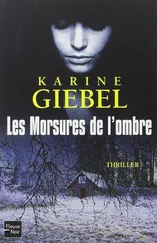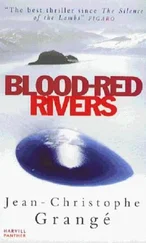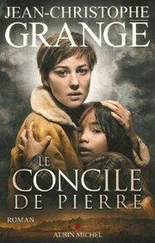Grégoire : Dans 80 à 90 % des cas, les candidats acceptent sans en savoir plus.
JCN : Que disent ceux qui refusent ?
Grégoire : Généralement, [ce] sont des gens honnêtes, qui disent : « Je ne me sens pas la capacité de mener ce type de travail, je préfère commencer sur des postes plus conventionnels, quitte ensuite à commencer à m’intéresser à ces filières-là si on m’en redonne l’opportunité. »
Sandra : Un jour, on m’appelle, on me dit : « Tiens, il y a quelqu’un qui veut te rencontrer pour te proposer un job. » Donc moi, oui, OK, pas de problèmes, je suis curieuse […]. J’y suis allée, et là, le chef de l’unité clandestine me dit : « Voilà, je suis à la tête d’une unité qui fait des choses un peu spéciales. […] Si ça vous intéresse, je vais vous faire rencontrer quelqu’un qui va vous en dire plus. » Je dis : « Oui, forcément, ça m’intéresse, vous ne m’avez rien dit ! » J’ai rencontré une autre agent clandestine qui arrêtait son activité. Du coup, on a eu un long échange toutes les deux, je n’ai même pas eu le temps de déjeuner […]. Elle m’a conseillée d’y réfléchir. J’ai dit : « Ça tombe bien, ce soir, c’est vendredi, et je pars en vacances au ski. » Donc, une petite semaine à la montagne, et j’ai réfléchi… Et en rentrant, j’ai dit banco !
Hervé : Ça va paraître curieux, mais j’ai quasiment signé sans savoir ce que c’était. On connaît [seulement] les buts, on sait que ça va être un service où on joue sans filet, où on n’est pas dans la sécurité d’une couverture diplomatique et où on est envoyé tout seul à l’étranger, plutôt dans des zones de crise ou de précrise avec l’objectif de recueillir du renseignement, mais sans avoir de spécialités. En gros, du renseignement tous azimuts.
Grégoire : Pourquoi ils acceptent ? Parce qu’ils sont brutalement confrontés à une idée qu’ils n’avaient pas eue, à un avenir qu’ils ne s’étaient pas projeté. Ils comprennent de manière un peu brutale que, finalement, on leur demande de devenir un « espion » tel qu’ils ont pu l’imaginer à travers les lectures qu’ils ont pu avoir ou les films qu’ils ont pu voir. […] Donc, il y a à la fois de la fascination et de l’attrait pour un monde qui par définition est mystérieux.
Fabrice : L’homme qui m’a recruté au sein du Service clandestin était un chef de bande, un leader naturel, et il aimait s’entourer de gens qui lui ressemblaient d’une certaine manière, qui étaient compatibles avec sa façon de voir l’« aventure » du renseignement. Et comme souvent les leaders de ce type-là, il adhère ou il n’adhère pas du tout à un type de personnalité. C’était vraiment une intuition personnelle. Il a misé sur moi. Ça a totalement changé mon existence.
VII
À l’improbable nul n’est tenu
Le candidat est dans la salle d’attente de la clandestinité. Mais sera-t-il admis à y pénétrer ? Comme partout, il y a ceux qui espèrent et il y a ceux qui ont. À l’encadrement de retenir les meilleurs — avec d’autant plus d’exigence qu’à la clé d’un éventuel échec dans leur carrière, ce n’est pas le chômage qui les attend, mais une crise internationale, la privation de liberté, voire la mort. Il est dès lors compréhensible que la sélection reste pour bonne part confidentielle. Comme l’explique Sandra, celui qui serait trop préparé à la batterie de tests qui l’attend prendrait un risque avec sa propre vie. Pour autant, le voile peut être légèrement soulevé sans rien compromettre. D’abord, parce que les techniques sont avant tout guidées par le bon sens. Ensuite, parce que la fiction, américaine comme toujours en la matière, s’est déjà longuement penchée sur ce mode de recrutement si singulier.
JCN : À quoi doivent s’attendre les candidats au Service clandestin ?
Grégoire : On commence par les convoquer dans des créneaux de dates qui leur conviennent. Comme cela se passe pendant les vacances scolaires, ils ont fini leur cycle d’études, ils sont donc disponibles. On les convoque à Paris, on leur loue un hôtel, sous leur nom bien sûr, et ensuite, on entre, pour une période de quinze jours à trois semaines, dans la partie évaluation du candidat. J’ai préalablement travaillé à [des] tests à travers mon expérience du SA qui [les] pratique, mais d’une autre manière, et aussi avec une des psychologues du service qui, pour les besoins de la cause, m’a été détachée. Les tests consistent en deux parties distinctes. Une première partie est simplement une évaluation psychologique, à travers des tests concoctés par la psy, en fonction des qualités que je souhaitais trouver chez des candidats, ou des défauts que je souhaitais à tout prix éviter. Ces tests durent deux à trois jours.
Daniel : Les tests psychologiques tournent autour d’entretiens, d’une batterie importante de tests écrits qui permettent de recouper votre profil, vos vulnérabilités éventuellement, vos atouts. Il ne s’agit pas d’avoir un profil totalement linéaire, c’est intéressant pour un clandestin d’avoir quelque chose, je dirais, d’un peu hétérogène.
Grégoire : À partir des résultats de ces tests, la psychologue va remplir une grille avec une graduation de 1 à 5 pour affiner le profil psychologique des candidats. Il est à noter que, pour la partie terrain, l’instructeur disposera de la même grille. Au terme de la sélection, on superpose[ra] les deux grilles, psychologique et tests terrain, pour déterminer le profil de chacun des candidats.
François : On vient voir à qui on a affaire, ce qu’il y a derrière l’individu. Est-ce qu’il est fragile ? Est-ce qu’il tient la route ? Est-ce que ce qu’il demande est une façade ? Est-ce que ça a un sens ? Est-ce que c’est construit […] ? C’est comme un recrutement dans le domaine du privé, on vient voir pourquoi, tel jour, telle date, à tel endroit, telle personne veut telle chose.
JCN : Quelles qualités sont recherchées en priorité ?
Patrick : La conviction que la personne que l’on a en face de soi aura la capacité de travailler seule dans un contexte difficile. On le sent, on peut voir si quelqu’un a déjà en lui-même sa propre synergie, s’il n’a pas besoin de compter sur les autres. D’autant plus que quand on les reçoit, on est cash. On n’est pas là pour vendre quoi que ce soit, mais plus pour montrer les mauvais côtés, les risques que représente l’action clandestine. Ensuite, il y a un sujet très important, essentiel, qu’on appelle l’honnêteté intellectuelle. Ça se teste, on voit tout de suite si on a affaire à quelqu’un qui est en surrégime ou qui est trop renfermé sur [lui]-même, qui ne pourra pas s’exprimer. Cette capacité à se mouvoir et à être inaperçu — l’anti-James Bond, je dirais.
Norman : Dans l’action, on ne demande pas à l’OT de raconter sa vie, par contre quand on fait de la recherche au niveau du renseignement, et que l’on veut recruter des sources, il faut parler, s’exposer à la source, lui plaire, donc il faut être plutôt extraverti qu’introverti.
Grégoire : On ne veut pas de tricheurs, de menteurs, [mais] des gens qui ont une résistance solide au stress…
Patrick : Il faut être relax, calme et détendu. Quelqu’un qui est stressé, mégalo, qui se met la pression tout seul, ça ne nous intéresse pas.
JCN : L’absence d’expérience dans un théâtre de crise est-elle un handicap ?
Grégoire : Non. La mise en opération de l’OT se fera de manière progressive. On commencera par des missions « soft », dans des environnements à moindre risque, et graduellement, quand il prendra confiance en lui, on l’engagera dans des théâtres d’opération de plus en plus difficiles.
Читать дальше