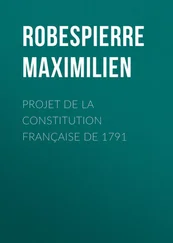Santé, vivacité, surprise, danse, et toutes les combinaisons possibles. En bref je suis cochon ! Et je consomme peu hélas, concentré comme je suis sur mon terrible boulot si sérieux — malgré moi , scrupuleux — féroce à ma tâche. J’ai toujours aimé que les femmes soient belles et lesbiennes. Bien agréables à regarder et ne me fatiguant point de leurs appels sexuels ! Qu’elles se régalent, se broutent, se dévorent, moi voyeur. Cela me chaut ! et parfaitement ! et depuis toujours ! Voyeur certes et enthousiaste consommateur un petit peu mais bien discret. [30] Louis-Ferdinand Céline, Lettres à la N.R.F., Choix 1931–1961, Édition de Pascal Fouché, Préface de Philippe Sollers, Folio, Gallimard, 2011.
Revient alors la question obsédante. Comment un tel génie a pu être traversé par la passion la plus morbide, la plus absurde, la plus criminelle qui soit ? Comment une telle intelligence a-t-elle pu céder ainsi à la bêtise destructrice ? Comment associer tant de finesse, de délicatesse aux délires macabres et dégradants des pamphlets ? Mon psychanalyste, un jour, m’a aidé à percer le secret de l’antisémitisme de Céline. Il le reliait à son immense orgueil : « Comme il voulait être le seul véritable écrivain de son siècle, m’a-t-il expliqué, il voulait être le seul juif. »
S’il n’est pas le seul écrivain de son siècle, il le surplombe. Pourquoi ? Il a su déjouer les conventions des plumitifs, en restituant l’émotion de la langue parlée dans le langage écrit. Et il y est parvenu : c’est un événement colossal. Nietzsche dit : « Un jour s’attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. » Céline réalise cette prédiction en pulvérisant la langue des littéraires pour imposer sa poésie. Il écrit lui-même à Gaston Gallimard, lors de l’envoi du manuscrit du Voyage : « Voilà du pain pour un siècle entier de littérature. » [31] Louis-Ferdinand Céline, Lettres, op. cit.
Il a compris que la langue écrite détruisait l’émotion, comme l’avait senti avant lui Paul Valéry quand il avait écrit cette phrase magnifique :
Longtemps, longtemps la voix humaine fut base et condition de la littérature. La présence de la voix explique la littérature première, d’où la langue classique prit forme, cet admirable tempérament. […] Un jour vint où l’on sut lire des yeux sans entendre, sans épeler, et la littérature en fut tout altérée. [32] Paul Valéry, Tel quel, Folio essais, Gallimard, 1996, p. 133.
Céline n’a qu’un souci : aller au nerf, mettre sa peau sur la table ; il s’interdit toute introspection pour atteindre à un immense lyrisme cinématographique. Il parvient à traduire la poésie des choses dans le langage de la rue :
J’ai pris sur ma droite une autre rue, mieux éclairée, « Broadway » qu’elle s’appelait. Le nom je l’ai lu sur une plaque. Bien au-dessus des derniers étages, en haut, restait du jour avec des mouettes et des morceaux du ciel. Nous on avançait dans la lueur d’en bas […]. [33] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 192, 236 et 10.
Céline n’est pas un écrivain de plus. Il n’appartient pas à la bande littéraire. Et pourtant il a inventé une forme nouvelle de littérature. Il a découvert bien avant Duras la force poétique de la répétition. « Des années ont passé depuis ce départ et puis des années encore… » Céline reprend le même mot, de façon incantatoire, il le prolonge sans but. « Il y en avait des patriotes ! Et puis il s’est mis à y en avoir moins des patriotes… » Il appartient au petit nombre de ceux dont la manière a provoqué un séisme dans l’histoire des lettres.
Il est au cœur de mon dernier spectacle, Poésie ? . Le point de rencontre entre les vers et la prose. On n’a rien dit tant qu’on n’a pas compris qu’il fut d’abord un immense poète, d’une dimension véritablement prophétique. Il renouvelle la manière dont une phrase est construite à tel point que l’on reconnaît d’emblée sa musique. Qu’elle ne ressemble à aucune autre. Voyez la familiarité, le naturel absolu du portrait du toubib de Mort à crédit :
Gustin Sabayot, sans lui faire de tort, je peux bien répéter quand même qu’il s’arrachait pas les cheveux à propos des diagnostics. C’est sur les nuages qu’il s’orientait.
En quittant de chez lui il regardait d’abord tout en haut : « Ferdinand, qu’il me faisait, aujourd’hui ça sera sûrement des rhumatismes ! […] » Il lisait tout ça dans le ciel. […]
Si c’est moi qui commandais, je ferais les ordonnances dans mon lit !… […] Ils vomiront pas davantage, ils seront pas moins jaunes, ni moins rouges, ni moins pâles, ni moins cons… [34] Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit, op. cit., p. 22–23.
D’autres fois, sa langue atteint au contraire à une sophistication, une préciosité inouïes. Ainsi de sa description du bordel de Detroit :
Il me fallait, le soir venu, les promiscuités érotiques de ces splendides accueillantes pour me refaire une âme. Le cinéma ne me suffisait plus, antidote bénin, sans effet réel contre l’atrocité matérielle de l’usine. Il fallait recourir, pour durer encore, aux grands toniques débraillés, aux drastiques vitaux. [35] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 227.
Tout est dans le contraste. Quand on lit les autres, à côté, on s’aperçoit qu’il a accompli quelque chose qui s’apparente à une révolution.
Nihiliste, Céline ? En vérité, sur l’homme, il ment tout le temps. Mais il ment pour arriver à la vérité. Non pas la vérité de l’anecdote, mais la vérité profonde qui se cache derrière les apparences. Il hait ce qu’il appelle le « sentimentalisme bidet ». Il le trouve obscène. Il déteste la joie. En prison, ça a de la tenue, mais la fête à Neu-Neu le fait frémir. L’homme est pour lui une pourriture habitée par un rêve. Il n’est pas optimiste. Il n’aime pas la nature humaine. L’humanité qu’il peint est généralement ignoble. Sa tendance à noircir tient parfois du système. Mais le génie de sa langue n’en parvient pas moins à rendre lumineuse jusqu’à l’expression de son ressentiment. La verdeur de son style vient mettre de la lumière dans la noirceur de ses tableaux. Je le disais plus haut, il faut le répéter : en étant dur avec les pauvres, en faisant part de sa découverte, qui est que les pauvres ne valent au fond pas mieux que les riches, il leur redonne une dignité bien plus grande que ceux qui se penchent sur eux avec compassion. Il ne les domine pas de sa pitié :
L’été aussi tout sentait fort. Il n’y avait plus d’air dans la cour, rien que des odeurs. C’est celle du chou-fleur qui l’emporte et facilement sur toutes les autres. Un chou-fleur vaut dix cabinets, même s’ils débordent. C’est entendu. Ceux du deuxième débordaient souvent. La concierge du 8, la mère Cézanne, arrivait alors avec son jonc trifouilleur. Je l’observais à s’escrimer. C’est comme ça que nous finîmes par avoir des conversations. [36] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 268.
Un humaniste se serait lamenté sur la dureté de la condition de la pauvre concierge. Lui préfère imaginer que le spectacle de ses efforts pour déboucher les cabinets l’a amené à lier la conversation avec elle. C’est comme cela qu’il manifeste son respect pour les pauvres. Ses romans ne sont pas exempts non plus de moments de grande tendresse. Seulement il la réserve aux animaux et aux enfants.
Tant qu’il faut aimer quelque chose, on risque moins avec les enfants qu’avec les hommes, on a au moins l’excuse d’espérer qu’ils seront moins carnes que nous autres plus tard. On ne savait pas. [37] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 242.
Читать дальше
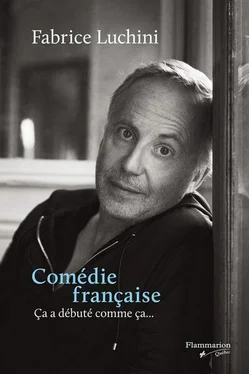
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)