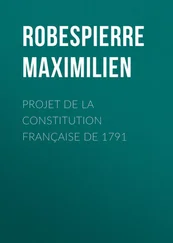Première fois de ma vie dans une maison vraiment faite pour les gens du CAC 40. Révélation banale de l’éblouissement de ce pays, donc de la Grèce. Les îles. L’éblouissement du bleu. « Elle est retrouvée ! / Quoi ? L’Éternité. / C’est la mer allée / Avec le soleil. » Et pourtant ce n’est pas ça qui pourrait préciser la sensation spécifique. On pourrait tenter plein de choses, au fond, c’est une question de vent. Comme si l’air harmonisait tous les éléments. Les bleus sont réunis ? Pas fameux… Je vais travailler sur Céline.
Ah, si ! On peut dire le scooter. Le concept du scooter. La révélation grecque par la force du scooter. Grâce à lui, on s’insinue, jamais coupé, on fusionne. On est rempli d’air, d’images, de vent, de puissances évocatrices. Pas d’erreur. C’est par le scooter que s’est imposée la beauté grecque. Comme disait Rimbaud : « Si j’ai du goût, ce n’est guère / que pour la terre et les pierres. / Je déjeune toujours d’air, / de roc, de charbon, de fer. »
Allons-y, je passe à Céline.
Chapitre 4
La tante à Bébert
J’ai dit des milliers de fois Céline sur scène. Une fois dans ma loge, ou au restaurant après le spectacle, reviennent le plus souvent les mêmes indignations, les mêmes enthousiasmes, les mêmes paradoxes. Soit on vous dit qu’il est un génie, soit que c’est un salaud. Soit que c’est un salaud génial, ou alors un monstre prodigieux.
On peut aussi s’accrocher aux considérations des écrivains sur son œuvre. Ce n’est quand même pas rien. Simone de Beauvoir : « Son anarchisme nous semblait proche du nôtre. » Malraux : « Un pauvre type et un grand écrivain. » Gide : « Ce n’est pas la réalité que peint Céline. C’est l’hallucination que la réalité provoque. » Giono : « Très intéressant, mais de parti pris. Et artificiel. Si Céline avait vraiment pensé ce qu’il écrit, il se serait suicidé. » Lévi-Strauss : « Proust et Céline : voilà tout mon bonheur inépuisable de lecteur. » Jack Kerouac : « Un écrivain de grand charme, d’un charme et d’une intelligence suprême que personne n’a pu égaler. » [18] Simone de Beauvoir, La Force des choses, Folio, Gallimard, 1972. André Malraux, Lettre à Gaston Gallimard, citée dans le Dictionnaire Malraux, CNRS éditions, 2011, p. 142. André Gide, « Les juifs, Céline et Maritain », La Nouvelle Revue française, avril 1938. Jean Giono, Propos rapportés par un journaliste, Le Petit Marseillais, janvier 1933. Claude Lévi-Strauss, Interview, novembre 1990.
On évoque les condamnations historiques : un antisémite monstrueux, un collaborateur de la pire espèce. Tout cela est vrai. Morales : un nihiliste, un comédien, un pervers. Tout n’est pas faux. Littéraires : un écrivain surévalué. Un faiseur. À voir.
Avec Céline, les réactions émotionnelles l’emportent toujours et l’on ne sait pas plus à la fin de la conversation de quoi il est question.
La critique la plus stimulante m’est venue de gens conséquents, certifiés, bienveillants qui auraient aimé partager mon enthousiasme. « La petite musique », ils disent l’avoir entendue. La puissance d’évocation ne leur a pas échappé à l’écoute de l’arrivée à New York :
Pour une surprise, c’en fut une. À travers la brume, c’était tellement étonnant ce qu’on découvrait soudain que nous nous refusâmes d’abord à y croire et puis tout de même quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu’on était on s’est mis à bien rigoler, en voyant ça, droit devant nous…
Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New York c’est une ville debout. On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des belles encore, et des ports et des fameux même. Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s’allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur.
Ils ont classé Céline dans la catégorie des romanciers populaires, noirs, ingénieux peut-être mais un grand poète, non, il ne faut quand même pas exagérer ! Une phrase, une seule nous sépare. Elle me hante depuis des décennies parce qu’elle concentre en elle tout le génie de l’écrivain. Elle leur apparaît quelconque. Ils trouvent même que je dramatise. C’est une phrase du Voyage , l’installation du docteur Destouches en banlieue. « La tante à Bébert rentrait des commissions. »
« La tante à Bébert rentrait des commissions. » De quelle musique on parle ? De quelle émotion ? « La tante à Bébert rentrait des commissions » : on ne voit rien. Le style de Céline n’est pas repérable. C’est la spécificité et la nature singulière de sa drague. Roland Barthes décrit l’espace de séduction entre l’écrit et le lecteur. Celui de Céline est très particulier. On l’a appelé le « métro émotionnel ». Mais d’où vient cette émotion ? Est-ce ce balancement continuel entre l’anecdotique et l’universel, le minimalisme absolu et la métaphysique ?
Pour bien comprendre, il faut rappeler à quel moment arrive ce petit tableau : « La tante à Bébert rentrait des commissions. » Le médecin sort d’un avortement. Une scène épouvantable. La fille est en sang, la mère gueule. Le narrateur observe la présence du père et à travers lui Céline photographie de manière définitive la condition masculine :
Dans la petite salle à manger d’à côté, nous apercevions le père qui allait de long en large. Lui ne devait pas avoir son attitude prête encore pour la circonstance. Peut-être attendait-il que les événements se précisassent avant de se choisir un maintien. Il demeurait dans des sortes de limbes. Les êtres vont d’une comédie vers une autre. Entre-temps la pièce n’est pas montée, ils n’en discernent pas encore les contours, leur rôle propice, alors ils restent là, les bras ballants, devant l’événement, les instincts repliés comme un parapluie, branlochants d’incohérence, réduits à eux-mêmes, c’est-à-dire à rien. Vaches sans train. [19] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 260–261.
Bardamu, le héros, sort de cette scène d’une profondeur inouïe et il croise Bébert. Une rencontre anodine (un gosse dans la rue) qui provoque une profonde méditation. Voici ce qu’il dit au sujet de cet enfant :
Sur sa face livide dansotait cet infini petit sourire d’affection pure que je n’ai jamais pu oublier. Une gaieté pour l’univers. [20] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 243.
En sortant de l’horreur et de la mort, c’est un espoir qu’il définit :
Peu d’êtres en ont encore un petit peu après les vingt ans passés de cette affection facile, celle des bêtes. [21] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 242.
« Peu d’êtres en ont encore un peu » : c’est fabuleux. Dans ce « peu » est récolté l’infini qui est apparu quelques secondes avant dans le sourire de Bébert. « Peu d’êtres en ont encore un peu. » Une phrase banale mais nourrie, animée au sens propre : une âme y flotte. « Peu d’êtres en ont encore un peu. » C’est organique. Il y a tout. Il minimise pour que ça devienne un sac lourd. Il ne prend même pas la peine de nous dire ce que les êtres n’ont plus à 20 ans passés.
Reprenons. On croise un enfant. Un sourire infini. Ça pourrait presque friser la grandiloquence. Le gosse, la face livide, qui sourit comme un ange, c’est beau mais d’autres écrivains — Charles Dickens, Alphonse Daudet — en ont décrit avant lui. Mais Céline ne s’arrête pas là, il nous emmène autre part. À notre condition d’adulte. Par le négatif et le minimalisme. « Peu d’êtres en ont encore un peu. » Il s’approche de la puissance de l’émotion directe. Par l’oralité, il nous fait éprouver la largeur du contexte qu’il a commencé à finaliser. « Peu d’êtres en ont encore un peu . » Il y a deux « peu ». Il aime répéter ces mots très communs. « Peu », « quelque » : « Il m’aurait intéressé de savoir si elle pensait quelquefois à quelque chose », écrit-il ailleurs dans le Voyage .
Читать дальше
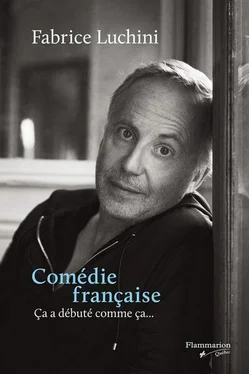
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)