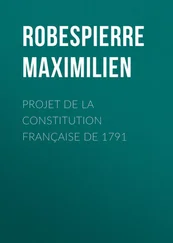Non, le génie de La Fontaine c’est d’avoir créé, plutôt retrouvé le mouvement. Un magicien habile ? Non plus. Un adaptateur ? C’est ça, un adaptateur. Un adaptateur. Partant du marbre figé, il réalise un miracle et ce miracle c’est la langue ! Et, tant que j’y suis, je tente une hypothèse. Céline sort tout droit de ça… Céline sort de La Fontaine. Des années que je cherche d’où vient Céline. Il vient de là : « J’ai lu dans quelque endroit qu’un meunier et son fils… »
J’en suis là quand Bruno Le Maire, la quarantaine éclatante, vient nous saluer. On parle fables, « Le Loup et le Chien », plus précisément : « Un loup n’avait que les os et la peau… », dit-il. Je lui dis que sa diction ne va pas. Il le reconnaît. Je l’invite au théâtre. À quelques mètres de là, entrent un technicien, un producteur, et je reconnais Denis Podalydès et Jean-Louis Trintignant. Le visage austère, le comédien est là comme un parrain sicilien, entouré de ceux qui veulent faire avec lui un gros coup.
Je pourrais faire un simple sourire, un geste de la main. Montrer comme la duchesse de Guermantes que je les ai vus mais que je ne les dérangerai pas. La grande distinction aurait été de ne pas les déranger. J’aurais pu être énigmatique. Ils m’attirent pourtant. Nous sommes tous trois comédiens et la corporation m’aimante. C’est fraternel. C’est comme ça. Je viens les saluer. Je suis comme au foyer. Un foyer sec, mais au foyer. Il n’y a pas d’accueil immense, mais pas d’hostilité non plus.
« Et toi, qu’est-ce que tu fais en ce moment ? », ils me demandent. La magie de Paris ! Je suis sur scène depuis six mois. À la une des journaux. Matinale de France Inter et « 20 heures » de France 2, mais ça ne compte pas. « Et toi, qu’est-ce que tu fais en ce moment ? » C’est Paris ! C’est fabuleux ! Tu peux remplir l’Olympia pendant un an, être sur des affiches en « quatre par trois » et tous les soirs à la télé, on continuera à te demander : « Et toi, qu’est-ce que tu fais en ce moment ? » Je pense chaque fois à cette réponse de Cioran ; à la question « qu’est-ce que vous préparez ? » il répondait : « J’aurais envie de leur foutre mon poing dans la gueule. Est-ce que j’ai une tête à préparer quelque chose ? »
Je leur restitue le travail que je fais. Je leur parle des auteurs. Je sens que je brutalise l’ordre des choses. Il prend une clope, Trintignant, et il sort dans la rue. Je l’accompagne. On s’assoit et j’ai la présence d’esprit de faire le mec qui s’incruste profondément. Il y a chez moi une attirance pour la famille des acteurs, comme une aimantation pour le foyer partagé par une troupe. Je demande à Jean-Louis Trintignant quand je peux venir lui rendre visite à Uzès. En un mot je leur dis : « Je ne suis pas loin d’être un fâcheux, là. » Et là, ça s’envole…
Je commence à dire Les Fâcheux de Molière (qu’est-ce qui me prend ?) :
Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né,
Pour être de fâcheux toujours assassiné !
Il semble que partout le sort me les adresse,
Et j’en vois, chaque jour, quelque nouvelle espèce.
Mais il n’est rien d’égal au fâcheux d’aujourd’hui. [4] Molière, Les Fâcheux, Acte I, scène 1, Folio théâtre, Gallimard, 2005.
J’y suis. La diction, le rythme, tout. Qu’est-ce que je découvre ? Que la littérature, l’œuvre, la puissance des auteurs n’est pas dans une université séparée de la réalité, elle n’est pas là seulement quand l’acteur est sur scène. Quelle différence entre la scène et la vie ? Je ne juge pas ceux qui passent quatre heures dans leur loge à se concentrer mais moi, j’arrive deux minutes avant l’entrée en scène. Je parle au régisseur d’argent, de politique, de femmes et, quand il faut commencer, j’essaie de lui dire, comme Guitry : « Attends une seconde, j’ai deux mots à leur dire et je reviens tout de suite. » C’est ma méthode.
Ce jour-là, au Montalembert, je récite Molière dans une situation proustienne. Je vois bien que j’insiste, que je m’impose, que je fous presque le bordel. Mais la langue de Molière vient, s’impose. Et c’est le miracle… Quand tu t’accroches au sens organique du texte, ce n’est pas un monologue, c’est de la conversation.
Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence,
Lorsque d’un air bruyant et plein d’extravagance,
Un homme à grands canons est entré brusquement,
En criant : « Holà-ho ! un siège promptement ! »
Quel plaisir de respirer cette langue, de restaurer le sentiment éternel de Molière. Et de découvrir le bonheur du turbo, du parler et en même temps de l’écrit. Et la jouissance de faire croire que l’écrit, c’est de l’organique : la vie. Je ne sais pas ce qu’ils en pensent, eux, le groupe. Ils me prennent peut-être pour un fou de transporter ainsi le cérémonial du théâtre dans le bar de l’hôtel Montalembert.
Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né,
Pour être de fâcheux toujours assassiné !
Il semble que partout le sort me les adresse. [5] Arthur Rimbaud, « Le Bateau ivre », Œuvres I, Poésies, GF, Flammarion, 2004, p. 184.
Quel plaisir de voir entrer cette langue classique dans la vie ordinaire, Molière au Montalembert. Chez lui, tout est senti. Au lieu d’être dans l’Académie, à la Comédie-Française, c’est émis, affirmé, à l’heure du déjeuner, cigarette à la bouche, face à un grand sociétaire de la Comédie-Française et à Jean-Louis Trintignant.
Me voici à nouveau seul. Le Montalembert est déjà loin. Quand je songe à ce technicien, à Denis Podalydès, à Jean-Louis Trintignant, à cette bande, je les envie. Ils forment un groupe et je suis seul. L’hystérie séduit, domine et isole. Tout à l’heure, le petit groupe projetait de monter un spectacle autour du « Bateau ivre ». « Comme je descendais des Fleuves impassibles… » Un spectacle autour du « Bateau ivre » ! Je le joue depuis des mois. J’affirme pourtant avec une absolue certitude que c’est impossible de dire le « Bateau ivre ». J’aurai beau chercher jour et nuit, je m’y épuiserai comme le sculpteur cherche en vain à faire vibrer le marbre. Et encore, le sculpteur a une forme. Le musicien a des notes. Moi je n’ai rien d’autre que des mots agencés. « Comme je descendais des Fleuves impassibles ». Tout ça est physique, organique. « Je ne me sentis plus guidé par les haleurs. » Nous y reviendrons. Trintignant vient de m’envoyer par texto une vidéo où il récite quelques vers de Musset. Quelque chose nous dépasse, c’est la fraternité qui résulte de notre pratique du théâtre. Au fond, j’ai été heureux d’appartenir à une troupe quelques minutes.
Représentation aux Mathurins, grande lassitude. Soirée étrange. Leur attention disparaît au milieu de la pièce. Sentiment que le Rimbaud et le Baudelaire sont très bien passés. Je dirais même que je les ai saisis. J’ose amplifier « Le Bateau ivre ». Il me semble que les évocations et les images surgissent plus facilement pour le public, comme si l’amplitude vocale détachait les images. Avec tout le risque de charger la phrase, et la menace de la boursouflure, que je n’ai pas sentie. Je m’approche lentement d’une exécution plus précise, plus osée. C’est assez miraculeux de voir clair dans un morceau où je ne comprenais rien. Tout s’est bien passé avec les poèmes de l’enfance.
C’est avec Proust que j’ai eu cette sensation d’une marée qui se retire. Ma fatigue. La chaleur. Peut-être mon sentiment du public est-il exacerbé ? Toute la dernière partie, exécution sans magie.
Читать дальше
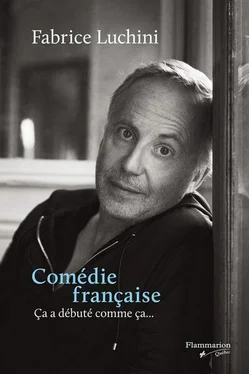
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)