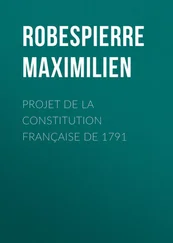Donc, l’avortement, le père qui ne sait pas comment se comporter, la mère qui hurle, un gosse blafard qui sourit comme on ne sait plus le faire, une considération philosophique sur la nature humaine et voilà enfin l’événement considérable : « La tante à Bébert rentrait des commissions. »
Avec ses commissions à la main, avec son cabas, la tante à Bébert balaye la possibilité d’une grandiloquence affirmative. Elle écarte le récit du populisme. On est dans la conversation de bistrot où les choses les plus anodines succèdent aux propos les plus graves. Et Céline invente le gros plan en littérature. On quitte les considérations morales, et tout d’un coup, la caméra s’approche, en gros plan.
« La tante à Bébert rentrait des commissions. » Au fond, c’est un événement. Pourquoi ce ne serait pas un événement ? Faut-il qu’ils soient très chics ces gens pour que ce ne soit pas un événement ? Le CAC 40 s’en fout mais est-ce moins intéressant que « La marquise sortit à cinq heures » ? Céline n’aime pas les pauvres, mais il leur rend leurs lettres de noblesse. Il ne les excuse pas, il ne les aime pas, il se contente de les restituer tels qu’ils sont dans leur petite vie. Encore une fois, c’est dans une conversation orale qu’il nous les raconte. « La tante à Bébert rentrait des commissions. » Sept mots pour un croquis en mouvement. Céline a pris cela à Victor Hugo, capable de créer la tension en écrivant : « Un homme entra… c’était Javert. » Il applique à la lettre la consigne de Flaubert : ne pas s’écrire ! « Surtout, ne pas s’écrire ! » Céline ne s’écrit pas. Sa littérature ne sent pas l’homme du 7 e arrondissement qui raconte ses impressions. Ce n’est pas bourgeois. Il est cinglé, haineux parfois, mais jamais bourgeois.
« Elle avait déjà pris le petit verre », il continue. Longtemps j’ai remplacé « pris » par « bu ». « Elle avait déjà bu le petit verre. » C’est beaucoup moins bien. « Elle avait déjà pris le petit verre. » C’est un autre événement presque à la Rimbaud. Une illumination dont l’objet est le désastre. « Il faut bien dire également qu’elle reniflait un peu l’éther. » Dans le « il faut bien », il y a toute sa perversion efficace, comme si on l’obligeait à préciser une caractéristique de cette femme monstrueuse. « Habitude contractée alors qu’elle servait chez un médecin et qu’elle avait eu si mal aux dents de sagesse. » C’est le toubib qui parle :
Il ne lui en restait plus que deux des dents par-devant, mais elle ne manquait jamais de les brosser. « Quand on est comme moi et qu’on a servi chez un médecin, on connaît l’hygiène. » [22] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 243.
Tout l’humour et la méchanceté de Céline en quelques mots. Il se conduit comme un chirurgien. Il dissèque sans jamais abandonner le bout de barbaque qu’il tient entre ses pinces. Il construit son portrait par une succession prodigieuse de détails pris sur le vif. Un autre se serait perdu dans les considérations sur la misère de la tante à Bébert, sa solitude et sa vieillesse. Céline ne s’attache qu’au concret. Il termine en élargissant l’horizon de cette banlieue, abandonnant le gros plan pour un plan large :
Elle donnait des consultations médicales dans le voisinage et même assez loin jusque sur Bezons.
Il nomme la banlieue, montre des endroits rarement singularisés jusque-là. Tout est habité. Céline jette un regard d’amour sur ce qui, avant lui, était perdu et pas même nommé. Ça n’est jamais solennel. Jamais universitaire. Il touche plus qu’aucun autre au tragique de la condition humaine et on a l’impression qu’il nous parle comme on le fait à un comptoir ou à une terrasse de café. C’est ça, la fameuse émotion de la langue parlée jaillissant dans la langue écrite. Il y parvient par l’alternance, le balancement. Il fait de la dentelle autour du concept comme sa Maman le faisait avec le fil de soie. Une fois la phrase complètement lestée de petits cailloux, il tient une charge énorme. Mais, plutôt que de la montrer glorieusement, il la fait apparaître avec quelques mots banals, des moyens faussement simples. C’est avec une langue apparemment parlée qu’il envoie le paquet.
Par l’insignifiant, il nous donne accès à l’universel. Il alterne de manière incroyablement systématique un détail du réel et une chanson métaphysique. C’est en ça que Voyage au bout de la nuit est une symphonie littéraire plus qu’un roman. Tout comme, en réalité, Céline est sans doute aussi le plus grand cinéaste du XX e siècle.
Je dois reconnaître que la première fois que j’ai eu entre les mains Voyage au bout de la nuit , le roman, la symphonie, la poésie m’étaient absolument étrangers. J’avais 17 ans, j’étais encore un petit coiffeur qui avait quitté l’école à quatorze. J’avais peu lu : L’Attrape-cœurs de Salinger, quelques livres de Freud, auxquels je n’avais pas compris grand-chose, un petit peu de Nietzsche. Je fréquentais un groupe d’intellectuels marginaux, du côté du quartier des Abbesses. Ils lisaient Artaud et Céline. L’un d’entre eux s’appelait Patrick-Jojo. Il était formidablement poétique. Je le croise un soir à Montmartre. La nuit était tombée. Comme un contrebandier il me met un livre entre les mains en me disant : « Tiens. Tu verras. » Sur la couverture vert et noir un personnage, vêtu de blanc, avance comme un somnambule. On peut lire « Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit ». Je le retourne et vois sur la quatrième de couverture : « L’un des cris les plus farouches, les plus insoutenables que l’homme ait jamais poussé. » Signé : Gaëtan Picon. Je l’ouvre et un premier paragraphe me tombe sous les yeux :
J’avais écrit enfin à ma mère. Elle était heureuse de me retrouver ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait aussi sans doute m’aider beaucoup en m’embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne parce qu’elle croyait aux mots qu’on lui disait pour m’enlever. La chienne au moins, ne croit que ce qu’elle sent. […]
Ma mère me reconduisait à l’hôpital en pleurnichant, elle acceptait l’accident de ma mort, non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j’avais autant de résignation qu’elle-même. Elle croyait à la fatalité autant qu’au beau mètre des Arts et Métiers, dont elle m’avait toujours parlé avec respect, parce qu’elle avait appris étant jeune, que celui dont elle se servait dans son commerce de mercerie était la copie scrupuleuse de ce superbe étalon officiel.
[…] Quand il nous restait du temps avant la rentrée du soir, nous allions les regarder avec ma mère, ces drôles de paysans s’acharner à fouiller avec du fer cette chose molle et grenue qu’est la terre, où on met à pourrir les morts et d’où vient le pain quand même. [23] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 94–97.
J’ai eu le sentiment de faire, à cette première lecture, une découverte saisissante. Ça a été le début d’une histoire d’amour et je me suis mis, sans projet préconçu, à apprendre par cœur des passages entiers de ce livre.
Beaucoup plus tard, en 1985, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud m’ont demandé d’interpréter des textes de Céline sur scène. L’idée était d’organiser une rencontre d’une heure entre un comédien et un auteur. J’étais effrayé par l’idée de soumettre la musicalité parfaite de Céline à l’interprétation réductrice, caractérielle, psychologique d’un acteur. Il fallait s’imposer un effort de transparence qui me semblait insurmontable. Ils m’ont incité à essayer au moins pendant une semaine. Le succès a été tel que j’ai joué plus de mille fois ce premier spectacle. J’avais commencé par les chapitres du Voyage sur la banlieue. Dix ans plus tard, j’ai repris le même principe avec le séjour de Bardamu en Amérique, l’arrivée à New York, ainsi qu’avec quelques passages de Mort à crédit , notamment la mort de la concierge. Une des plus belles pages qui aient jamais été écrites :
Читать дальше
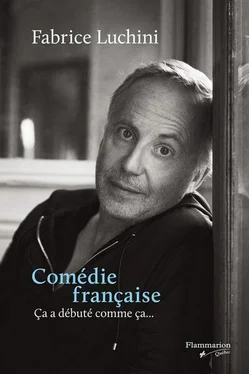
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)