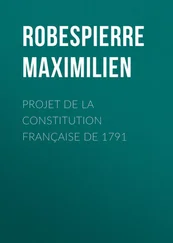Et n’oublions pas ce moment sublime où Bardamu découvre que le sergent Alcide, qui fait trimer les Noirs aux colonies, a accepté de vivre dans cet enfer pour envoyer toutes ses économies à un enfant qui ne lui est presque rien :
Je finis par me relever pour bien regarder ses traits à la lumière. Il dormait comme tout le monde. Il avait l’air bien ordinaire. Ça serait pourtant pas si bête s’il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. [38] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 160.
Le Voyage est un roman dont, pour reprendre l’expression de sa lettre à Gaston Gallimard, « l’amour ne sort pas indemne ». Ça n’interdit pas la sincérité ni l’émotion, comme dans la scène des adieux à Molly, qui est à tirer des larmes :
Bonne, admirable Molly, je veux si elle peut encore me lire, d’un endroit que je ne connais pas, qu’elle sache bien que je n’ai pas changé pour elle, que je l’aime encore et toujours, à ma manière, qu’elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée. Si elle n’est plus belle, eh bien tant pis ! Nous nous arrangerons. J’ai gardé tant de beauté d’elle en moi, si vivace, si chaude que j’en ai bien pour tous les deux et pour au moins vingt ans encore, le temps d’en finir. [39] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 236.
En la quittant absurdement sans cesser de l’aimer, Bardamu montre au fond qu’il ne veut pas être heureux. Céline manifeste à travers lui son refus d’un bonheur bourgeois qui lui aurait coupé les ailes. Il décrit en même temps dans toute sa cruauté la relation amoureuse, en montrant l’incapacité à aimer de l’homme moderne, l’égoïsme qui est au fond de son romantisme un peu niais. Il nous donne surtout la clé de son œuvre avec cette phrase qui est peut-être l’une des plus belles et des plus émouvantes de son roman :
C’est peut-être ça qu’on cherche à travers la vie, rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir.
Le grand paradoxe est que ce véritable monstre d’orgueil et de méchanceté a une suraffectivité pour tout ce qui vit.
« La tante à Bébert rentrait des commissions … » Rien de ce qui est vivant ne lui fut étranger.
Paros, 3 août 2015, 21 heures
Chants grégoriens
La mer, ça se termine. Rien à dire que le scooter, le scooter, le scooter. Toute l’île. Je pourrais faire un journal à la Cioran, je ne sais pas, par exemple : « Déjeuner, 3 août, chez les Orban, invité par Sylvain Lindon. Stéphane Bern. » Ou encore, en plein déjeuner dans une maison délicieuse, face à la mer, au ciel, etc. Quelqu’un a dit en parlant de Philippe Muray : « Ce que dit cet auteur est vraiment frappé au coin du bon sens. » Ça personnalise, ça aère, on est toujours content dans un lieu de pouvoir s’accrocher à des choses du réel. Comme si la nomination était suffisante, immédiatement, on voit quelqu’un. Déjeuner chez les Orban. Ah ! ça fait homme de lettres, ça a de la gueule. Déjeuner chez les Orban, à Paros. Cette île remplie de bleu. Alphonse Allais dit, en parlant d’Honfleur, cette phrase somptueuse : « Honfleur : autant d’eau pour une ville si petite. » Je tenterais très modestement : « Paros, tellement de bleu pour une île si petite. » OK, il vaut mieux que je parle des grands écrivains.
Chapitre 5
Écoute mon ami…
Quand je suis entré pour la première fois dans le cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet, j’avais une vingtaine d’années. Il s’est passé une chose simple et en même temps miraculeuse. Une chose qu’on pourrait appeler une révélation quasiment claudélienne : la découverte du Répertoire ! Sa proximité et sa dimension inaccessible. Ou pour le dire autrement, la sensation qu’un immense travail m’attendait et que mon ego, mon intelligence, mon intuition, mes dons, ces vertus que l’on pourrait appeler bêtement « la personnalité », ne seraient pas la première chose à alerter. Il me faudrait plutôt essayer d’atteindre une science, le mot est prétentieux et excessif peut-être, mais disons un sens, une intuition de la partition classique. Ce moment immense, assez proche de la foi, et que le professeur Jean-Laurent Cochet, traversé lui aussi par la locomotive immortelle de Jouvet, m’a transmis.
J’avais lu seulement quelques livres — Nietzsche, L’Attrape-cœurs, Voyage au bout de la nuit . J’avais fait un film avec Philippe Labro ( Tout peut arriver ) dans lequel j’essayais de danser comme James Brown — je dis bien essayais — dans une boîte de nuit d’Angoulême, Weston aux pieds, blazer…
J’ai alors entendu Molière pour la première fois. Cochet était entouré de ses élèves. Ce premier jour, ils travaillaient sur la première scène de l’acte I du Misanthrope . Alceste et Philinte. Ça n’a l’air de rien, mais cette confrontation amicale scénarise les deux points de vue les plus radicaux du comportement dans l’existence. Alceste, Philinte. On l’a tellement entendu que cette habitude nous sépare de l’échange de ces deux amis. Contrairement à l’idée moderne, Philinte fonde le principe de l’intelligence adaptée et Alceste celui d’une vitalité intempestive, ridicule, pathétique qui, pendant des années, a été l’exemple du révolté. La grande trouvaille de Jouvet, c’est qu’Alceste et Philinte, ce sont deux amis. Deux amis. L’un est plus intelligent que l’autre. Alceste pense que la foi amoureuse va faire plier le réel à son propre désir. Philinte n’a plus ses illusions. Pourquoi ça nous passionne ?
Qu’est-ce qu’il y a d’éternellement présent dans cet échange rabâché, usé, amoindri par l’expérience scolaire ? Qu’est-ce qu’il y a de vivant dans cet échange ?
Moi-même, je ne cesse de me plaindre des gens, de leur brutalité, du bruit qu’ils font, de leur indifférence aux autres : je suis Alceste. Je suis exaspéré par les gens qui ont des voitures aux vitres teintées, par exemple : ils se prennent tous pour John Lennon, alors qu’ils ont des vies d’une vacuité misérable. Imaginons Alceste devant le portable. Qui dira, enfin, la barbarie du portable ?
Il suffit d’entrer dans un TGV pour mesurer ce que dit mon ami Claude Arnaud : l’obsession de la communication incessante, générale, mondialisée, se résume avec le monde entier mais surtout pas avec son voisin. Surtout aucun contact avec l’autre, surtout pas. Des millions d’amis mais surtout pas la disponibilité au sourire de l’autre. Ceci étant dit, cela facilite la pensée nietzschéenne : « Que le prochain, hélas, est dur à digérer ! », et ça me permet, dans le TGV, de mettre mon casque et d’écouter des chants grégoriens.
Je suis Alceste.
Et je m’indigne parce que la relation la plus élémentaire, la courtoisie, l’échange de regards ont été anéantis pour être remplacés par des rapports mécaniques, fonctionnels, performants, dépourvus de mélodie. Dans le train, dans la rue, nous sommes contraints d’entendre des choses que nous aurions considérées, même, comme indignes en famille. Et les femmes ? Être présent, se promener, regarder un visage féminin, « celle qu’on voit apparaître et qui s’évanouit », ce n’est plus pareil. On les voit ouvrir des portes de voiture et les refermer le portable à l’épaule et elles règlent en même temps le problème des enfants. La colonne vertébrale devient inélégante. La rue qui était un matériau d’inspiration, de poésie, de virtualité ; la rue qui pouvait être un objet de réflexion pour celui qui se prenait pour Socrate ou un lieu de drague s’il se prenait pour Roland Barthes est envahie de petites entreprises qui n’ont pas de clients. Nous vivons un chômage de masse, il y a mille personnes qui perdent leur emploi par jour et nous sommes transformés en PME vagabondes. Ils déambulent, totalement affairés. Mais cela se fait avec notre consentement : tout le monde est d’accord, tout le monde est sympathique. Et la vie qui doit être privée est offerte bruyamment. Les problèmes d’infrastructures des vacances du petit à Chamonix par rapport au grand frère qui n’est pas très content, le problème du patron qui est méchant.
Читать дальше
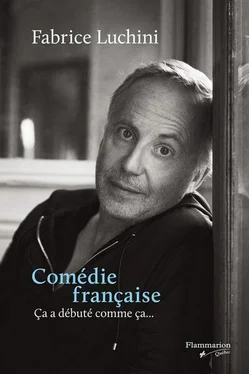
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)