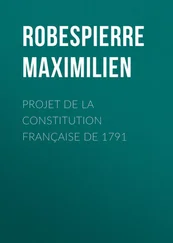Alceste certainement aurait voulu se battre contre cette tyrannie. Il ne se rend pas compte que le combat est perdu d’avance. Il crie. Il se révolte. Philinte lui répond :
Le monde par vos soins ne se changera pas ;
Et puisque la franchise a pour vous tant d’appas,
Je vous dirai tout franc que cette maladie,
Partout où vous allez, donne la comédie,
Et qu’un si grand courroux contre les mœurs du temps
Vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. [40] Molière, Le Misanthrope, Acte I, scène 1, GF, Flammarion, 2013, p. 42.
Et Philinte s’adapte au portable.
Évidemment, Philinte incarne un contrepoint qui le hisse à la dimension d’un moraliste. On ne fait pas assez attention aux réponses de Philinte, face à l’exaspération d’Alceste dans ses furies, parce que cette réplique est usée à force d’avoir été tellement entendue. Philinte dit : « Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine. » Ce n’est pas une morale mais c’est un état. Il ne moralise pas, il affirme un nouveau son :
Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine,
Et faisons un peu grâce à la nature humaine ;
Ne l’examinons point dans la grande rigueur,
Et voyons ses défauts, avec quelque douceur. [41] Molière, Le Misanthrope, op. cit., p. 44.
Vous vous rendez compte de ce qui se dit, là ? Vous prenez conscience de ce nouveau code offert à Alceste qui n’entend rien ?
Il faut, parmi le monde, une vertu traitable.
Espèce de couillon, accepte le portable !
À force de sagesse, on peut être blâmable ;
La parfaite raison fuit toute extrémité,
Et veut que l’on soit sage avec sobriété.
Regardez comment Philinte s’adapte au portable :
Je prends tout doucement les hommes comme ils sont,
J’accoutume mon âme à souffrir ce qu’ils font. [42] Molière, Le Misanthrope, op. cit., p. 41.
Est-ce que nous entendons ce qui se dit là ? Il dit qu’il prend doucement — voyez l’importance du « doucement » — les hommes comme ils sont. Il accoutume son âme à souffrir ce qu’ils font.
C’est évidemment Philinte qui a raison.
« Il est bon de cacher ce qu’on a dans le cœur », dit-il encore. On a envie de dire, encore une fois, acceptons le retentissement de la puissance évocatrice de cette phrase, voyons les conséquences dans votre vie.
Le Misanthrope , ça n’est pas de la littérature. Il n’y a aucun souci rhétorique. La langue sort du corps et non pas du cerveau : c’est un produit organique qui fait avancer l’action. Rien n’est descriptif, orné. Tout est immédiatement compréhensible. Comme dirait Jouvet, une phrase de Molière n’est pas du joli langage, les phrases sont les « cicatrices du poète ».
Chez Jean-Laurent Cochet, on travaillait inlassablement cette scène. Travailler Molière : pourquoi cette épreuve est-elle évidente, nécessaire ?
Pour mille raisons, dont les principales me semblent le génie de la situation et la confrontation à ce que Jouvet appelle le « marbre » : Molière, dit Jouvet, c’est du marbre, on ne peut le faire plier, on ne peut le réduire à nous-mêmes, il nous délivre du narcissisme de la modernité en nous obligeant à nous mesurer aux constantes de l’âme humaine, parce qu’il a sécrété, produit, créé des scènes et des personnages qui ont une puissance éternelle [43] Louis Jouvet, Molière et la comédie classique, Gallimard, 1965, p. 12.
. La langue est propulsée par un turbo, le corps, les muscles. Il y a si peu de joliesse, de raffinement français chez lui. C’est une langue en marche. Molière, c’est un immense graphologue organique. Il serait criminel d’apporter sa petite colère personnelle dans l’échange qui va suivre :
PHILINTE
Il est bien des endroits, où la pleine franchise
Deviendrait ridicule et serait peu permise ;
Et parfois, n’en déplaise à votre austère honneur,
Il est bon de cacher ce qu’on a dans le cœur.
Serait-il à propos et de la bienséance
De dire à mille gens tout ce que d’eux on pense ?
Et quand on a quelqu’un qu’on hait ou qui déplaît,
Lui doit-on déclarer la chose comme elle est ?
ALCESTE
PHILINTE
Quoi ? vous iriez dire à la vieille Émilie
Qu’à son âge il sied mal de faire la jolie ?
Et que le blanc qu’elle a scandalise chacun ?
ALCESTE
PHILINTE
À Dorilas, qu’il est trop importun,
Et qu’il n’est, à la cour, oreille qu’il ne lasse,
À conter sa bravoure et l’éclat de sa race ?
ALCESTE
PHILINTE
ALCESTE
Je ne me moque point,
Et je vais n’épargner personne sur ce point.
Mes yeux sont trop blessés et la cour, et la ville
Ne m’offrent rien qu’objets à m’échauffer la bile :
J’entre en une humeur noire, et un chagrin profond,
Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font ;
Je ne trouve partout que lâche flatterie,
Qu’injustice, intérêt, trahison, fourberie ;
Je n’y puis plus tenir, j’enrage, et mon dessein
Est de rompre en visière à tout le genre humain. [44] Molière, Le Misanthrope, op. cit., p. 41–42.
Dire de Molière que c’est un dialoguiste de génie est trop faible : il est le dialoguiste. Parce qu’il ne démontre rien, il laisse sa chance à chacun. Un exemple : le duel entre Clitandre et Trissotin dans Les Femmes savantes . Clitandre, c’est l’homme de Molière un peu ennuyeux, sans grâce. Trissotin, c’est le brio, le mondain, le précieux. Il devrait vaincre mais, avec Molière, Clitandre a sa chance.
À chaque réplique, on change de camp. La tête passe de l’un à l’autre comme à Roland-Garros quand on regarde les échanges.
Clitandre, qui n’en peut plus de voir les femmes savantes se pâmer devant Trissotin, est au service. Il fait l’éloge de l’inculte préférable au prétentieux :
CLITANDRE
Je m’explique, Madame, et je hais seulement
La science et l’esprit qui gâtent les personnes.
Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes ;
Mais j’aimerais mieux être au rang des ignorants,
Que de me voir savant comme certaines gens.
C’est dit calmement. Trissotin perd le point. Il tente l’apaisement.
TRISSOTIN
Pour moi, je ne vois pas, quelque effet qu’on suppose,
Que la science soit pour gâter quelque chose.
Mais Clitandre insiste.
CLITANDRE
Et c’est mon sentiment, qu’en faits, comme en propos,
La science est sujette à faire de grands sots.
Trissotin, lui, reste en fond de cour.
TRISSOTIN
Le paradoxe est fort.
Mais Clitandre qui le tient, tape de plus en plus fort. On le voit serrer les dents…
CLITANDRE
Sans être fort habile,
La preuve m’en serait, je pense, assez facile.
Si les raisons manquaient, je suis sûr qu’en tout cas
Les exemples fameux ne me manqueraient pas.
TRISSOTIN
Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère.
Читать дальше
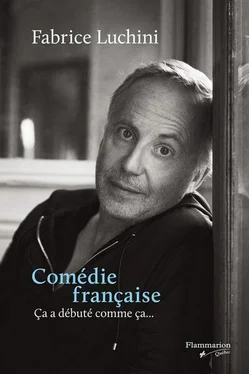
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)