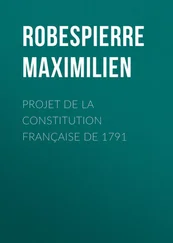Représentation tout à fait correcte, aptitude ahurissante de la part du public à accepter la force des poèmes.
Pris un verre après le spectacle avec Yasmina Reza. Extrêmement touché par sa formule : « En écoutant ton spectacle, je me suis dit : voilà pourquoi je me sens française, c’est pour ça. » La langue et les écrivains.
Chapitre 2
Mes Guermantes
La langue vivante, je ne l’ai pas apprise à l’école. Elle courait, quand j’étais enfant, dans le quartier des Abbesses. Avec la bande.
Je reviens à la langue parlée, écrit Paul Valéry. Croyez-vous que notre littérature, et singulièrement notre poésie, ne pâtisse pas de notre négligence dans l’éducation de la parole ? […] Cependant qu’on exige le respect de la partie absurde de notre langage, qui est sa partie orthographique, on tolère la falsification la plus barbare de la partie phonétique, c’est-à-dire la langue vivante… [6] Paul Valéry, Le Bilan de l’intelligence, Allia, 2011, p. 51–52.
La bande, c’était des gens violents qui avaient une langue. Une chose qui me fascinait dans ce regroupement d’individus, c’est qu’ils formaient une masse. La police avait des hésitations à aller se promener dans ce coin-là. Ils se donnaient rendez-vous au coin de la rue Houdon et de la rue des Abbesses ou alors sur la place du métro. Une trentaine ou une quarantaine de garçons, de mecs. Ça ne rigolait pas : la bagarre était leur seule expression. Il y avait du bruit, de la violence, du mouvement, de la fumée : une sorte de place Jemaa el-Fna. J’avais accès à eux grâce à des filiations de concierge de la rue Ramey. Ce n’était pas évident de les atteindre. C’est par eux que la puissance de l’oralité m’a été révélée. « On s’arrache », entendait-on sous le métro. Ils n’avaient jamais lu Valéry mais quand ils disaient « on s’arrache », j’avais l’image des pieds qui se décollent du goudron.
Le verlan, le louchébem vingt ans avant Renaud composaient un cocktail inimitable, un alcool violent. Je ratais tout dans la langue officielle, je réussissais tout dans la langue parallèle. L’agencement des mots et des sons formait ma première partition. Je n’allais pas entendre la Berma dire Racine (je ne connaissais ni l’un, ni l’autre, ni Proust) mais quand pour la première fois j’ai entendu « Mais dis donc, tu te dérobes ? », ce fut comme une révélation. « Tu te dérobes ? » lançaient les mecs à celui qui refusait soit une virée au bordel ou aux Champs-Élysées, soit de les accompagner acheter une chemise chez Tati. « J’ai besoin d’un tee-shirt », « J’ai pas envie de t’accompagner, répondait l’autre, arrête de me faire iech. » « Tu te dérobes ? » [7] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Folio, Gallimard, 2010, p. 95. © Éditions Gallimard pour toutes les citations suivantes de ce titre.
Tout est là, dans ce « tu te dérobes ? » à cause d’un tee-shirt. Dramatiser ce qui n’a aucun sens. « Tu te dérobes ? » Tout un code social qui accompagnait ces quelques lettres : appartenance, force du groupe, crainte de la disgrâce. « Tu te dérobes ? » Pas du Bruant, ni du Poulbot, mais la langue des aristos de la rue. Mes Guermantes.
Un autre monde. Il faut dire que ce n’est pas rue du Bac que ça a commencé. Mais très loin de chez Gallimard, là-bas, au-delà de Saint-Lazare. Par la faute d’une ligne d’autobus. La ligne 80. Ce n’est pas rien, la ligne 80. Les gens appellent ça un « moyen de transport ». Ils y montent et y descendent sans voir que d’une station à l’autre la machine à plateforme est devenue une ignominie mécanique et technicienne et que le parcours est souvent celui de toute une existence. Au début, on a 14 ans, on est sur la plateforme, on en a plein les yeux, les rues défilent.
Le parcours du 80, c’est l’acte fondateur de ma Maman.
Avec ma mère, écrit Céline dans Voyage au bout de la nuit , nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l’hôpital, une après-midi, à marcher en traînant dans les ébauches des rues qu’il y a par là.
Ma mère dort avec mon père au cimetière de Montmartre. Pas loin de Guitry. Pas loin de Truffaut. En dessous du pont Caulaincourt, sur le parcours du 80.
Avec ma mère, nous en fîmes des grands tours. Elle était fille de l’Assistance publique à Nevers. Elle n’avait pas de parents. Elle s’était mariée avec un homme qui au retour de la guerre était devenu fou : il ne la reconnaissait pas. Ces deux misères s’étaient retrouvées, il en est sorti trois enfants. J’ai deux frères, mais j’ai eu la folie de penser que j’étais le seul. De là vient mon dévorant désir d’être le préféré.
Le soir, j’aidais mes parents pour les livraisons. Je montais les marches du passage Cottin en portant les cageots de fruits et de légumes. Plus on grimpait, plus l’horizon s’élargissait, plus l’air se purifiait. L’escalier social possède celui qui le monte. Ma mère avait une belle clientèle, tout le haut Montmartre. J’allais livrer les dames dans le haut Lamarck. Le haut Lamarck. On avait l’impression d’être dans les hauteurs de Nice. Je montais, je montais, j’accédais. Là-haut. Les appartements étaient vastes, tout était aéré. Je ne connaissais pas encore la phrase de Michel Audiard — « Moi, le pognon, ça m’émeut » —, mais j’éprouvais une émotion indescriptible.
Le 80, au départ, ce n’était qu’une station sous la mairie du 18 e. C’est aussi le dépôt. Les bus y soufflent comme des chevaux qui attendent de sortir. Des bêtes au repos. Une étable. Gamins, on restait à quai sans monter dedans : la colline suffisait. Rue Chevalier-de-La-Barre, il y avait un ruisseau. « Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache [c’est-à-dire la flaque], écrit Rimbaud dans “Le Bateau ivre”, noire et froide où vers le crépuscule embaumé un enfant accroupi plein de tristesses… » L’enfant accroupi, c’était vraiment Robert, c’était moi. Il n’était pas plein de tristesse, sûrement plein d’angoisse. « Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. » [8] Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre, Denoël, 1937, p. 165.
Mon bateau de papier partait sur la mer immense. On grimpait et on dévalait la butte. Les troupes à casquette du fascisme touristique ne l’avaient pas encore envahie.
Le collège alors n’était pas automatique. Le parcours naturel ce n’était pas CM1, CM2, 6 e. Il y avait l’élite qui allait au collège et le reste allait en troupeau à l’école des pauvres : les ratés.
Toute une vie, toute la vie, sépare l’école communale du lycée… écrit Céline. Les uns sont de plain-pied, dès l’origine, dans l’expérience, les autres seront toujours des farceurs… […] Ils ont fait la route en auto, les mômes de la communale, à pompes… [9] Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre, op. cit., p. 164.
L’émotion, à l’entendre, est le privilège des petits, des pauvres. Ils voient la vie dans son intensité naturelle quand les bourgeois la cherchent désespérément. « Escrocs d’expérience et d’émotions ! » Céline exagère, bien entendu, mais quand il décrit la recette que l’on compte à la nuit tombée, elle est là, devant nous :
Matrodin n’en finissait pas dans ses additions. Il avait enlevé son tablier et puis son gilet pour mieux compter. Il peinait. [10] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit., p. 316.
À 13 ans, j’ai eu mon certificat d’études. Puis j’ai fait de la comptabilité. Je n’y comprenais pas grand-chose. Ça ne servait à rien d’insister. Ma mère avait un instinct absolu. Un matin, elle avait ouvert France-Soir . Il y avait de la demande. C’était les années 1960. Il y avait du boulot dans les années 1960.
Читать дальше
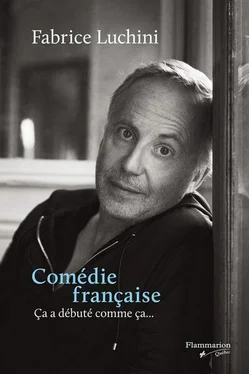
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)