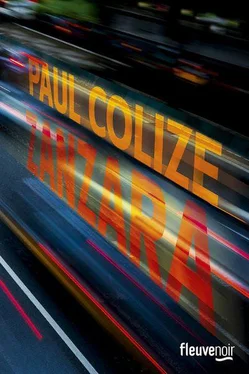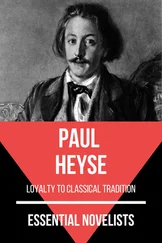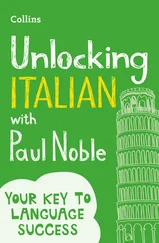— Excuse-moi, j’ai eu une nuit pourrie. Des clients de merde. Je voulais te dire que j’ai du nouveau. J’ai contacté Proximus pour résilier les abonnements de mon père et leur demander de m’expédier une copie détaillée de sa facture.
— Bonne initiative, Raf.
Mon compliment le revitalise.
— J’ai les temps de connexion à Internet, la liste des appels et des SMS envoyés, mais pas celle des appels reçus. Au milieu de tout ça, j’ai quand même trouvé quelque chose.
— Balance.
— Commençons par le Net. Il était connecté à peu près 24 heures sur 24, jusqu’au soir du 14 juin. Arrêt brusque à cette date. Par contre, il n’était pas accro au téléphone, il n’a donné que huit appels en un mois, dont quatre m’étaient destinés. Pas de SMS, rien de surprenant. Trois coups de fil passés le 17 juin, entre 21 h 45 et 22 h 15, à trois quotidiens, Le Soir, La Libre et la DH . À première vue, tu es le seul à avoir réagi.
Mes confrères ont cru à un canular.
Je note que la déconnexion au Web a eu lieu le jour de sa mort, ce qui tend à prouver que les tueurs ont coupé le réseau lors de leur visite. Dans la foulée, la messagerie vocale a été désactivée, mais le téléphone a été utilisé trois jours plus tard.
— Le quatrième coup de fil ?
— Il l’a donné le samedi 6 juin. J’ai rappelé le numéro. Je suis tombé sur un couple de Belges, les della Faille. Il a bossé pour eux au Venezuela en tant que chauffeur et garde du corps pour leurs mouflets. Ils sont rentrés en Belgique depuis plusieurs années et habitent à Genval. Ils sont restés en contact avec mon père, ils ont accepté un rendez-vous avec moi.
— Quand ?
— Demain après-midi.
— Je travaille jusqu’à 14 heures. Tu veux que je t’accompagne ?
— Si tu veux. Je t’envoie l’adresse. J’ai aussi demandé à la Poste qu’ils me transfèrent son courrier. À part sa facture d’eau et quelques pubs, il n’y a rien.
7 h 20.
J’arrive en même temps que l’hôtesse d’accueil. Elle est surprise de me voir de si bonne heure.
— Bonjour, Fred, ça va ?
— On ne peut mieux.
Elle me tend une enveloppe.
— Ton courrier d’hier.
J’en reçois peu. À part un carton d’invitation ou un dossier de presse, tout arrive par mail.
J’empoche la lettre et descends l’escalier pour me préparer deux cafés et fumer.
Au moment de remonter, le miroir de l’ascenseur témoigne de l’étendue du désastre. Je comprends la question de l’hôtesse. Je suis cadavérique. L’odeur que je dégage est assortie à mon teint. J’aurais mieux fait de passer chez moi pour prendre une douche, me changer et donner à bouffer à Nabilla.
Christophe se pointe une demi-heure plus tard.
— Ça va, Fred ?
Je prends l’air affairé.
— Impec.
Il me dévisage, tourne les talons et poursuit sa tournée de poignées de main.
Pierre débarque, il s’est rasé. Vanessa se fiche de lui. Alfredo louche sur les seins d’Éloïse.
La dépêche d’AFP tombe une heure et demie plus tard.
« Attentat en Isère : un corps décapité. »
Mobilisation générale. Alors que nous sommes sur des charbons ardents, un brouhaha parcourt la rédaction.
« Un homme a ouvert le feu dans un hôtel près de Sousse, une station balnéaire dans l’est de la Tunisie, faisant une trentaine de morts. »
Le plateau entre en effervescence.
Des jurons fusent, quelques-uns se lèvent, s’approchent des écrans. D’autres se ruent sur leur clavier. En quelques secondes, la rédaction ressemble à une fourmilière. On s’agite, on passe de l’un à l’autre, on parle, on fait non de la tête.
Ma fatigue s’est envolée.
Je tape à une vitesse ahurissante. Les infos surgissent de toutes parts. Les premières photos arrivent, insoutenables. Les charognards et les voyeurs qui croupissent dans la presse à scandale vont se régaler.
Je fais appel à l’équipe. Ils se regroupent autour de moi. En étroite symbiose, nous ne formons qu’un. Chacun donne son avis. Nous choisissons une image, l’une des moins choquantes, et mettons en ligne.
Coup de tonnerre.
« Koweït : 25 morts et plus de 200 blessés dans un attentat suicide. »
Vendredi noir.
Alfredo grommelle des phrases inintelligibles. Vanessa verse une larme. Éloïse est blême, statufiée devant son écran.
L’émotion l’emporte.
En principe, nous devrions laisser empathie et sensibilité au vestiaire, comme le font les chirurgiens de guerre qui passent d’une victime à l’autre pour évaluer leurs chances de survie et faire une sélection. Les plus anciens de la rédaction y parviennent, même s’ils le déplorent en aparté.
Nous passons le reste de la journée à surfer d’un site à l’autre, à lire les dernières dépêches, à parcourir TweetDeck pour rédiger, éditer, mettre à jour les macabres bilans. Le tout sans boire ni manger.
Vers 22 heures, Christophe vient nous trouver, les traits tirés.
— C’est bon, les gars, on arrête. Vous avez été exemplaires.
Gavés d’adrénaline, tous les sens en éveil, nous pourrions continuer jusqu’à l’aube. J’en ai oublié de fumer.
Éloïse passe derrière moi.
— Je n’en peux plus, il faut que je me change les idées. Je t’attends chez moi.
J’avais oublié notre rendez-vous.
— Vas-y, je te rejoins.
Je consulte mes mails avant d’éteindre mon ordi et jette un coup d’œil à la lettre qui traîne sur mon bureau depuis ce matin.
L’enveloppe est ornée d’un timbre français. D’après le tampon, elle a été expédiée de Paris, le 23 juin. Elle contient une carte postale en noir et blanc qui représente le Christ sur la croix.
Au verso, quelques mots, à l’encre.
« Natasha Sczepanski est née le 7 septembre 1980.
Elle est décédée le 2 mai 2014 dans des circonstances tragiques. »
La Golf tressaute sur les pavés de la place des Palais.
Je consulte une nouvelle fois mon téléphone. Aucun signe de Camille.
Elle suit l’actualité, elle sait à quel point ma journée a dû être pénible. En temps normal, elle aurait trouvé les mots. Ses messages m’auraient aidé à surmonter l’horreur. Elle m’aurait réchauffé, elle serait parvenue à faire renaître un sourire sur mes lèvres. Nous avions nos codes. Un rien suffisait pour qu’on se comprenne.
En quelques minutes, tout s’est écroulé.
Je n’ai pas dit mon dernier mot. Elle fait fausse route. Elle n’a rien à faire chez les Chinetoques. Je trouverai le moyen de la reconquérir. Ce qu’elle n’a jamais osé imaginer, ce qu’elle croit impossible, ne l’est pas.
Je dois tout lui dire.
Une ambulance me double, sirènes hurlantes.
Les images de la journée défilent.
Les corps criblés de balles sur la plage de Sousse. La mosquée dévastée à Koweït City. La tête décapitée, accrochée au grillage de l’usine.
En regard de ces carnages, le sort de cette Natasha Sczepanski me paraît insignifiant. Je ne sais pas qui elle est, pas plus que je ne sais qui m’a envoyé cette carte. Pour l’heure, je me contrefiche qu’elle soit morte le 2 mai 2014 dans des circonstances tragiques.
Je n’ai aucune envie de rejoindre Éloïse.
Que lui raconter ? Panne de bagnole ? Urgence familiale ? Malaise ?
Je remonte la rue du Trône, prends à droite dans la rue du Viaduc. Le quartier est calme. Un drapeau tunisien flotte sur une des façades.
Je suis épuisé. Deux nuits blanches, une journée en enfer. J’encaisse le contrecoup.
Je grimpe les marches, arrive au dernier étage, essoufflé. La porte de l’appartement est entrouverte. Avant-hier, j’ai dû oublier de la fermer. Nabilla a sans doute chié partout. Si elle ne s’est pas barrée, comme sa maîtresse.
Читать дальше