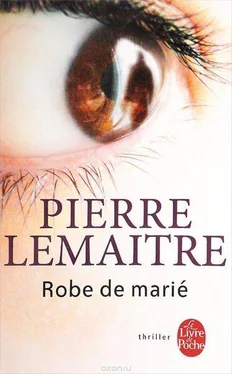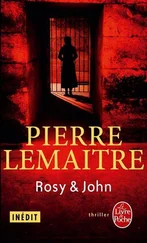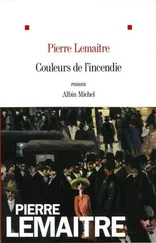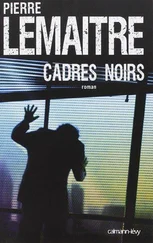Haletante, en nage, Sophie s’est assise sur son lit. Son cri de terreur résonne encore dans la pièce… Assis à côté d’elle, Frantz la regarde, terrifié. Il lui tient les mains.
— Qu’est-ce qui se passe ? demande-t-il.
Son cri s’est étranglé dans sa gorge, elle suffoque, ses poings sont serrés, ses ongles sont entrés profondément dans ses paumes. Frantz prend ses mains dans les siennes et ouvre chaque doigt, un à un, en lui parlant doucement, mais pour elle, à ce moment, toutes les voix sont identiques et même celle de Frantz ressemble à la voix de Vincent. La voix de son rêve. La Voix.
À partir de ce jour, c’en est fini des plaisirs de petite fille. Sophie se concentre, comme aux pires périodes, pour ne pas sombrer. Dans la journée, elle essaie de ne pas dormir. Peur des rêves. Mais parfois rien n’y résiste, le sommeil survient, la submerge. La nuit ou le jour, les morts la visitent. Tantôt Véronique Fabre, le visage ensanglanté et souriant, mortellement blessée mais vivante. Elle lui parle et lui raconte sa mort. Mais ce n’est pas sa voix à elle, c’est la Voix qui lui parle, toujours cette Voix précise, cette Voix qui sait tout, qui connaît le détail de tout, qui connaît toute sa vie. Je vous attends, Sophie, dit Véronique Fabre, depuis que vous m’avez tuée, je sais que vous allez me rejoindre. Dieu, comme vous m’avez fait mal… Vous n’imaginez pas. Je vous raconterai tout ça quand vous m’aurez rejointe. Je sais que vous allez venir… Bientôt, vous aurez envie de venir me rejoindre, de nous rejoindre tous. Vincent, Léo, moi… Nous serons tous là pour vous accueillir…
Dans la journée, Sophie cesse de bouger, elle reste prostrée. Frantz est affolé, il veut appeler un médecin, elle refuse avec violence. Elle se reprend et tente de le rassurer. Mais elle voit bien à son visage qu’il ne comprend pas, que dans cette situation, pour lui, ne pas appeler un médecin est quelque chose d’incompréhensible.
Il rentre de plus en plus tôt. Mais il est trop inquiet. Très vite, il dit :
— J’ai demandé un petit congé. Il me restait des jours…
Il est maintenant avec elle toute la journée. Il regarde la télévision tandis que le sommeil la terrasse. En pleine journée. Elle distingue la nuque rasée de Frantz en découpe sur l’écran du téléviseur et le sommeil la happe. Toujours les mêmes mots, les mêmes morts. Dans ses rêves, le petit Léo lui parle avec la voix d’homme qu’il n’aura jamais. Léo lui parle avec la Voix. Il lui raconte, avec tant de détails, combien le lacet lui a fait mal à la gorge, combien il s’est épuisé à chercher sa respiration, combien il s’est débattu, comme il a tenté de hurler… Et tous les morts reviennent, jour après jour, nuit après nuit. Frantz lui fait des tisanes, des bouillons, insiste toujours pour appeler un médecin. Mais Sophie ne veut voir personne, elle a réussi à disparaître, elle ne veut pas risquer une enquête, elle ne veut pas être folle, elle ne veut pas être internée, elle jure qu’elle va surmonter tout ça. Ces crises lui glacent les mains, son rythme cardiaque fait d’inquiétants va-et-vient. Son corps est gelé mais la transpiration inonde ses vêtements. Elle dort des nuits et des jours. « Ce sont des crises d’angoisse. Ça s’en va comme ça vient », risque-t-elle, rassurante. Frantz sourit mais il est sceptique.
Une fois, elle part. À peine quelques heures.
— Quatre heures ! a dit Frantz comme s’il annonçait un record sportif. J’étais affolé. Tu étais où ?
Il lui prend les mains. Il est réellement inquiet.
— Je suis revenue, a dit Sophie comme si c’était la réponse attendue.
Frantz veut comprendre, cette disparition l’a rendu nerveux. C’est un esprit simple mais rationnel. Ce qu’il ne comprend pas le rend dingue.
— Qu’est-ce que je vais faire si tu commences à partir comme ça ! Je veux dire… pour te retrouver !
Elle dit qu’elle ne se souvient pas. Il insiste :
— Quatre heures, c’est pas possible que tu ne te souviennes pas !
Sophie roule des yeux étranges, translucides.
— Dans un café, lâche-t-elle comme si elle se parlait à elle-même.
— Un café… Tu étais dans un café… Quel café ? demande Frantz.
Elle le regarde, elle est perdue.
— Je ne suis pas sûre.
Sophie s’est mise à pleurer. Frantz l’a serrée contre lui. Elle s’est lovée dans ses bras. C’était en avril. Que voulait-elle ? En finir peut-être. Pourtant la voici revenue. Se souvient-elle de ce qu’elle a fait durant ces quatre heures ? Que peut-on bien faire en quatre heures…?
Un mois plus tard, début mai, plus épuisée que jamais, Sophie s’est vraiment sauvée.
Frantz est descendu quelques minutes, il a dit : « Je reviens, je fais vite, ne t’inquiète pas. » Sophie a attendu que son pas disparaisse dans l’escalier, elle a enfilé une veste, mécaniquement elle a ramassé quelques affaires, son portefeuille, et elle s’est enfuie. Elle est sortie de l’immeuble par le local des poubelles, qui donne dans l’autre rue. Elle court. Sa tête cogne comme son cœur. À eux deux, ils lui font un martèlement qui résonne du ventre jusqu’aux tempes. Elle court. Elle a très chaud, elle retire sa veste qu’elle jette sur le trottoir, elle court toujours et se retourne. Craint-elle que les morts la rejoignent ? 6.7.5.3. Elle doit se souvenir de cela. 6.7.5.3. Sa respiration se perd, sa poitrine la brûle, elle court, la voici devant les bus, elle saute dedans plus qu’elle n’y monte. Elle n’a pas pris d’argent. Elle fouille ses poches, en vain. Le chauffeur la regarde pour ce qu’elle est, une folle. Elle exhume une pièce de deux euros égarée dans son jean. Le chauffeur lui pose une question qu’elle n’entend pas mais à quoi elle répond en disant : « Tout va bien », le genre de phrase qui fait toujours bien quand on veut calmer l’entourage. Tout va bien. 6.7.5.3. Ne pas oublier ça. Il n’y a, près d’elle, que trois ou quatre personnes qui la regardent à la dérobée. Elle tente de rajuster ses vêtements. Elle s’est assise à l’arrière et scrute la circulation par la vitre arrière. Elle voudrait fumer mais c’est interdit et, de toute manière, elle a tout oublié à la maison. Le bus se dirige vers la gare. Il stoppe longuement aux feux rouges, redémarre poussivement. Sophie retrouve un peu de respiration mais à l’approche de la gare, la peur la saisit de nouveau. Elle a peur du monde, peur des gens, peur des trains. Peur de tout. Elle pense qu’elle ne pourra pas fuir ainsi, aussi facilement. Elle se retourne toujours. Les visages, derrière elle, portent-ils le masque de la mort qui vient ? Elle tremble de plus en plus fort et après toutes ces journées et ces nuits épuisantes, de ce simple effort de courir au bus et de traverser la gare, elle est exténuée. « Melun », dit-elle. 6.7.5.3. Non, elle n’a pas de réduction. Oui, elle passera par Paris, elle tend sa carte bancaire avec insistance, elle voudrait que l’employé la saisisse tout de suite, elle voudrait se délivrer de son message avant de l’oublier : 6.7.5.3, elle voudrait que l’employé lui donne son billet, la fasse monter, elle voudrait déjà voir défiler les gares et descendre du train… Oui, ça lui fera une longue attente au changement, à la fin de quoi l’employé pianote et lance une impression crépitante, son billet est devant elle, l’employé dit : « Vous pouvez taper votre code. » 6.7.5.3. Une victoire. Contre qui ? Sophie se retourne et part. Elle a laissé sa carte dans l’appareil. Une femme la lui désigne avec un sourire suffisant. Sophie l’arrache de l’appareil. Tout cela a une saveur de déjà-vu, Sophie ne cesse de revivre les mêmes scènes, les mêmes fuites, les mêmes morts depuis… quand ? Il faut que ça s’arrête. Elle tape sur ses poches à la recherche de ses cigarettes, rencontre la carte bancaire qu’elle vient d’y glisser et lorsqu’elle relève la tête, Frantz est là, devant elle, affolé, qui dit : « Où vas-tu comme ça ? » Il tient à la main la veste qu’elle a jetée dans la rue. Il penche la tête de droite et de gauche. « Il faut rentrer à la maison. Cette fois, il faut appeler un médecin… Tu vois bien… » Un instant elle hésite à dire oui. Un court instant. Mais elle se reprend. « Non, pas de médecin… Je vais rentrer. » Il lui sourit et lui prend le bras. Sophie ressent une nausée, elle se plie légèrement. Frantz la tient par le bras : « On va rentrer…, dit-il. Je suis garé juste là. » Sophie regarde la gare qui s’enfuit, elle ferme les yeux comme si elle devait prendre une décision. Puis elle se tourne vers Frantz et le prend par le cou. Elle serre, elle dit : « Oh, Frantz… », elle pleure et tandis qu’il la porte — plus qu’il ne la soutient — vers la sortie, vers la voiture, vers la maison, elle lâche sur le sol son billet de train roulé en boule et plonge sa tête dans le creux de son épaule en sanglotant.
Читать дальше