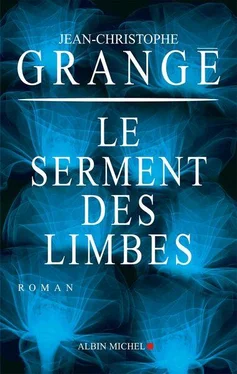— N’aie pas peur des copines, approche.
Je saluai les femmes qui l’entouraient : cinq ou six fleurs de carbone lascives, appuyées contre les murs de velours violet. Leurs grands yeux noirs évoquaient la Charmeuse de serpents du Douanier Rousseau.
— Tu t’ennuyais de moi ?
— Je ne sais pas comment j’ai pu attendre si longtemps.
Elle partit d’un rugissement de gorge. À chaque éclat de rire, ses dents donnaient l’impression de prendre l’air. J’observai les « copines ». Elles portaient toutes des étoffes moirées et étaient épinglées de piercings : lèvres, narines, nombril. Surtout, je considérai leurs perruques : nattes tressées, mèches roussâtres, bombe sixties, à la Diana Ross…
— Laisse tomber. Elles sont au-dessus de tes moyens.
— Je ne suis pas là pour ça.
— Tu devrais. Ça te détendrait. Tu veux quoi ?
— Claude. J’ai besoin de le voir.
— Cherche à l’Atlantis. Il donne dans les Antilles, en ce moment.
Je saluai Merline et sa cour. En quittant le Keur Samba, je réalisai que je n’avais croisé aucune personnalité célèbre de la communauté : ni musicien, ni fils d’ambassadeur, ni footballeur. Où étaient-ils donc ce soir ?
L’Atlantis était installé dans un hangar, juste à côté de l’entrepôt des moquettes Saint-Maclou, quai d’Austerlitz. Sous un porche immense, des barrières de fer délimitaient l’entrée de la boîte. Il fallait passer un portique antimétal puis subir une fouille corporelle.
Dès qu’il me vit, un des vigiles, un colosse congolais surnommé Nounours, beugla : « 22, v’là les keufs ! » Gros rire. En manière d’excuse, il me tamponna un sigle bleu sur la main, qui donnait droit à une boisson gratuite. Je le remerciai et plongeai dans l’entrepôt. Je quittais la haute couture pour la grande surface.
L’Atlantis, le pays où le zouk est un océan. La vibration de la musique me souleva du sol. Plusieurs milliers de mètres carrés, plongés dans l’obscurité, où avaient été installées à la va-vite des banquettes et des tables. Je m’orientai avec les yeux, mais aussi les tripes. J’étais dans la peau du baigneur qui s’abandonne au courant.
Enjambant les canapés, j’atteignis le comptoir chargé de bouteilles. Un des barmen avait survécu à mes années d’absence. Je hurlai :
— Claude, il est pas là ?
— Qui ?
— CLAUDE !
— Doit être chez Pat. Y’a une fête ce soir.
Voilà pourquoi je ne rencontrais aucune tête connue. Tout le monde était là-bas.
— Pat ? Quel Pat ?
— L’épicier.
— À Saint-Denis ?
L’homme hocha la tête et se baissa pour attraper une poignée de glaçons. Son mouvement révéla, dans le miroir face à moi, une silhouette qui ne cadrait pas avec le décor. Un Blanc, visage livide, vêtu de noir. Je me retournai : personne. Hallucination ? Je glissai un billet au barman et décarrai, remontant ma propre fatigue.
J’attrapai le boulevard périphérique porte de Bercy et pris, juste après la porte de la Chapelle, l’autoroute A1. Au bout d’un kilomètre, j’aperçus les grandes plaines scintillantes de la banlieue, en contrebas.
3 heures du mutin .
Sur les quatre voies surélevées, il n’y avait plus une voiture. Je dépassai le panneau SAINT-DENIS CENTRE — STADEet m’engageai sur la bretelle de sortie SAINT-DENIS UNIVERSITÉ — PEYREFITTE. Juste à ce moment, je vis — ou crus voir — dans mon rétroviseur le visage blême que j’avais capté dans les lumières de l’Atlantis. Je braquai mon volant et fis une embardée, avant de reprendre le contrôle de ma voiture. Je ralentis et scrutai mon rétro : personne. Aucune voiture dans mon sillage.
Je plongeai sous le pont autoroutier et m’engageai à gauche, suivant l’axe de bitume au-dessus de moi. Très vite, les pavillons et les cités cédèrent la place aux grands murs des entrepôts et des usines éteintes. Leroy-Merlin, Gaz de France…
Je tournai à droite, puis encore à droite. Une ruelle, des lumières feutrées, des rassemblements devant les porches. J’éteignis mes phares et avançai, bringuebalant sur la chaussée défoncée. Des murs lépreux, des ouvertures colmatées avec des planches, des bagnoles posées sur leurs essieux, pas de parcmètres : la zone, la vraie.
Je dépassai les premiers groupes d’hommes : tous noirs. Au-dessus des immeubles, l’ombre de l’autoroute se dessinait comme un bras menaçant. La pluie était dans l’air. Je me garai discrètement et m’acheminai, plus discrètement encore, sentant que j’avançais désormais au cœur du pays black : 100 % africain, 100 % immunisé contre les lois françaises.
Je me glissai parmi les noctambules, dépassai le rideau de fer de l’épicerie de Pat, puis pénétrai dans l’immeuble suivant. Je connaissais les lieux : je ne marquai aucune hésitation. Je tombai sur une cour agitée de rumeurs et d’éclats de rire. Sur le perron de gauche, le portier me reconnut et me laissa passer. Rien que pour ce gain de temps et de salive, je lui filai vingt euros.
J’empruntai le couloir et atteignis l’arrière de l’épicerie, fermé par un rideau de coquillages. L’échoppe africaine la mieux fournie de Paris : manioc, sorgho, singe, antilope… Même des plantes magiques étaient en vente, garanties pour leur efficacité. Dans une salle annexe, Pat avait ouvert un maquis : un restaurant clandestin, où on se lavait les mains à l’Omo et dont l’aération laissait franchement à désirer.
Je traversai la boutique. Des Noirs devisaient, assis sur des caisses de Flag, la bière africaine, et des régimes de bananes plantains. Puis je me frayai un chemin dans le restaurant, plein à craquer. Aux regards qu’on me lançait, je compris que je n’étais pas le bienvenu. J’avais dépassé depuis longtemps la zone touristique.
J’atteignis un escalier. Le cœur du rythme provenait du sous-sol, faisant trembler le plancher. Je plongeai, sentant la musique et la chaleur monter en une bouffée entêtante. Des lampes grillagées éclairaient les marches. En bas, un cerbère en survêtement me barra la route, devant une porte de fer montée sur glissière. Je montrai mon insigne. L’homme tira à lui la paroi, à contrecœur, et je découvris une véritable hallucination. Une boîte de nuit aux dimensions réduites, sombre, vibrante, comme piquetée de lumière — une chair de poule phosphorescente sur une peau noire.
Les murs étaient peints en bleu-mauve, incrustés d’étoiles fluorescentes, des colonnes soutenaient un plafond qui semblait s’alourdir et se distendre. En plissant les yeux, je vis qu’on y avait tendu des filets de pêche. Aux portes de Paris, plusieurs mètres sous terre, on avait créé ici un bar marin. Des tables couvertes de nappes à carreaux supportaient des lampes-tempête. C’est du moins ce que je croyais deviner, car l’espace était rempli par une houle humaine, qui dansait sous les filets. Je songeai à une pêche miraculeuse de crânes noirs, de boubous bigarrés, de robes-fuseaux satinées…
Je taillai dans la meute, à la recherche de Claude.
Au fond, sur une scène striée de lumières roses et vertes, un groupe se déhanchait, scandant des accords répétitifs, obsessionnels. De la vraie musique africaine, gaie, raffinée, primitive. Dans un éclair, j’aperçus un guitariste qui faisait tourner sa tête comme sur un pivot ; à ses côtés, un Noir à la renverse extirpait des hurlements de son sax. Il n’était plus question ici de R&B ni de zouk antillais. Cette musique-là brisait les sens, secouait les entrailles, montait à la tête comme une incantation vaudoue.
Les couples dansaient, avec une subtile lenteur. Trempé de sueur, j’avançai encore, comme au fond d’un bassin épais. Au passage, je repérai des visages connus — ceux que j’avais en vain cherchés ailleurs. Le manager de Femi Kuti, le fils du président du Congo belge, des diplomates, des footballeurs, des animateurs radio… Tous réunis ici, sans distinction d’ethnie ni de nationalité.
Читать дальше