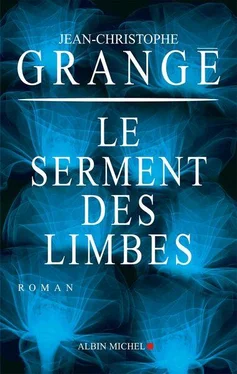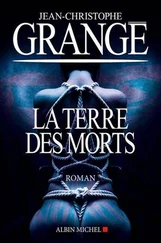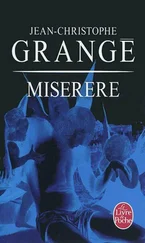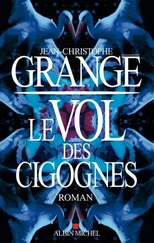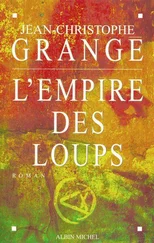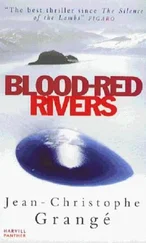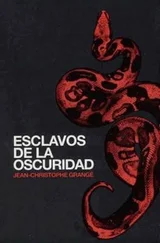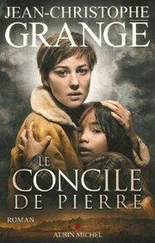On frappa doucement à la porte. Laure entra sans bruit. Il était minuit. Elle lança un coup d’œil aux dossiers à mes pieds.
— Je vais tout ranger, m’empressai-je de dire.
Elle fit un geste las : aucune importance. Elle avait pleuré. Son mascara avait coulé, lui dessinant deux yeux au beurre noir. J’eus cette pensée absurde, et cruelle : jamais ma mère n’aurait commis une telle faute. Je la revoyais, dans la voiture qui nous conduisait à l’enterrement de mon père, se passer sur les cils du mascara waterproof, en cas de larmes intempestives.
— Je vais me coucher, dit Laure. T’as besoin de rien ?
J’avais le gosier sec mais je fis non de la tête. L’heure tardive, cette intimité soudaine avec Laure… Je n’étais pas à mon aise.
— Si je travaille toute la nuit ici, c’est bon ?
Elle baissa encore les yeux sur les photographies par terre. Son regard consterné s’arrêta sur un masque de démon tibétain, qui sortait d’un carton :
— Il passait ses week-ends dans son bureau, à collectionner ces horreurs.
Dans sa voix, passait une sourde réprobation. Elle fit volte-face, attrapa la poignée puis se ravisa :
— Je voulais te dire quelque chose. Il m’est revenu un détail.
— Quoi ?
Par réflexe, je me levai, essuyant mes mains sur mon pantalon ; j’étais couvert de poussière.
— Un jour, je lui ai demandé ce qu’il foutait dans ce capharnaüm. Il m’a juste répondu : « J’ai trouvé la gorge. »
— La gorge ? Il n’a rien dit de plus ?
— Non. Il avait l’air d’un fou. Halluciné. (Elle se tut, soudain captive de ses souvenirs.) Si tu décides de partir dans la nuit, claque la porte derrière toi. Et n’oublie pas la messe, après-demain.
« J’ai trouvé la gorge. » Qu’avait-il voulu dire ? Etait-ce une gorge au sens physiologique ou minéral du terme ? Parlait-il d’un détail physique d’une personne ou d’un canyon, d’un puits de pierre ?
Les heures passèrent. En compagnie des fresques diaboliques de Fra Angelico et de Giotto, les peintures maléfiques de Grünewald et de Bruegel l’Ancien, le diable à queue de rat de Jérôme Bosch, le diable-porc de Dürer, les sorcières de Goya, le Léviathan de William Blake…
À 3 heures du matin, j’attaquai le dernier rangement. Au toucher, je sentis que les chemises n’abritaient plus des tirages photo mais des clichés médicaux. Des scanners, des clichés d’IRM, représentant des cerveaux. Je lus les légendes. Des malades psychiques en état de crise, notamment des schizophrènes violents.
Pas besoin d’être un génie pour deviner la démarche de Luc. À ses yeux, les représentations contemporaines du diable pouvaient être ces convulsions cérébrales, saisies sur le vif, à l’intérieur même de l’organe. Tout cela participait de la même logique : identifier le mal, sous toutes ses formes…
Je passai rapidement en revue ces archives, conservant quelques clichés pour mon dossier, ainsi que d’autres pour Svendsen. Je m’installai derrière le bureau, harassé — aucune force pour partir à cette heure. Mes pensées commençaient à perdre en netteté, et je me sentais de plus en plus mal.
Il n’y avait pas que la fatigue. Un malaise ne m’avait pas quitté depuis le début de mes fouilles : le Rwanda. La simple proximité des images du massacre m’avait foutu en l’air pour la nuit. Prenant la mesure de mon épuisement, je compris que je ne pourrais pas résister.
J’étais bon pour un aller simple en enfer.
Dans le puits de mes souvenirs.
Quand j’ai découvert le Rwanda, le pays n’existait pas.
En tout cas pour le reste du monde.
Une des nations les plus pauvres de la planète, mais sans guerre, ni famine, ni catastrophe naturelle ; rien qui motive l’organisation d’un concert rock ou l’attention des médias.
En février 1993, je débarque. Tout est déjà écrit. Le Rwanda vit dans l’énergie de la haine, comme un moribond tient debout par les nerfs. Une haine qui oppose la minorité tutsi, peuple élancé, raffiné, à la population hutu, courte, trapue, représentant 90 % des habitants du pays.
Je commence mon boulot humanitaire auprès des Tutsi opprimés. En face, les miliciens hutus sont armés de fusils, de gourdins et, déjà, de machettes. Aux quatre coins du pays, ils frappent, tuent, brûlent les huttes de leurs ennemis, en toute impunité. Chez « Terres d’espoir », nous traversons le pays avec des vivres, des médicaments, forcés de négocier à chaque barrage hutu, arrivant toujours trop tard. Sans compter les joies de l’humanitaire : les erreurs de livraison, les retards de stocks, les enlisements administratifs…
Fin 1993.
Les rues de Kigali résonnent des messages de haine de la RTML (Radio-Télévision Libre des Mille Collines), organe hutu qui appelle au massacre des « cafards ». Cette voix me poursuit jusqu’au dispensaire où je dors. Elle retentit dans les rues, les bâtiments, s’infiltre dans le crépi des murs, dans la touffeur de l’air.
1994.
Les prémices du génocide se multiplient. 500 000 machettes sont importées. Les barrages sont de plus en plus nombreux. Rackets, violence, humiliations… Rien ne peut arrêter le « Hutu Power ». Ni le gouvernement, ni l’ONU qui a envoyé une force impuissante. Et la voix des Mille Collines, toujours : « Quand le sang a coulé, on ne peut plus le ramasser. Nous en entendrons bientôt parler. Le peuple, c’est la véritable armée. Le peuple, c’est la force ! »
Chaque matin, chaque soir, je prie. Sans espoir. Dans ce pays à 90 % catholique, Dieu nous a abandonnés. Cet abandon est inscrit dans la latérite rouge. Il transparaît dans la voix de l’abominable radio. « Voici les noms des traîtres : Sebukiganda, fils de Butete, qui vit à Kidaho ; Benakala, qui tient le bar… Tutsi : on va vous raccourcir les jambes ! »
Avril 1994.
L’avion du président hutu Juvénal Habyarimana saute.
Nul ne sait qui a fait le coup. Peut-être le front rebelle tutsi, en exil, ou les extrémistes hutu jugeant leur président trop faible. Ou encore une force étrangère, pour d’obscurs intérêts. Dans tous les cas, c’est le signal du massacre. « Vous écoutez la RTLM. J’ai fumé un petit joint ce matin. Je salue les gars du barrage… Qu’aucun cafard ne vous échappe ! »
À chaque barricade, les papiers d’identité sont demandés, les Tutsi identifiés, puis tués et jetés dans les fosses fraîchement creusées. En trois jours, on compte plusieurs milliers de morts dans la capitale. Les Hutu s’organisent. Ils ont un objectif à atteindre : mille morts toutes les vingt minutes !
Dans Kigali, s’élève un bruit que je n’oublierai jamais. Le bruit des machettes frottées contre la chaussée, en signe de menace, en signe de joie. Les lames crissent contre le bitume, avant de s’abattre sur les corps. Les lames ensanglantées hurlent après avoir frappé…
Les ressortissants étrangers sont évacués. À « Terres d’espoir », on décide de rester. On s’installe au Centre d’échanges culturels franco-rwandais, où les soldats français ont établi leur base. Des Tutsi viennent s’y cacher, cherchant protection, mais les soldats s’en vont déjà. Je dois expliquer aux réfugiés qu’il n’y a plus rien à faire. Je dois leur expliquer que Dieu est mort.
Je parviens à partir en reconnaissance avec les derniers Casques Bleus de Kigali — l’ONU a rappelé 90 % de ses troupes. Alors seulement, je découvre les charniers qui bloquent les routes, les ponts de cadavres aux pantalons baissés. Je sens, dans mes os, les secousses des corps qui rebondissent sous nos roues. Je vois les villages exterminés, où le sang coule par rivières. Je vois les femmes enceintes éventrées, les fœtus écrasés contre les arbres. Je vois les jeunes filles violentées — on les choisit vierges, pour ne pas attraper le sida. Elles sont d’abord forcées pour le plaisir, puis avec des bâtons, des bouteilles, qu’on casse à l’intérieur de leur vagin.
Читать дальше