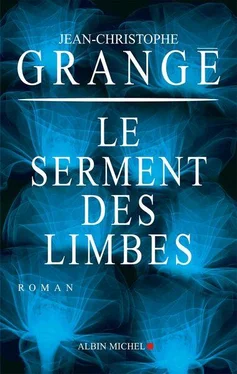Je ne peux mettre une date précise sur ma première défaillance.
À la fin du mois de mai, peut-être, lors des opérations de nettoyage, quand on brûle les cadavres putréfiés au diesel. Ou peut-être plus tard, quand l’opération Turquoise débute, la première manœuvre humanitaire d’envergure, organisée au Rwanda sous la bannière française. Une certitude : la crise survient dans les camps de réfugiés, là où la maladie et la pourriture prolongent le génocide.
D’abord, paralysie du bras gauche. On croit à un infarctus. Mais un médecin de MSF rend son verdict : pas de cause organique à mes symptômes. Autrement dit, tout se passe dans ma tête. Rapatriement. Direction : Centre Hospitalier Sainte-Anne, à Paris.
Je ne résiste pas. Je ne peux plus parler. J’ai cru encaisser l’horreur, dépasser le sang. J’ai pensé l’avoir intégré, comme un homme parvient à vivre avec une balle au fond du cerveau. Je me suis trompé. La greffe n’a pas pris. Le rejet commence. Le rejet, c’est cette paralysie. Premier signe d’une dépression qui va me broyer tout entier.
À Sainte-Anne, j’essaie de prier. Chaque fois, je fonds en larmes. Je pleure, comme jamais je n’ai pleuré. Toute la journée. Avec un sentiment de souffrance et de soulagement mêlés. À ma douleur morale répond un apaisement physique. Presque animal.
Je remplace la prière par des pilules, ce qui me paraît achever ma destruction. Ma perception du monde, c’est ma foi. Influencer cette perception, c’est tricher avec ma conscience, donc avec Dieu. Mais ai-je encore la foi ? Je ne sens plus en moi aucune conviction, aucun frein, aucun garde-fou. Il suffirait qu’on ouvre une fenêtre devant moi pour que je saute.
Septembre 94.
Changement de traitement.
Moins de pilules, plus de psy. Moi qui n’ai jamais révélé mes péchés qu’à des prêtres, qui n’ai jamais livré mes doutes qu’au Seigneur Lui-même, je dois tout déballer à un spécialiste de l’indifférence, qui ne représente aucune entité supérieure — dont le seul silence est un miroir, dans lequel ma conscience doit se contempler. Cette idée même me paraît atroce. Fondée sur une vision agnostique, réductrice, désespérée, de l’âme humaine.
Novembre 94.
Malgré moi, malgré tout, des signes d’amélioration apparaissent. Ma paralysie recule, mes crises de larmes s’espacent, mon désir de suicide s’atténue. De douze comprimés, je passe à cinq par jour. Je recommence à prier. Balbutiements, mots désordonnés, salive. Au sens propre du terme, les antidépresseurs me font baver…
Je retrouve la voie de Dieu. Et je m’éloigne de cette idée que je dois, moi, Lui pardonner pour ce que j’ai vu là-bas. Je me souviens d’une phrase d’un de mes maîtres, à Rome : « Le vrai secret de la foi, ce n’est pas de pardonner, mais de demander pardon — au monde tel qu’il est, parce que nous n’avons pas su le changer. »
Janvier 1995.
Retour au monde réel. J’adresse plusieurs lettres à des fondations religieuses, des lieux de retraite, des monastères, sollicitant un poste mineur, n’importe quoi pourvu que je sois en compagnie d’autres hommes. Un centre de formation en théologie, dans la Drôme, répond favorablement à ma demande, en dépit de mon état — je n’ai rien caché de ma maladie.
On m’assigne un rôle d’archiviste. Malgré mon bras invalide, je m’active, je range, je classe. Entouré de dossiers, de poussière, de séminaristes en stage, je me fonds dans le décor. Grâce à une poignée de pilules par jour et deux visites par semaine à un psy de Montélimar, je fais bonne figure. Et parviens à cacher mon état dépressif qui, même ici — surtout ici —, provoquerait une gêne, un malaise.
Parfois, des crises surviennent. Mes mains tremblent, mon corps s’agite, je suis soulevé par une fébrilité inexplicable. D’autres fois, au contraire, ma conscience devient aussi lourde qu’une étoile froide. C’est l’apathie. Impossible de lever un doigt. Je reste ainsi, plusieurs heures, écrasé par les idées qui me submergent : la mort, l’au-delà, l’inconnu… Dans ces moments-là, Dieu a de nouveau disparu.
Mais les souvenirs, eux, sont toujours là. Malgré mes précautions, je suis chaque fois pris en défaut. J’ai beau éviter toute proximité avec les transistors, télévisions et autres sons diffusés si, par malheur, un bruit blanc, un crachotement parvient à mes tympans, j’éprouve aussitôt une nausée implacable, un séisme au fond de mes tripes. « Qu’aucun cafard ne vous échappe ! » Je cours vomir dans les chiottes — ma bile, ma peur, ma lâcheté, pour finir, comme toujours, dans une crise de larmes.
Autre exemple. J’ai demandé à ne jamais manger avec les autres pour éviter tout bruit de fourchette, tout crissement de métal. Mais le seul raclement d’une table sur le parquet me propulse sur la route centrale de Kigali. Les tueurs hurlent et sifflent, les corps s’accumulent dans les fosses — des corps qu’on ne compte plus, qui ne comptent plus… Je pousse un cri avant d’entrer en convulsions. Je me retrouve à l’infirmerie, sous sédatif. Et je comprends, encore une fois, que je ne suis pas guéri, que je ne le serai jamais. La greffe n’a pas pris et il n’y a aucun moyen d’extraire le corps étranger.
Janvier 1996.
Je quitte le centre de théologie pour rejoindre un monastère isolé, dans les Hautes-Pyrénées. Expérience intérieure. Connaissance transcendante. Recherche du Verbe Divin. Parmi les moines cisterciens, je retrouve la force, l’espoir, la vitalité. Jusqu’au jour où ce quotidien ne me suffit plus.
Après ce que j’ai vu, il m’est impossible de rester là, à genoux, parlant au ciel alors que l’enfer est sur terre. Les moines qui m’entourent sont des novices en matière d’âmes. J’ai voyagé dans d’autres confins. J’ai vu le vrai visage de l’homme. Peau arrachée, muscles à nu, nerfs écorchés. Sa haine irréductible. Sa violence sans limite. Il faut guérir l’être humain de son mal, et ce n’est pas dans le silence et l’isolement que je pourrai le faire.
Alors, je me souviens de Luc.
Deux années que je n’ai pratiquement pas pensé à lui. Sa silhouette et sa voix me reviennent, avec une évidence nouvelle. Luc a toujours eu une longueur d’avance sur moi. Il a toujours pressenti les vérités choquantes, contradictoires, souterraines, de la réalité. Aujourd’hui encore, je comprends que je dois suivre sa voie.
Septembre 96.
J’intègre l’île aux Corbeaux.
L’ENSOP, l’École Nationale Supérieure des Officiers de Police, située à Cannes-Écluse, en Seine-et-Marne, ainsi surnommée parce que chacun y porte l’uniforme. Je ne suis pas dépaysé. J’ai connu la soutane. J’arbore maintenant la vareuse bleu marine. Passé le premier cap, où les officiers-formateurs me regardent d’un sale œil — avec mes diplômes, j’aurais pu tenter Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la « boîte à commissaires » —, mes résultats parlent pour moi.
Dans chaque matière, je décroche les meilleures notes. Droit pénal. Droit constitutionnel. Droit civil. Procédure. Sciences humaines. Aucun problème. Sans compter le sport. Athlétisme. Tir. Close-combat… Ma vie d’ascète, mon goût de la rigueur font de moi un adversaire redoutable.
Mais c’est pendant mon stage de fin d’études, sur le terrain, que ma qualité majeure se révèle : le sens de la rue. Intuition des lieux, instinct de la traque, psychologie… Et surtout : don du camouflage. Malgré ma silhouette d’asperge et mon cursus d’intellectuel, je me fonds n’importe où, adoptant le langage des voyous, faisant ami-ami avec la pire racaille.
Juin 1998.
Читать дальше