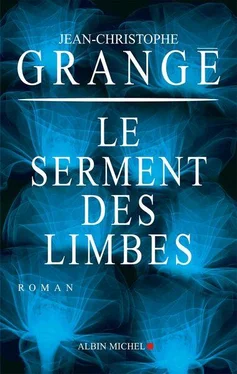— Et toi ? Si tu m’en disais un peu plus ?
À moi de donner quelques biscuits à Foucault :
— Le meurtre du gendarme, dans le Jura. Son nom, c’est Stéphane Sarrazin. Mais c’est un nom d’emprunt. En réalité, il s’appelle Thomas Longhini.
— Le môme qu’on cherchait ?
— Lui-même. Devenu gendarme, et sataniste à ses heures. Son meurtre est lié à mon affaire.
— De quelle façon ?
— Je ne sais pas encore. Appelle le SRPJ de Besançon et demande-leur s’ils ont des renseignements sur les relevés scientifiques chez Sarrazin. Il y avait une inscription sanglante sur les lieux.
— Tu y étais ?
— C’est moi qui ai découvert le corps.
— On peut pas te laisser cinq minutes.
— Ecoute-moi. Vérifie s’ils ont analysé l’inscription. S’il n’y avait pas des empreintes ou d’autres indices. Mais tu n’approches pas les gendarmes, compris ? Ils ne doivent pas savoir qu’on s’intéresse à ce coup. Encore moins la juge, une femme du nom de Corine Magnan.
— Rien d’autre, mon général ?
— Si. Contacte les Renseignements Généraux, leur groupe spécialisé dans les sectes. Vérifie s’ils ont un dossier sur un groupe satanique. Des mecs qui se font appeler les Asservis. Ou parfois les Scribes.
Silence. Foucault prenait des notes. En guise de conclusion, je dis :
— Avance sur tout ça. Je vais bientôt rentrer. Je te donnerai les détails à mon retour.
Je raccrochai. Ces coups de sonde ne menaient à rien mais j’étais de nouveau sur les rails. Et je nourrissais toujours l’espoir d’un croisement entre ces données. Un point d’intersection qui indiquerait non pas un nom, mais au moins une direction.
J’appelai Svendsen. Malgré l’heure tardive, son « allô » était vif. Dès qu’il reconnut ma voix, il piqua une gueulante :
— Qu’est-ce que tu fous ? Il n’y a pas moyen de te joindre ! Tu n’as même plus de messagerie !
— Je suis en Pologne.
— En Pologne ?
— Laisse tomber. J’ai besoin que tu fasses un truc pour moi.
— J’ai pas mal de nouveau.
— Je sais. Je raccroche d’avec Foucault.
Le Suédois émit un grognement, déçu de ne pas livrer lui-même ses trouvailles.
— Il y a eu un meurtre, à Besançon, enchaînai-je. Un gendarme.
— J’ai lu ça. Dans Le Monde d’hier soir.
Le meurtre avait donc retenu l’attention des quotidiens nationaux. C’était un signe. L’affaire Simonis allait exploser. Mon équipe devait désormais éviter non seulement les gendarmes mais aussi les médias, le poursuivis :
— Il va y avoir une autopsie. Je voudrais que tu appelles Guillaume Valleret, le légiste de l’hôpital Jean-Minjoz, à Besançon.
— Connais pas.
— Si. Souviens-toi : je t’avais demandé des infos sur lui.
— Le dépressif ?
— Lui-même. Demande-lui des précisions sur le corps.
— Pourquoi il me répondrait ?
— Il m’a déjà parlé, à propos de Sylvie Simonis.
— C’est la même affaire ?
— Le même tueur, à mon avis. Il joue avec la dégénérescence des corps. Vois avec Valleret s’il n’y pas eu un travail de ce type sur le gendarme.
— Le corps est déjà décomposé ?
L’odeur dans les narines, les mouches autour de moi, la céramique tachée de sang.
— Pas au même point que Sylvie Simonis mais le meurtrier a accéléré le processus.
— Tu as vu le cadavre ?
— Appelle Valleret. Interroge-le. Rappelle-moi.
— Ce tueur, c’est le mec que tu cherches depuis le début ?
Sur les carreaux de la salle de bains : « TOI ET MOI SEULEMENT. »Sur le bois du confessionnal : « JE T’ATTENDAIS. »C’était plutôt lui qui me cherchait. Je m’arrachai à mes pensées et conclus :
— Vois avec le légiste. C’est toi qui dois obtenir des réponses.
— Je l’appelle à la première heure.
Je coupai mon portable. Allongé, j’observais les murs qui m’entouraient. Noirs, épais, indestructibles. Les mêmes murs qui protégeaient Manon…
Tout de suite, elle revint au centre de mes pensées. Auréolée de pensées frémissantes, de fébrilité adolescente… « Non », fis-je en secouant la tête. J’avais parlé à voix haute. Je devais me concentrer sur l’enquête et rien d’autre. Interroger Manon Simonis. Sonder sa mémoire et quitter la Pologne. Avant de perdre toute objectivité à son sujet.
Mercredi 6 novembre.
Depuis deux jours, je déambulais dans Cracovie, toute la journée, prenant soin d’éviter Manon. Pas moyen d’affronter la princesse. J’avais contracté une maladie et me débattais encore, refusant de sombrer dans mon propre sentiment. On pouvait dire les choses autrement : j’étais déjà terrorisé à l’idée de ne pas lui plaire, de subir un échec…
J’en oubliais mon affaire, gaspillant ces journées à errer dans la ville, n’écoutant même pas mes messages. Ce matin pourtant, au réveil, j’avais décidé de m’y remettre. Je me levai et allumai mon cellulaire. J’écoutai ma boîte vocale. Foucault. Svendsen. Plusieurs fois, de plus en plus impatients. Je les rappelai aussi sec. Répondeurs. Il était 7 heures du matin.
Je m’habillai sans me doucher — trop froid — et allumai le PC. Mes e-mails. Toujours pas le dossier anglais de Raïmo Rihiimäki. Ni d’autre message notable. Je me connectai à mes journaux habituels. République des Pyrénées. Courrier du Jura. Est républicain. Les nouveaux articles sur les meurtres de Bucholz et de Sarrazin s’éteignaient à petit feu. Des coquilles vides. Je revins au présent. Une idée me travaillait en sourdine, depuis cette nuit. Fureter un peu au sein du couvent-monastère, dont les activités me paraissaient de plus en plus obscures, malgré la visite guidée de Zamorski.
J’avais tenté de retourner dans le quartier général souterrain. Impossible. Capteurs biométriques, caméras, cellules photoélectriques. La zone était surprotégée, plus fermée qu’un centre militaire. D’autres pièces, au rez-de-chaussée, offraient aussi leur part de mystère. La veille, j’avais tracé un plan rapide du cloître. Les bâtiments, autour de la cour centrale, se divisaient en deux « L » dévolus aux deux ordres : les Bénédictines au nord-est, les prêtres au sud-ouest. Chaque zone possédait sa chapelle, aucune aire commune, à l’exception du réfectoire, où hommes et femmes prenaient leurs repas en alternance. Je me concentrai sur la partie sud-ouest. J’avais grisé au crayon les parties déjà visitées. Au rez-de-chaussée, les bureaux administratifs. Ensuite, une bibliothèque. Des séminaristes y préparaient leur thèse sur des épisodes de l’histoire religieuse de la Pologne. Puis la chapelle et un espace de détente. Cela me laissait deux salles inconnues, à la jonction du L. Je pariai pour le bureau personnel de Zamorski et une salle de réunion secrète…
J’enfilai ma veste et me décidai pour un tour matinal. Les Bénédictines priaient — office de l’Angélus — et les prêtres prenaient leur petit déjeuner. L’heure idéale. Je remontai la promenade et descendis. Le jour se levait avec peine. À l’angle des deux galeries, je m’arrêtai face à la porte qui correspondait à la plus grande pièce — a priori, la salle secrète. Je sortis mon passe. Fraîcheur de la pierre. Odeur du buis et des cyprès. Le froid isolait chaque sensation. Je glissai la première clé et me rendis compte que la porte n’était même pas fermée.
Une nouvelle chapelle.
Plus longue, plus étroite, plus mystérieuse.
Des fenêtres étrécies révélaient le bleu de l’aube. Des rangées de chaises, surmontées de pupitres aux couvercles fermés, se succédaient jusqu’au chœur. Pas d’autel, pas de croix. Seulement une rosace au vitrail blanc au fond, qui paraissait froissé comme du papier d’argent. Je fis quelques pas. Ce qui frappait ici, c’était la qualité exceptionnelle du silence et la pureté du froid. Mes yeux s’habituaient à la pénombre. Je discernais maintenant des couleurs. Les colonnes étaient blanches, le sol en terre cuite, d’un ocre doux, l’enduit des murs vert pastel. Il n’y avait rien pour moi dans ce lieu mais une force me poussait à y rester.
Читать дальше