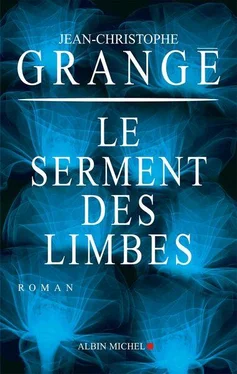— On peut se tutoyer, non ? Je disais que j’ai pas souvent de visites, ici.
— Vous… tu t’ennuies ?
— Je m’emmerde carrément, tu veux dire.
Nos répliques paraissaient réglées comme dans un film, sauf qu’elles n’avaient aucune logique, aucune cohérence : on avait mélangé les pages du script.
— Avant, reprit Manon, j’étais étudiante en biologie. J’avais des amis, des examens, des cafés où j’aimais traîner. J’étais guérie de mes peurs anciennes, de mon état d’alerte perpétuel…
Elle avait replié une jambe sous sa cuisse, et tirait sur les franges de son jean :
— Et puis, il y a eu l’été dernier. Ma mère a disparu. Je me suis retrouvée seule face aux flics, menacée par je ne sais quoi, je ne sais qui. Le cauchemar est revenu d’un coup. Andrzej est apparu et il m’a convaincue de venir me réfugier ici. Il est très persuasif. Aujourd’hui, je ne sais plus où j’en suis. Mais au moins, je me sens en sécurité.
La pluie. Une nouvelle fraîcheur se mit à tournoyer dans la galerie. Je conservai le silence. Mon expression devait être sinistre. Manon eut un nouveau rire et me caressa la joue :
— J’espère bien que tu vas rester ! On s’emmerdera à deux !
Le contact de ses doigts m’électrisa. Mon désir disparut au profit d’une sensation plus vaste, plus universelle. Une ivresse qui ressemblait déjà à l’engourdissement de l’amour. J’étais pris au piège. Où était la Manon que j’avais imaginée ? La petite possédée qui avait traversé la mort ? La femme soupçonnée de meurtre, de pacte avec le diable, de propagation funeste ?
— C’est l’heure de Radio Vatican ! s’écria-t-elle en regardant sa montre. C’est la seule distraction, ici. On n’a même pas la télé. Tu le crois, ça ?
Elle se leva. La pluie s’engouffrait dans la galerie avec une liesse bruyante, déposant des gouttelettes sur nos visages :
— Viens. Après, on se fera un petit bortsch !
Cette nuit-là, dans ma chambre monacale, j’affrontai mon ennemi le plus intime. Le désert de ma vie sentimentale.
Dans ce domaine, j’avais connu deux périodes distinctes. Le premier âge avait été celui de l’amour de Dieu. Sans faille ni corruption. Jusqu’au séminaire de Rome, il n’avait pas été question pour moi d’aventures féminines. Je n’en éprouvais aucune souffrance, aucun manque : mon cœur était pris. Pourquoi craquer une allumette dans une église remplie de cierges ?
L’illusion tenait. Parfois, bien sûr, des pulsions venaient torturer ma conscience, des silex déchirer mon bas-ventre. J’entrais alors dans un cycle épuisant de masturbations, de prières, de pénitences. Une chambre de torture bien personnelle…
Tout avait changé en Afrique.
La terre, le sang, la chair m’attendaient là-bas. À la veille du génocide rwandais, j’avais franchi la ligne, au fond d’une cabane de tôle ondulée. Je ne m’en souvenais pas. Ou comme on se souvient d’une collision en voiture. Un choc, un bouleversement interne qui annulait toute circonstance extérieure. Je n’avais pas éprouvé la moindre jouissance, le moindre sentiment. Mais j’en avais retiré une certitude : cette femme, éclat de peau, éclat de rire, m’avait sauvé la vie.
J’avais ressenti pour elle une sourde reconnaissance, au nom de cette déflagration, de cette libération survenue en moi. Sans cette rencontre, à terme, je serais devenu fou. Pourtant, ce matin-là, j’avais pris la fuite sans un adieu. J’étais parti comme un voleur, les dents serrées, à travers la ville. Et dans les rues de Kigali, la radio des Mille Collines déversait toujours ses appels à la haine…
Je m’étais réfugié dans une église à Butamwa, au sud de Kigali, et j’avais prié sans dormir durant trois jours, implorant le pardon du ciel, tout en sachant que je ne pouvais rien effacer et que, d’une certaine façon, j’allais maintenant mieux prier, mieux aimer Dieu.
Désormais, j’étais libre. J’avais enfin accepté ma nature : incapable de résister à la chair, à sa violence. Ce n’était pas un problème extérieur — la tentation — mais intérieur : je ne possédais pas ce verrou, cette capacité à dépasser mon propre désir. Enfin, j’étais sincère avec moi-même et j’accédais, d’une manière contradictoire, à une plus grande pureté d’âme. J’en étais là de mes réflexions quand, dans mon repaire, les premiers réfugiés arrivèrent.
On était le 9 avril.
L’avion du président Juvénal Habyarimana venait d’être abattu.
Tout de suite, j’avais songé à la femme — je l’avais quittée sans un regard, sans un baiser. Or, elle était tutsi. J’étais reparti à Kigali, la cherchant dans les églises, les écoles, les bâtiments administratifs. Je n’avais qu’une pensée : elle m’avait sauvé la vie et je n’étais pas là pour lui éviter la mort.
J’avais poursuivi mes recherches jour et nuit, m’enfonçant peu à peu parmi les cadavres. Le long des routes, dans les fossés, près des barrages, puis dans les charniers, où les morts s’entassaient, sanglants, débraillés, obscènes. Je plongeais mon regard, soulevais les têtes, les boubous. Mes mains puaient la mort. Mon corps puait la mort — et l’amour en moi, l’amour physique, me semblait être à l’image de ces victimes en décomposition. Un cadavre au fond de moi. Jamais je n’avais retrouvé la femme.
Les semaines suivantes, j’avais dérivé. Les massacres, les fosses ouvertes, les autodafés. Dans cet enfer, j’avais encore cherché l’amour. J’avais eu d’autres maîtresses, dans les camps humanitaires de Kibuye, à la frontière du Zaïre. Je ne cessais de penser à la disparue de Kigali. Le remords, le dégoût me submergeaient. Pourtant, parmi les miasmes de choléra et de pourriture, alors que les pelleteuses ensevelissaient les corps par milliers, je continuais à faire l’amour, au hasard, trouvant des partenaires sous les tentes aveugles, gagnant une nuit, une heure, contre le néant et la culpabilité. J’étais dans un état second et, comme tous les autres, submergé par l’effroi, la panique, le désespoir.
Ma crise de paralysie conclut cette frénésie sexuelle. Retour sanitaire en France. Transfert au Centre Hospitalier Sainte-Anne, à Paris. Là, le désir mourut avec la dépression — et les médicaments. Enfin, j’étais anesthésié. La bête était assommée.
Calme plat durant des années.
Plus la moindre attirance pour les femmes.
Puis mon orgueil chrétien était revenu à la surface. De nouveau, je jurai un amour exclusif à Dieu. Pas question de partager mon cœur, ni mon corps qui n’étaient destinés qu’au Seigneur. Je m’enfonçai dans une nouvelle impasse :
Je n’avais plus la force d’être prêtre.
Je n’avais pas le courage d’être un homme.
Mon métier de flic vint à mon secours. Capitaine à la BRP, les « mœurs », je commençai à croiser les seuls êtres qui pouvaient m’aider : les prostituées. L’amour sans amour : telle était ma voie. Soulager mon corps sans engager l’esprit. C’était la solution tordue que j’avais trouvée.
J’avais gardé le goût de la peau noire — le sceau de la première fois. Je multipliai les rencontres au Keur Samba et au Ruby’s. Je m’orientai aussi vers les réseaux cachés des agences de rencontres franco-asiatiques. Viets, Chinoises, Thaïes…
L’exotisme, les langues inconnues jouaient le rôle de filtres, de barrages supplémentaires. Impossible de tomber amoureux d’une femme dont on comprenait à peine le prénom. Je me livrais ainsi à mes fantasmes, exigeant l’humiliation, la possession, la domination de mes partenaires, les réduisant à de simples objets sexuels, glissant mon cœur dans une espèce de gangue protectrice abjecte. Vous aurez mon corps, pas mon âme !
Читать дальше