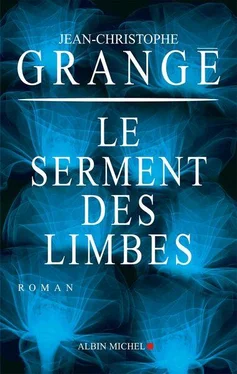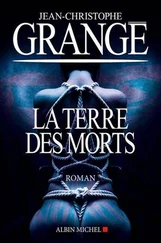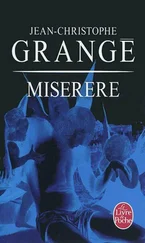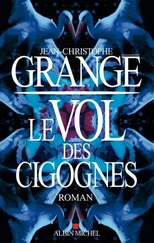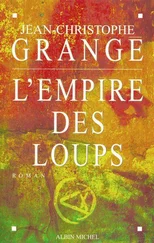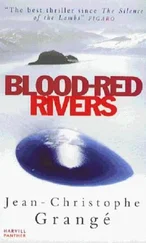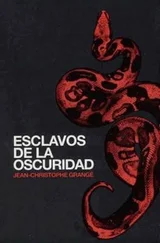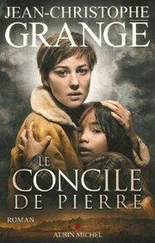— Racontez-moi toute l’histoire. C’est très important.
Mon ton suppliant m’avait trahi. Il demanda, intrigué :
— Pour votre enquête ou pour vous-même ?
— Quelle différence cela fait ?
— Votre enquête : où en est-elle ?
— Je vous le dirai quand vous m’aurez parlé. Ce que vous allez me dire déterminera la signification de tout le reste.
Il eut un hochement de tête. Il prenait bonne note. Il rangea le classeur qu’il tenait encore puis libéra un profond soupir, comme s’il devait se plier à un devoir, écrit sur les tables de la Loi. Il s’assit en face de moi :
— Vous connaissez l’affaire. Je veux dire : d’un point de vue criminel. Vous savez qu’un appel anonyme a orienté les recherches vers un puits où…
— Je connais le dossier par cœur.
— Les gendarmes se sont donc orientés vers les puits les plus proches de la cité des Corolles. Ils étaient déjà accompagnés par une équipe de médecins. Quand les urgentistes ont découvert l’enfant, ils ont constaté sa mort. Pupilles fixes, cœur arrêté, température centrale à 23°. Aucun doute sur le décès. Pourtant, le médecin, un homme du nom de Boroni, avait travaillé dans mon service l’année précédente. Il connaissait ma spécialité.
— Quelle est au juste votre spécialité ?
Depuis le départ, je ne voyais pas ce qu’un chirurgien cardiovasculaire avait à voir avec la réanimation.
— L’hypothermie, répondit Beltreïn. Depuis près de trente ans, je m’intéresse aux phénomènes physiologiques provoqués par le froid. Comment, par exemple, l’irrigation sanguine du corps peut ralentir dans de telles circonstances. Mais revenons à Manon. Cet homme, Boroni, savait qu’en cas de grand froid, il reste un espoir, infime, lorsque la mort est déclarée. Il a donc procédé comme si l’enfant était vivante. Il a appelé l’hélicoptère qui participait aux recherches et m’a contacté au CHUV. Si on compte le temps du trajet, le corps allait être privé de vie durant au moins soixante minutes. Ce qui réduisait nos chances à zéro. Pourtant, cela valait le coup de tenter ma méthode. Savez-vous ce qu’est une machine « by-pass » ?
Le nom réveillait des souvenirs vagues. Beltreïn poursuivit :
— Dans chaque bloc opératoire, il existe une machine de circulation extracorporelle qu’on utilise pour refroidir le sang des patients avant une importante intervention. Le système consiste à extraire le sang du malade, à le refroidir de quelques degrés, puis à le réinjecter. On pratique cette opération plusieurs fois afin de créer une hypothermie artificielle.
Mon souvenir se précisa. On avait eu recours à cette même machine pour sauver Luc. Ironie incroyable de l’histoire. J’achevai son exposé :
— Vous vouliez l’utiliser de manière inverse, afin de réchauffer le sang de l’enfant.
— Exactement. J’avais déjà tenté cette expérience, une première fois, en 1978, sur un petit garçon mort d’asphyxie. La méthode avait permis de le réanimer. Dans les années quatre-vingt, j’ai réitéré plusieurs fois l’opération. Aujourd’hui, c’est une technique couramment utilisée, aux quatre coins de la planète. (Un sourire d’orgueil lui échappa.) Une technique dont je suis l’inventeur.
Il laissa passer un intervalle, afin que je mesure toute la grandeur de son génie, puis continua :
— Le sang de Manon est passé une première fois dans la machine puis a été réinjecté, à la même température, mais réoxygéné. Nous avons ensuite tenté un nouveau cycle, cette fois à 27°, puis un autre, à 29… Lorsque nous avons atteint 35°, les moniteurs ont marqué un signe. Après un nouveau cycle, les oscillations ont repris sur les écrans. À 37°, les battements cardiaques sont devenus réguliers. Manon, après avoir été cliniquement morte pendant près d’une heure, était revenue à la vie.
Les explications de Beltreïn cadraient avec ma volonté cartésienne. Pour la première fois, on ne me parlait pas de miracle. Ni de Dieu, ni du diable. Seulement d’une prouesse médicale. Le toubib parut suivre ma pensée :
— La rémission de Manon ressemblait à un prodige. Elle s’expliquait en réalité par la convergence de trois facteurs favorables, qui tenaient tous à l’âge de la petite fille.
— Quels facteurs ?
— D’abord, les proportions de son corps. Manon était une enfant chétive. Elle ne pesait pas quinze kilos. Ce poids a favorisé un refroidissement immédiat. Son corps s’est mis en hibernation. Le cœur a commencé à battre plus lentement — de quatre-vingts pulsations-minute, il est descendu à quarante pulsations. Les réactions biochimiques ont diminué elles aussi. La consommation d’oxygène des cellules a considérablement baissé. Ce fait est essentiel. Il a permis au cerveau de fonctionner encore, en bas régime, alors qu’il n’était plus irrigué par la circulation sanguine.
Beltreïn était lancé, mais je l’interrompis :
— Vous parlez d’un corps qui tournait au ralenti, mais Manon était déjà noyée, non ? Ses poumons devaient être saturés d’eau.
— Justement non. C’est le deuxième facteur positif. La petite fille s’est asphyxiée, elle ne s’est pas noyée. Pas une goutte d’eau n’a pénétré sa gorge.
— Expliquez-vous.
— Les enfants possèdent un « diving reflex ». Pensez aux bébés nageurs. Lorsqu’on les immerge, ils ferment instinctivement leurs cordes vocales afin d’empêcher l’eau de pénétrer dans leurs poumons. Dans le puits, Manon s’est coupée de l’environnement extérieur et s’est mise à fonctionner en circuit fermé.
J’eus une vision, fantasmagorique, de l’intérieur du corps de Manon. Les organes rouges et noirs, battant à très faible rythme, préservant la moindre parcelle de vie dans l’eau glacée. Beltreïn rajusta ses lunettes :
— Il y a des théories au sujet de ce réflexe. Certains pensent qu’il s’agit d’un vestige archaïque, lié à nos origines aquatiques. Quand un dauphin ou une baleine plonge sous l’eau, un mécanisme inné coupe instantanément sa respiration et concentre son sang vers les organes vitaux. C’est exactement ce qui s’est passé pour Manon. Le temps de son immersion, elle s’est transformée en petit dauphin. Elle s’est réfugiée, pour ainsi dire, au fond d’elle-même. De là à évoquer une paléomémoire…
À nouveau, Beltreïn se tut, laissant planer les résonances de son discours. Le prodige de cette survie était plus spectaculaire encore qu’il ne le pensait. Une petite fille soi-disant possédée, assassinée par sa mère, avait survécu grâce à sa mémoire de dauphin…
— À ce stade, reprit-il, il faut que vous compreniez un fait essentiel. Il n’y a pas eu lutte.
— Vous voulez dire entre Manon et son assassin ?
— Non. Entre Manon et la mort. Elle ne s’est pas débattue. Le froid l’a aussitôt saisie et pétrifiée. C’est à cela qu’elle doit sa survie.
Le moindre effort aurait précipité sa noyade. D’une certaine façon, la petite fille a accepté la mort. C’est un des secrets de mes recherches. Si on accepte le néant, si on se laisse glisser vers lui, on peut demeurer en suspens dans une sorte… d’intermonde. Une demi-mort, qui est aussi une demi-vie…
Je songeai à cette parenthèse cruciale dans l’existence de la petite fille. Qu’avait vu Manon durant ce « temps d’arrêt » ? Le diable, vraiment ? Pour l’heure, je me concentrai sur les aspects physiologiques de sa traversée :
— Vous avez parlé de trois facteurs.
— J’aime les policiers, sourit-il. Vous êtes des élèves attentifs.
Il fit claquer ses lèvres :
— Le troisième facteur concerne la rémission complète de Manon. Malgré tout ce que je vous ai expliqué, on pouvait craindre de graves séquelles. Or, à son réveil, Manon était en parfaite possession de ses fonctions cognitives. Pas de problème d’élocution. Pas de difficultés de raisonnement. Seule sa mémoire marquait une relative amnésie. Mais son cerveau fonctionnait à merveille.
Читать дальше