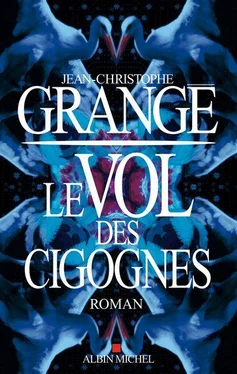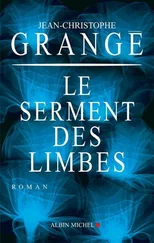Puis vint ce jour de pluie où je sonnai à sa porte. À bien des égards, j’étais le visiteur du malheur. D’abord, je le forçais à se plonger dans l’affaire Rajko. Ensuite, confusément, je lui rappelais, par une ressemblance physique, des terreurs oubliées. Sur l’instant, il ne sut définir d’où lui venait cette impression de déjà-vu. Pourtant, les semaines suivantes, mon visage revint le hanter. Peu à peu, il se souvint. Il mit des noms et des circonstances sur mes traits. Il comprit ce que j’ignorais encore : le lien du sang qui m’unissait à Pierre Sénicier.
Lorsque je lui téléphonai, à mon retour d’Afrique, Djuric m’interrogea. Je ne répondis pas. Sa conviction s’approfondit. Il devina aussi que j’approchais du but, l’affrontement avec l’être diabolique. Il prit l’avion à destination de Paris. Là, il me surprit alors que je rentrais de la demeure des Braesler, le matin du 2 octobre. Il me suivit jusqu’à l’ambassade indienne, se débrouilla pour connaître ma destination, puis demanda à son tour un visa pour le Bengale, sur son passeport français.
Le 5 octobre, au matin, le médecin était encore sur mes traces, près du centre Monde Unique. Il reconnut Pierre Doisneau/Sénicier. Il m’emboîta le pas jusqu’au Marble Palace. Il savait que le temps de l’affrontement était venu. Pour moi. Pour lui. Pour l’autre. Mais le soir, il ne put se glisser à temps dans la demeure de marbre. Lorsqu’il pénétra dans le palais, il avait perdu ma piste. Il longea les colonnes, les cages des corneilles, monta l’escalier du patio, fouilla chaque pièce et découvrit enfin Marie-Anne Sénicier, prisonnière et blessée. Son époux l’avait torturée afin de connaître les raisons de son émotion. Djuric la libéra. La femme ne dit rien — ses mâchoires étaient entravées par de multiples pointes sanglantes — mais elle courut en direction du bunker. Elle savait que le piège s’était refermé sur moi. Lorsqu’elle pénétra dans le laboratoire, Djuric dévalait seulement les marches de marbre. La suite des événements restera à jamais imprimée sur les plaques sensibles de mon âme : l’attaque de Pierre Sénicier, sa lame aveuglante tranchant le cou de ma mère, et mon arme impuissante à anéantir le monstre. Quand Djuric apparut et tira sa rafale d’Uzi, je crus à une hallucination. Pourtant, avant de plonger dans les ténèbres, je sus que mon ange gardien m’avait sauvé des griffes de mon père. Un ange pas plus haut qu’une borne d’incendie, mais dont la vengeance transversale avait gravé dans la faïence l’épitaphe finale de toute l’aventure.
Il était six heures du matin. À mon tour je racontai mon histoire. Lorsque j’eus achevé mon récit, Djuric ne fit aucun commentaire. Il se leva et m’expliqua son plan pour les heures à venir. Durant toute la nuit, il avait travaillé au bouclage définitif du laboratoire. Il avait anesthésié les rares enfants vivants, puis leur avait injecté de fortes doses d’aseptiques. Il avait aidé ces victimes à s’enfuir, espérant que ces êtres difformes trouveraient leur juste place dans la capitale des maudits. Il avait ensuite découvert Frédéric, mon frère, qui avait succombé dans ses bras en appelant sa mère. Puis il était retourné dans le bunker et avait regroupé les cadavres dans la salle principale, afin de les brûler. Il m’attendait pour allumer le bûcher et maîtriser les flammes. « Les Sénicier ? » demandai-je après un long silence.
Djuric répondit d’un ton égal :
— Soit nous brûlons leurs corps avec les autres, soit nous les portons à Kali Ghat, sur les berges du fleuve. Là-bas, des hommes se chargent d’incinérer les cadavres, selon la tradition indienne.
— Pourquoi eux et pas les enfants ?
— Il y en a trop, Louis.
— Brûlons Pierre Sénicier ici. Nous emporterons ma mère et mon frère à Kali Ghat.
A partir de cet instant, ce ne fut que flammes et chaleur. La faïence explosait dans la fournaise, l’odeur de viande grillée nous montait à la tête à mesure que nous nourrissions l’atroce foyer de corps humains. Mes mains brûlées me permettaient d’ordonner au plus près le brasier. Mon esprit n’était qu’absence, alors que je replaçais dans le feu les membres qui s’en échappaient. La lourde fumée s’évacuait par les soupiraux ouverts sur le patio. Nous savions que ces exhalaisons allaient attirer les serviteurs et réveiller les habitants du quartier. Ils viendraient éteindre le feu et constater les dégâts. Obscurément, je songeai à l’incendie de la clinique auquel le petit Milan avait échappé, malgré ses jambes atrophiées. Je songeai à Bangui, lorsque ma mère avait sacrifié mes mains pour me sauver la vie. Djuric et moi étions tous deux des fils du feu. Et nous brûlions là notre dernier lien avec ces origines infernales.
Aussitôt après, nous empruntâmes un break dans le garage, glissâmes à l’arrière les corps de Marie-Anne et de Frédéric Sénicier. Je pris le volant, c’est Djuric qui me guidait à travers les ruelles de Calcutta. En dix minutes, nous atteignîmes Kali Ghat. Le quartier était traversé par une rue étroite et interminable, qui longeait de petits affluents du fleuve, aux eaux mortes et verdâtres. Des bordels succédaient à des ateliers de sculptures religieuses. Tout semblait dormir.
Je conduisais machinalement, scrutant le ciel atone qui se découpait entre les toits et les câbles électriques. Tout à coup, Djuric m’arrêta. « C’est là », dit-il en m’indiquant une forteresse de pierre, sur la droite. Le mur d’enceinte était surmonté de plusieurs tours en forme de pains de sucre, ciselées d’ornements et de sculptures. Je garai la voiture pendant que Djuric franchissait l’entrée. Je le rejoignis aussitôt et pénétrai dans une vaste cour intérieure, à l’herbe rase.
Aux quatre coins, des fagots de bois brûlaient. Autour, des hommes squelettiques attisaient les feux, maintenant les braises en un foyer compact, à l’aide d’un long bâton. Les flammes lançaient des éclats livides et dégageaient d’épais nuages de fumée noire. Je reconnus l’odeur, celle de la chair calcinée, et aperçus une main s’échapper de l’un des brasiers. Sans sourciller, un homme ramassa le débris humain, puis le replaça dans les flammes. Exactement comme je l’avais fait moi-même, quelques minutes auparavant. Je levai les yeux. Les tours de pierre se dressaient dans l’aube grise. Je m’aperçus que je ne connaissais aucune prière.
Au fond de la cour, Djuric parlait avec un homme âgé. Il s’exprimait avec fluidité en bengali. Il donna une épaisse liasse de roupies au vieillard, puis revint dans ma direction.
— Un brahmane va venir, m’expliqua-t-il. Une cérémonie sera organisée dans une heure. Ils disperseront les cendres dans le fleuve. Tout se passera comme pour de véritables Indiens, Louis. Nous ne pouvons faire mieux.
J’acquiesçai, sans rien ajouter. Je scrutai deux Bengalis qui venaient d’allumer un large fagot, sur lequel reposait un corps drapé de blanc. Djuric suivit mon regard puis murmura :
— Ces hommes sont des Doms, la caste la plus basse dans la hiérarchie indienne. Eux seuls sont autorisés à manipuler les morts. Il y a des milliers d’années, ils étaient chanteurs et jongleurs. Ce sont les ancêtres des Roms. Mes ancêtres, Louis.
Nous portâmes la tête et le corps de Marie-Anne Sénicier ainsi que celui de Frédéric enveloppés dans un drap. Nul ne pouvait soupçonner qu’il s’agissait d’Occidentaux. Djuric s’adressa de nouveau au vieil homme. Cette fois il parla plus fort et le menaça du poing. Je ne comprenais rien. Nous partîmes aussitôt après. Avant de monter dans la voiture, le nain hurla encore quelque chose au vieillard, qui hocha la tête d’un air craintif et haineux. En route, Djuric m’expliqua :
Читать дальше