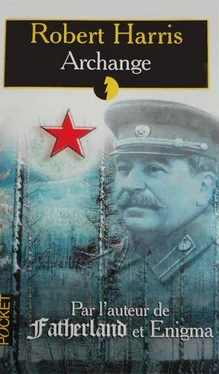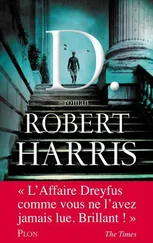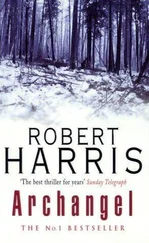Le bateau était dissimulé dans un petit creux, protégé du fleuve par un rideau d’arbres bas. On ne pouvait donc le voir depuis le fleuve. C’était une robuste embarcation, qui pouvait transporter, au besoin, quatre personnes. Elle était dressée sur la quille, maintenue par des rondins à bâbord et à tribord. Une protubérance à la poupe suggérait un moteur hors-bord. Si c’était le cas, et si O’Brian parvenait à le faire marcher, ils pourraient être à Arkhangelsk en deux heures — probablement moins avec le courant rapide et l’embouchure du fleuve qui allait en se rétrécissant.
Il pensa aux croix dans le cimetière, aux dates, aux visages effacés.
Il ne semblait pas que beaucoup de gens eussent jamais pu quitter cet endroit.
Cela valait la peine d’essayer.
« D’accord, concéda-t-il à contrecœur. On n’a qu’à le tenter.
— Voilà qui est raisonnable. »
Il repartit donc dans les bois, laissant O’Brian orienter son antenne par-delà la Dvina. Il n’était pas allé bien loin lorsqu’il perçut le son aigu et réconfortant de l’Inmarsat captant enfin son satellite.
* * *
Le chasse-neige avançait vite maintenant, à environ 60 km/h sur la piste, projetant un grand arc blanc qui partait s’écraser de chaque côté, sur les arbres. Kretov conduisait. Ses hommes s’entassaient contre lui, leurs armes sur les genoux. Souvorine s’accrochait aux supports métalliques du strapontin, à l’arrière de la cabine, le canon du RP46 lui rentrant dans la cuisse, les vibrations et les émanations de diesel le rendant nauséeux. Il s’émerveilla de ce que tant de complexité eût soudain envahi sa vie, et médita nerveusement le bien-fondé du vieux proverbe russe : « Nous naissons dans un champ dégagé et mourons dans une forêt obscure. »
Il avait eu tout loisir de réfléchir dans la mesure où aucun de ses trois compagnons ne lui avait adressé la parole depuis qu’ils avaient quitté l’aérodrome. Ils se passaient des chewing-gum et des cigarettes TU-144, et discutaient à voix basse, de sorte qu’il ne pouvait rien entendre avec le vacarme du moteur. Un trio qui se connaissait bien, pensa Souvorine : de toute évidence une association qui avait une histoire. Quelle avait été leur dernière affectation ? Grozny, peut-être, Pour apporter la paix de Moscou aux rebelles tchétehènes ? (« Les tireurs terroristes sont tous morts sur place … ») Auquel cas cette affaire n’était pour eux qu’une vraie partie de plaisir. Un pique-nique dans les bois. Et qui leur donnait des ordres ? « Devinez… »
Blague signée Arseniev.
Il faisait chaud dans la cabine. L’unique essuie-glace effaçait les empreintes de neige avec une régularité soporifique. Il essaya de s’écarter de la mitrailleuse.
Serafima le tannait depuis des mois pour qu’il quitte son service et commence à gagner de l’argent. Son père connaissait quelqu’un à la direction d’un gros consortium privatisé spécialisé dans l’énergie (eh bien, disons simplement, mon cher Felix, que — comment dire ? — certaines faveurs sont encore dues). Et ça rapporterait combien, papa, exactement ? Dix fois son salaire officiel avec dix fois moins de travail. Qu’ils aillent tous se faire voir, à Iassenevo. Il était peut-être temps.
Une grosse voix masculine se mit à cracher dans la radio. Souvorine se pencha en avant. Il n’arrivait pas à comprendre exactement ce qu’elle disait. On aurait dit des coordonnées. Kretov tenait le micro dans une main, conduisant de l’autre, tendant le cou pour examiner la carte sur les genoux de son voisin et regardant la route. « Oui, oui, pas de problèmes. » Il raccrocha.
« Qu’est-ce que c’était ? demanda Souvorine.
— Ah ! s’exclama Kretov, jouant la surprise. Vous êtes toujours là. Tu as vu ça, Alexeï ? » Il s’agissait de l’homme à la carte. Puis, à l’adresse de Souvorine : « C’était la station d’écoute du lac Onega. Ils viennent d’intercepter une transmission satellite. »
« Vingt-cinq kilomètres, mon commandant. C’est juste sur le fleuve.
— Vous voyez ? fit Kretov en souriant à Souvorine dans le rétroviseur. Qu’est-ce que je vous avais dit ? Tout le monde à la maison avant la tombée de la nuit. »
Kelso sortit des bois et se dirigea vers la cabane. La neige avait gelé en surface et formait une mince croûte ; le vent avait forci et soulevait à travers la clairière de petites tornades de flocons. Le mince ruban de fumée brune qui s’élevait de la cheminée en fer dansait et sautait dans la bise.
« Quand on s’approche de Lui, le faire ouvertement. » Tel était le conseil de la servante. « Il déteste qu’on arrive sans bruit près de Lui. Quand il faut frapper à une porte, frapper fort. »
Kelso fit de son mieux pour faire résonner ses bottes en caoutchouc sur les marches de bois, puis il cogna vigoureusement sur la porte avec son poing ganté. Il n’y eut pas de réponse.
Que faire ?
Il frappa encore, attendit, puis souleva la clenche et poussa la porte. Immédiatement, l’odeur maintenant familière, froide, proche, animale , ajoutée aux relents de vieille pipe, le submergea.
La cabane était vide. Le fusil avait disparu. Il semblait que le Russe avait travaillé devant sa table : il avait disposé dessus des papiers et deux gros crayons.
Kelso resta un instant dans l’encadrement de la Porte, les yeux rivés sur les papiers, essayant de déterminer ce qu’il convenait de faire. Il regarda par-dessus son épaule. Il n’y avait pas signe de mouvement dans la clairière. Le Russe se trouvait probablement au bord de la rivière, en train d’espionner O’Brian. C’était leur seul avantage tactique : comme ils étaient deux et que lui était tout seul, il ne pouvait les surveiller tous les deux en même temps.
L’historien s’approcha avec hésitation de la table. Il n’avait l’intention que de jeter un coup d’œil, pas plus d’une minute ou deux, et cela ne lui prit sans doute pas beaucoup plus ; juste le temps de faire courir ses doigts sur cet amoncellement.
Deux passeports, rouges, rigides, quinze centimètres sur dix, avec un lion imprimé sur la couverture, et les mots PASS et NORGE, délivrés à Bergen, en 1968 : un jeune couple, tous deux semblables : cheveux longs, blonds, style hippies, la fille plutôt jolie dans le genre délavé ; il ne retint pas leur nom ; entrés en URSS par Leningrad, en juin 1969…
Des papiers d’identité, à l’ancienne, soviétiques, trois hommes différents : le premier, un jeune type à grandes oreilles portant des lunettes, un étudiant visiblement ; le deuxième, âgé d’une soixantaine d’années, buriné, sûr de lui, peut-être un marin ; le troisième, sale, des yeux globuleux, apparemment un gitan ou un vagabond ; les noms se mélangeaient…
Et enfin une pile de feuillets constituée, en fait, comme il put s’en rendre compte en les compulsant rapidement, de six documents distincts de cinq ou six pages chacun, agrafées ensemble et rédigées au crayon ou à l’encre avec des écritures différentes — l’une bien nette, l’autre hésitante, cette autre encore désordonnée, affolée — mais portant toujours, en haut de la première page, en lettres cyrilliques soigneusement tracées, le même mot : Confession .
Kelso sentait l’air glacé qui venait de la porte ouverte lui hérisser les cheveux sur la nuque.
Il replaça soigneusement la pile et s’en écarta, les mains légèrement levées comme pour se protéger. Une fois sur le seuil, il se retourna et trébucha sur les marches. Il s’assit alors sur les planches délavées et leva ses jumelles pour scruter le tour de la clairière. Il s’aperçut qu’il tremblait.
Читать дальше