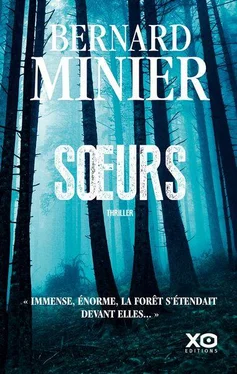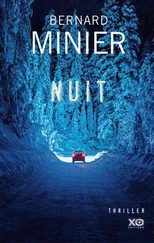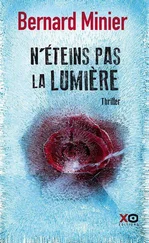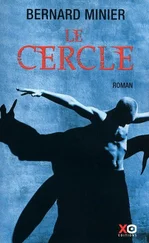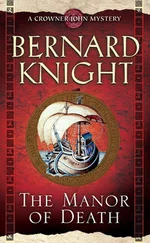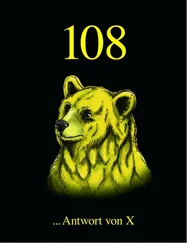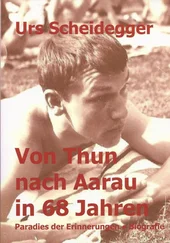Ils se tenaient serrés l’un contre l’autre, dans le canapé recouvert d’une couverture écossaise, les deux flics dans les fauteuils défoncés qui lui faisaient face, le bras du mari, du père passé autour des épaules de sa femme, mais on sentait que chacun était enfermé dans sa propre douleur. En un instant, une famille avait été saccagée, quatre vies brisées, ravagées de fond en comble, songea Servaz. Il n’en restait plus rien, sinon des morceaux qui jamais ne se recolleraient.
Tous deux avaient dans la soixantaine — ils avaient eu leurs filles tardivement — et Servaz imagina l’abîme qui devait exister entre eux. Le père devait avoir un visage jovial en temps normal, des yeux bleus un peu aqueux, un nez charnu et des favoris grisonnants, mais le chagrin le rendait méconnaissable. La mère était blonde et pâle et on devinait d’où les filles tenaient leur beauté ; elle tamponnait un mouchoir humide sur ses paupières gonflées, bordées de rouge, se mouchait dedans, et ses joues rebondies étaient griffées par la souffrance. Par intervalles, une crise de sanglots l’agitait et son mari la serrait un peu plus fort et la secouait légèrement, comme pour lui intimer de se reprendre, ce qu’elle faisait. Servaz n’avait jamais rencontré une douleur si énorme, si écrasante, sauf peut-être celle de son père au cimetière, à l’enterrement de sa mère — mais il avait dix ans alors, et le souvenir qu’il en gardait était flou, à part la sensation étrange qu’en cet après-midi ensoleillé où flottait le pollen des tilleuls il était le centre de toutes les attentions, que tout le monde voulait prendre dans ses bras et embrasser le petit garçon endimanché, sauf la seule personne contre laquelle il aurait voulu se presser, elle aussi enfermée dans sa douleur.
Sur le rebord de la fenêtre, là où la poussière dansait dans la lumière, se trouvait une photo encadrée de la famille au grand complet. Les filles devaient avoir six ou sept ans. Tout le monde avait l’air si heureux — et Servaz songea que rien n’est plus mensonger qu’une photo de famille. Une mouche bourdonnait contre la vitre, faisant ressortir le silence qui régnait.
— Est-ce qu’on peut voir leurs chambres ? demanda doucement Kowalski.
Le père acquiesça, les dents serrées. Il se leva. Les précéda vers l’escalier étroit mais ne monta pas. Posa une main sur le bras de Ko.
— Écoutez, commença-t-il, les gendarmes ne vous ont…
— Après, le coupa le chef de groupe. C’est par où ?
— Là-haut… Les deux portes à droite. Celle du fond, c’est la salle de bains. Celle de gauche notre chambre.
Il s’approcha de la fenêtre. Le soleil inondait les jardinets à l’arrière des maisons. Étroites, parallèles et séparées par des haies ébouriffées, les parcelles descendaient en pente douce vers une rivière qui se frayait un passage entre deux murailles de verdure. Servaz aperçut un bois sur l’autre rive, une balançoire en plastique orange, une table métallique et des chaises de jardin aussi rouillées que le portail, des dizaines de pots de fleurs posés de guingois sur l’herbe semée de pissenlits.
Dans un des jardins voisins, un homme taillait les feuilles grasses d’un laurier. Il portait un débardeur sale qui laissait voir des bras musculeux et tatoués, un peu mous. Sa calvitie luisait et il accomplissait sa tâche mécaniquement, d’un air renfrogné.
Servaz se retourna. Le soleil avait chauffé la chambrette sous les toits, et cette chaleur enclose, dans laquelle bourdonnaient des mouches, sentait la poussière des pièces demeurées inoccupées. Ici, le silence avait une autre qualité qu’en bas. C’était celui de l’absence. Servaz se dit que la pièce était moins triste que le reste de la maison, mais c’était sans nul doute dû aux rayons printaniers qui l’égayaient, et il ne put s’empêcher de penser à l’employé des pompes funèbres qui tenterait pareillement de donner un peu de couleur et de vie au visage d’Alice — et qui échouerait avec celui d’Ambre.
Il observa la chambre un moment. Par où commencer ? Elle était à l’image de celle qu’Ambre occupait à la cité U, même si le chaos y était moins grand. Peut-être parce que la mère était venue mettre un semblant d’ordre. Il entendit Kowalski remuer des tiroirs dans la pièce voisine et il se décida à bouger.
Sur le lit traînaient un walkman et des dizaines de CD qui brasillaient dans la lumière. Il ouvrit un placard et aperçut, suspendus à des cintres, un débardeur en jean au moins deux tailles trop grand, un bomber vert olive, des tee-shirts à l’effigie de groupes qu’il ne connaissait pas, une chemise aux carreaux rouges et vert foncé, un gilet noir et des Doc Martens. Une boîte à chaussures remplie d’élastiques, de pinces à cheveux multicolores, de tubes de rouge à lèvres et de vernis à ongles. Des culottes à fleurs et des chaussettes en laine dans un tiroir. C’était la première fois de sa vie qu’il fouillait dans les affaires de quelqu’un et il ne cessait de penser à Ambre, à son beau visage mutilé. Ambre était la plus belle des deux. Était-ce pour cela que son assassin s’était acharné jusqu’à effacer ses traits ?
Le bureau en bois blond bon marché ne supportait qu’une lampe, un pot de crayons et de trombones et un album photo. Il le parcourut. Sur les clichés les plus anciens, les filles devaient avoir quinze ou seize ans. Elles étaient presque toujours entourées de copines hilares ou faisant des grimaces, et les photos étaient accompagnées de commentaires ponctués de nombreux points d’exclamation. Sur deux d’entre elles cependant, Ambre et Alice étaient seules. Elles ne souriaient pas. La joie un peu factice des autres clichés avait totalement disparu. Leurs regards avaient exactement la même intensité et la même expression.
Il approcha le cliché de son visage et fut gagné par un nouveau malaise. Quel message les deux sœurs cherchaient-elles à transmettre en fixant ainsi l’objectif ? Il se demanda qui avait bien pu prendre cette photo.
Un petit ami ? Une copine ?
Certainement pas un parent — il en aurait mis sa main au feu. Ce double regard était trop ambigu, trop prometteur, trop obscur pour s’adresser à un membre de la famille.
Il referma l’album et sentit sous ses doigts l’épaisseur de la couverture. Ses yeux se hissèrent ensuite jusqu’à l’étagère de livres au-dessus du bureau. Une trentaine de volumes… À en juger par les titres, essentiellement des romans policiers. Serrés les uns contre les autres par deux galets, peut-être trouvés dans le lit de la rivière.
Brusquement, les poils de sa nuque s’électrisèrent. Son examen s’était arrêté sur un livre vers le milieu de la rangée : un roman au titre familier.
7.
Où il est question de livres et de lectrices
Il retint sa respiration. Écarta précautionneusement les autres livres avant de le tirer à lui. Comme s’il manipulait un ouvrage très ancien, comme si ces volumes et ces pages allaient tomber en poussière. Il détailla la couverture : la photo d’une jeune fille debout au pied d’un grand arbre — un peuplier ou un tremble —, les pieds nus sur un parterre de pâquerettes. Vêtue de blanc. Telle une mariée. Ou une communiante … Sa robe blanche dessinait des plis verticaux de la ceinture à ses pieds, pareils aux crevasses longitudinales qui creusaient le tronc de l’arbre voisin. Une grosse croix pendait en sautoir sur sa poitrine.
Le livre s’intitulait La Communiante , il était signé d’un certain Erik Lang.
Servaz fronça les sourcils. Qu’est-ce que ça signifiait ? Il eut l’impression que sa gorge s’asséchait. Il souleva la couverture, chercha la date de première parution. 1985. Revint aux autres livres sur l’étagère. Il y avait trois titres du même Lang. Que se passait-il ici ? Deux cadavres vêtus en communiantes et à présent ça : qu’est-ce que cela pouvait bien vouloir dire ?
Читать дальше