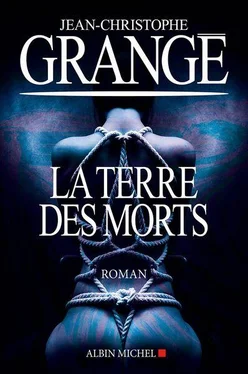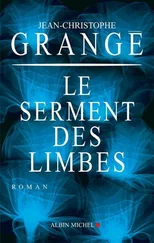— Tu te démerdes. Tu répartis les tâches, tu organises le boulot. Tu sais bien qu’en mon absence, tu es la seule à pouvoir tenir la boutique.
Barbie fut sans doute flattée par ce compliment mais elle ne releva pas.
— Et Ludo ?
— Tu le traites exactement comme d’habitude. Il va se défoncer plus que jamais sur l’enquête.
— Qu’est-ce que je dis aux autres ?
— Qu’on a dû libérer Sobieski à cause de ma visite nocturne. Le message est le suivant : il faut vraiment s’arracher. Sobieski est un ennemi hors gabarit.
— OK. Je peux te dire quelque chose ?
— Non, moi je veux te dire quelque chose : je te charge personnellement de trouver sa planque. Retourne ses comptes en banque, ses factures, ses cartes de crédit. Si tout se passe bien, je serai de retour ce soir.
Il raccrocha et se répéta qu’il filait dans la juste direction. Il voyageait dans le même train que Sobieski et rien ne pouvait se passer durant les deux heures à venir.
Il se détendit et s’enfonça dans son siège. Mais le fumier ne quittait pas ses pensées. Pourquoi ce trip en Grande-Bretagne ? Mille autres questions déferlèrent. Comment avait-il pu convaincre ses deux maîtresses de mentir pour ses beaux yeux — qui étaient horribles ? Comment avait-il enlevé Sophie et Hélène ? Leur avait-il donné rendez-vous ? Quelle technique utilisait-il pour les contacter ? Où opérait-il ?
Sa cogitation fut brutalement interrompue par une sirène. Il réalisa que le train filait déjà sous la Manche et qu’on avait activé la sonnette d’alarme. Sobieski .
Le train ralentit aussitôt. Alors que la sirène continuait à mugir, résonnant dans le tunnel comme dans un accélérateur de particules, la file des voitures s’arrêta en quelques secondes. D’un coup, le tunnel s’alluma — des agents, des pompiers, tous revêtus de chasubles jaune fluorescent, apparurent sur les trottoirs qui bordaient la voie. Les passagers se levaient, s’agitaient, s’apostrophaient. On parlait de panne technique, d’incendie, d’agression…
Les portes de la voiture s’ouvrirent dans un soupir. Les agents de sécurité demandèrent à chacun de sortir, sans prendre ni sac ni valise. Il ne fallait pas s’inquiéter : on allait passer dans la galerie de service et être aussitôt à l’abri de tout danger. Corso s’en souvenait : le tunnel sous la Manche était en réalité constitué de trois galeries — celle du sud qui menait en Angleterre, celle du nord qui allait en France, et celle du milieu, utile aux travaux de maintenance et à l’évacuation des passagers en cas de problème. On y était en plein, camarades !
Corso suivit le mouvement, se demandant encore si ce barouf n’était pas un coup de Sobieski. Quand il fut avec les autres, en file indienne le long du train, il interpella un des agents pour obtenir des informations (avec leur chasuble jaune et leur casque à lampe frontale, ils évoquaient les Minions du film éponyme). On ne lui répondit pas. Dans les rangs, les rumeurs s’amplifiaient, privilégiant l’hypothèse d’un début d’incendie.
Pourtant, pas la moindre odeur suspecte. Au contraire, un courant d’air frais plutôt agréable circulait dans le tunnel. La colonne se mit en marche dans un calme et un silence étranges, comme si cette manœuvre n’était qu’un exercice de simulation.
De temps en temps, Corso se hissait sur la pointe des pieds pour tenter d’apercevoir l’homme au chapeau. Personne.
Le décor était écrasant. D’un côté, l’Eurostar à l’arrêt paraissait plus gigantesque encore sous la chape du tunnel. De l’autre, la paroi concave de la galerie évoquait l’intérieur d’un tuyau titanesque. Le plus troublant, c’était la répétition hypnotique de l’armature constituée de voussoirs, éléments préfabriqués qui s’alignaient en reproduisant invariablement les mêmes lignes, les mêmes surfaces.
Corso percevait autour de lui l’angoisse qui montait. Passé l’effet de surprise, chacun semblait comprendre où il était : à près de cent mètres sous le niveau de la mer, au milieu de couches géologiques inconnues, avec sur la tête une masse d’eau de plus de quatre mille kilomètres cubes.
Alors que la panique était proche, un vent furieux s’engouffra soudain dans le boyau. Certains passagers manquèrent de tomber, d’autres s’accroupirent, d’autres encore s’accrochèrent à leur voisin. On venait d’ouvrir le sas de communication du couloir de service. Nouveau souvenir : celui-ci était surpressurisé afin de repousser flammes et fumée en cas d’incendie.
Courbés, pliés, arc-boutés, ils avancèrent jusqu’au rameau de communication, une porte coupe-feu de couleur jaune cernée par un enchevêtrement de canalisations. Corso se décida à doubler la file, en quête du borsalino de Sobieski. Cette agitation pouvait permettre au prédateur de fuir. Mais où ?
Presque aussitôt, il se fit refouler par un des Minions. C’est alors qu’il le vit : Sobieski était en train de passer le seuil qui séparait les deux taupinières. Une main sur son chapeau, sac à dos noir dans le dos, sur lequel, bizarrement, un tapis de sol était roulé, il ressemblait à un vieux routard partant pour un trekking.
Corso sentait l’imminence d’une embrouille sans pouvoir la définir. Il tenta une nouvelle sortie de file et accéléra le pas dans la tempête — le vent devenait de plus en plus glacé.
Cette fois, c’est un pompier qui l’attrapa par l’épaule.
— Holà, calmez-vous ! ordonna l’homme en français. Y a pas d’urgence. On va attendre ici.
— Attendre quoi ? demanda Corso en montrant sa carte de flic.
L’homme ne parut pas éprouver une complicité excessive mais répondit :
— Soit la confirmation qu’y a plus de danger, soit un nouveau train sur la rame nord.
— Quel danger au juste ?
Le pompier le poussa vers les autres sans répondre, puis repartit remettre un peu d’ordre ailleurs. Ils passèrent le seuil et Corso se haussa encore une fois pour vérifier que Sobieski était bien dans la galerie de service.
Le salopard n’était plus là. Cette fois, pas d’hésitation : il recula d’un pas et se glissa le long des voussoirs. Luttant contre le vent plus violent encore de ce côté, il longea la file, fléchissant les jambes, une main sur le mur arrondi, courbé comme un voleur.
Parvenu à la hauteur de la place de Sobieski, il ne put que constater sa disparition. Il fit encore un pas de côté afin d’embrasser d’un regard la suite de la colonne. Pas de peintre à chapeau. Où avait-il pu disparaître ? Et surtout, pourquoi ? À quoi rimait de rester tanqué sous la mer ?
Corso marcha encore à contre-vent jusqu’à la tête de file, où agents de sécurité et pompiers discutaient en alternant français et anglais. Il vit alors une porte dérobée dans la paroi qu’il tenta aussitôt d’ouvrir. Fermée bien sûr. Il se rappelait que le moindre verrou dans le tunnel était actionné par des postes de contrôle situés sur le continent, à une centaine de kilomètres de là.
Un mec de la sécurité finit par l’alpaguer comme on attrape un voleur dans un supermarché :
— What the fuck are you doing here ?
Corso ne trouva pas de réponse.
Il avait l’esprit bloqué sur une seule évidence, incompréhensible : Philippe Sobieski avait disparu quelque part sous la Manche.
L’esthétique anglaise lui avait toujours fait penser à une décoration de Noël : avec ses devantures marquées de lettres dorées, ses cabines et ses bus rouges, ses poignées de porte cuivrées, ses « bobbies » avec leur drôle de bombe sur la tête, Londres recelait un parfum de féerie précieuse, un air de clochettes et de paquets-cadeaux déposés au pied du sapin.
Читать дальше