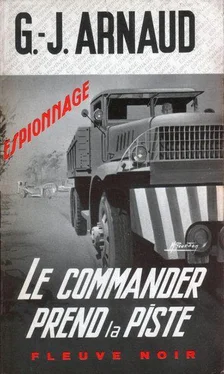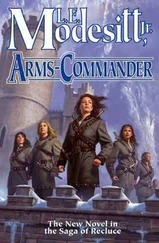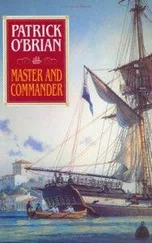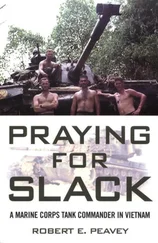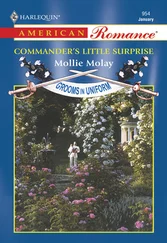Cette menace avait produit son effet. Carmina, soudain très pâle, les regarda avec angoisse.
— Mes amis savent que je suis entièrement dévoué à la cause.
— Bien sûr. Mais il y a l’argent, et n’importe qui agirait ainsi ; même le plus acharné des guérilleros. Ecoute, il y a certaines des choses que tu peux nous dire sans risques. A toi de choisir. Nous te remettrons ensuite à ton ambassade. Ils feront de toi ce qu’ils voudront, mais ça te laissera un sursis de plusieurs jours.
— Vous me condamnez encore plus durement.
— Mais tu finiras en beauté. La carte de la route secrète « Fidel Castro » ?
Carmina tiqua.
— Je ne l’ai pas. Je n’ai aucun document. Harvard avait pris ses précautions.
— A la N.G.S. où il travaillait, des documents du S.A.C. ont disparu. Il devait les avoir constamment sur lui.
— Je n’ai rien trouvé. D’ailleurs, si je l’avais su, j’aurais agi différemment.
C’était plausible, mais Kovask sentait que la capture de Carmina ne leur apporterait rien. En le torturant, en le faisant parler sous l’influence de drogues, on obtiendrait des renseignements sur le réseau castriste auquel il appartenait, mais c’était tout. Cela regardait beaucoup plus le F.B.I. et le Venezuela que l’O.N.I.…
— Ta mission est donc un échec ? La légation cubaine a bien reçu une carte, mais ce n’est qu’un exemplaire, pas l’original. Ce dernier, seul Harvard aurait pu dire où il se trouvait.
Il fit un signe à Marcus Clark.
— Appelle la maison. Qu’ils viennent le chercher et poursuivent l’interrogatoire. Nous allons chercher ailleurs.
Une demi-heure plus tard, une fourgonnette venait prendre livraison du diplomate. Kovask et Clark suivirent jusqu’à l’entrée de Washington, puis le Commander se dirigea vers la banlieue où habitait Harvard.
— On va essayer de trouver chez lui, mais j’en doute.
Le mouton frisé aux yeux éteints avait endossé une robe noire qui la boudinait de façon grotesque, mais elle sentait autant la bière et des miettes de pâtisserie étaient visibles sur son corsage.
— Encore vous ! On l’enterre demain. Je ne reçois personne.
— Vous ferez une exception pour nous.
Le bungalow était un peu plus en désordre, un peu plus sale. D’ici à un mois, il se transformerait en véritable taudis.
— La veille de sa mort, votre mari est revenu avec une grande enveloppe.
— Je ne sais pas. Je n’étais pas là.
— Vous ne sortez jamais.
Elle soupira.
— C’est possible.
— Il l’a cachée ici. Vous devez savoir où. Nous vous donnons cinq minutes pour nous la donner. Ensuite, nous vous arrêterons et vous serez mise au secret pour des semaines. Pas de bière ni de pâtisserie. Une belle cure d’amaigrissement.
Elle essaya de lui jeter un regard coléreux, mais l’eau de son regard resta glauque. Il n’y avait plus aucune ressource en elle, même pas celle de s’indigner.
— Vous n’avez pas le droit de me parler ainsi.
— Je le sais et je le regrette. Donnez-moi ces papiers.
— Ils n’y sont plus. Kovask et Marcus Clark se regardèrent.
— Où les avez-vous mis ?
— Sur le rebord de ma fenêtre. Je suis sortie et, au retour, il y avait un billet de cent dollars.
— Qui vous avait ordonné de vous comporter ainsi ?
— Une voix de femme au téléphone. Je n’avais rien à perdre. J’avais vu mon mari les placer dans ce qu’il croyait être son tiroir secret. Venez voir.
Le géographe avait fabriqué un fond à l’un des tiroirs de son bureau, ménageant un espace de deux centimètres susceptible de recevoir un beau paquet de documents.
— Il y mettait aussi son argent. Je le savais. De temps en temps, je venais prendre quelques dollars et il ne s’en rendait même pas compte. Il avait le goût des secrets. Depuis sa jeunesse.
— Qui vous a téléphoné ?
— Une femme. Elle avait l’accent espagnol. Après tout, cent dollars, c’était bon à prendre.
— Ça en valait trois cents fois plus, dit Marcus Clark avec rage.
Le mouton frisé le regarda sans réaction.
— Oh ! pour une telle somme, ça n’aurait pas été possible, mais pour cent dollars ! Après tout, je croyais qu’ils appartenaient à mon mari. Vous ne pouvez pas m’arrêter pour si peu.
Elle avait raison et ils la quittèrent sur-le-champ. Kovask embraya un peu sèchement, trahissant son mécontentement.
— A moins que Carmina ne connaisse une fille à l’accent espagnol, je ne vois pas comment on va s’en tirer…
— Et même si… Les documents doivent être loin à cette heure, conclut son ami.
Ils roulaient depuis le lever du jour à bord de ce G.M.C. bringuebalant qu’ils avaient payé deux mille dollars au Guatemala. Il avait fallu l’embarquer sur un cargo, payer son passage et le leur, discuter durant deux jours à Maracaïbo avec les douaniers et la police pour recevoir l’autorisation de débarquer.
— Que ? La Marginal ? Oui, on en a entendu parler, quelque part dans le Sud, dans la cordillère de Merida. Mais il n’y a pas encore de travaux. Juste des relevés topographiques… Le piquetage, quoi.
— Mais non, avait dit un autre policier. Il faut demander au service des communications routières. On construit des ponts et même un remblai de cinquante kilomètres du côté de San Cristobal.
Un policier soupçonneux fouillait dans les réservoirs avec une longue tige :
— Vous venez du Guatemala ? Vous auriez mieux fait d’y rester. Ici… Oh ! il y a du fret, mais c’est la grosse bagarre ! Les transporteurs italiens et allemands font la vie dure aux autres.
— Je suis allemand, avait dit Marcus Clark.
— Et moi, polonais, ajouta Kovask. Nous sommes deux, et pas prêts à nous laisser faire.
Ce qui avait fait hausser les épaules du policier :
— Ce que j’en dis… Ici, la tonne-kilomètre est de sept cents. Si vous croyez faire fortune avec ça… Mieux vaut avoir des mulets, car alors le prix monte à quatre-vingt-dix cents.
— Mais si la route marginale se construit… Ils ont besoin de camionneurs.
— Allez voir et tâchez de vous faire embaucher. Mais attention, señores, si vous ne voulez pas de difficultés avec nous autres, les policiers, refusez certain fret qu’on vous paiera aussi cher que s’il était transporté à dos de mulet.
— Merci de l’avertissement, riposta Kovask. De quoi s’agit-il ?
— Vous l’apprendrez bien sans moi.
Enfin, on les avait autorisés à poursuivre vers le sud. Ils avaient fait le plein d’essence, emporté des jerricans de secours, quelques provisions. La route transversale était bonne, encore qu’étroite. Il y avait énormément de trafic. Des camions de toutes les marques, mais le plus souvent dans un état épouvantable. Seuls quelques Fiat, quelques Dodge et des Nissan japonais appartenant à de grandes sociétés étaient de construction récente.
— On fonce dans le brouillard, répétait Marcus Clark cramponné à son volant, mais j’aime ça. Si jamais on ne réussit pas, le commodore saute. Tu penses que la C.I.A. voudra sa peau ! Dissimulation d’informations concernant l’Amérique du Sud, leur terrain de chasse. Tu verras qu’ils vont nous tomber sur le dos d’ici peu.
— Surveille ton thermomètre, pour l’instant, dit Kovask, s’escrimant sur un gros cigare noir qui tirait mal. Le reste viendra bien assez vite.
— Le fret à 90 cents ?
— Ça et le reste. Nous allons dans la zone la plus dangereuse du coin. Il se produira bien quelque chose.
— On passe la nuit à se taire masser les fesses ou on arrête ?
— Trouve une fonda pas trop moche.
Deux étages, une dizaine de fenêtres et le mot « Shell » éclaboussant de néon rouge quelques maisons tassées. Clark se rangea derrière une grosse citerne. Lorsqu’ils sautèrent à terre, leurs jambes tremblaient et ils chaloupèrent pour arriver jusqu’au bar encombré. Ils commandèrent deux bières dans le brouhaha indifférent. Tout le monde se connaissait et ils se trouvèrent mêlés à une conversation sans l’avoir voulu.
Читать дальше