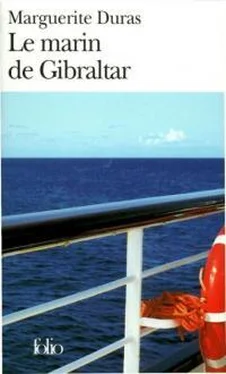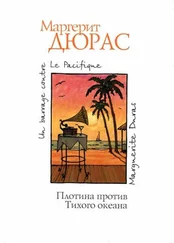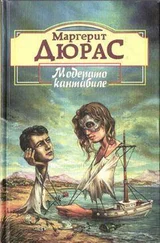— On ne peut pas s'imaginer quand on n'a jamais fait. On a peur la première fois et après on ne peut plus se passer. C'est très belles, les couleurs, les poissons ils passent sous le ventre. C'est calme, on ne peut pas s'imaginer.
Il me parla des bals populaires, des fruits — des citrons gros comme des oranges — de cette région.
On arriva à San Romano, dans la vallée de l'Arno. Le ciel était cuivré. Il n'y eut plus de soleil sur la route mais il y en eut encore pendant un moment sur le haut des collines. Elles étaient plantées d'oliviers depuis leur pied jusqu'à leur cime. Les maisons étaient belles, de la même couleur que la terre. Auprès de la moindre d'entre elles se dressaient des cyprès. C'était un paysage d'une écœurante douceur.
— Vous êtes de cette partie-ci de la Toscane ? lui demandai-je.
— De la vallée, oui, dit-il, mais pas de ce côté-ci de Florence. Mais la famille, maintenant, elle est à Rocca. Mon père, il aime la mer.
Le soleil disparut derrière les collines et la vallée tira sa lumière de l'Arno. C'était un petit fleuve. Sa surface brillante, calme, ses courbes douces et nombreuses, sa couleur verte, lui donnaient l'allure d'un animal ensommeillé. Vautré dans ses berges à pic, d'un accès difficile, il coulait avec bonheur.
— Comme il est beau l'Arno, dis-je.
Sans même s'en apercevoir il me tutoya.
— Et toi, me demanda-t-il, qu'est-ce que tu fais ?
— Ministère des Colonies, dis-je. Service de l'état civil.
— Ça te plaît, ce travail-là ?
— Terrible, dis-je.
— Qu'est-ce que tu fais ?
— Je recopie des actes de naissance et de décès.
— Je vois, dit-il. Tu y es depuis longtemps ?
— Huit ans.
— Moi, dit-il au bout d'un moment, je ne pourrais pas.
— Non, dis-je, tu ne pourrais pas.
— Pourtant, dit-il, être maçon, c'est dur, l'hiver tu as froid, l'été, tu as chaud. Mais quand même toujours recopier, je ne pourrais pas. Il y en a qui peuvent, il faut bien, mais moi, non, je ne pourrais pas.
— Moi, je ne peux pas, dis-je.
— Et pourtant tu le fais ?
— Je le fais. J'ai cru au début que j'allais en mourir mais pourtant je le fais, tu sais bien ce que c'est.
— Et maintenant tu crois encore ?
— Qu'on peut en mourir ? Oui, mais pour un autre, plus pour moi.
— Ça doit être terrible, toujours recopier, dit-il lentement.
— Tu ne peux pas t'imaginer, dis-je.
Je le dis sans doute avec l'accent de la plaisanterie. Et on aurait pu croire, ou que ça ne devait pas l'être tant que ça, ou que c'était une façon que j'avais de parler des choses de ma vie.
— C'est important, le travail qu'on fait, dit-il. Faire n'importe quoi, on ne peut pas.
— Pourtant il en faut bien, dis-je, pourquoi pas moi ?
— Non, dit-il, non, pourquoi toi ?
— J'ai essayé de faire autre chose, je n'ai jamais trouvé.
— Il y a des fois, dit-il, il vaut mieux crever de faim. Moi, à ta place, j'aimerais mieux crever de faim.
— Toujours cette peur d'être sans travail. Et puis aussi la honte, je ne sais pas.
— Quand même il y a des choses que c'est plus honteux de faire que de ne faire pas.
— J'aurais voulu être coureur cycliste, explorateur, des choses impossibles. Et finalement j'ai fini par entrer au ministère des Colonies. Mon père était fonctionnaire colonial, alors ça m'a été facile. La première année on n'y croit pas, on se dit que c'est une bonne blague, la seconde, on se dit que ça ne peut plus durer, puis la troisième arrive, puis voilà, tu sais bien…
Ça lui faisait plaisir que je me mette à parler.
— Pendant la guerre, continuais-je, j'ai été heureux. J'étais dans une compagnie de télégraphistes. J'ai appris à grimper aux poteaux, c'était dangereux, parce que j'aurais pu m'électrocuter, tomber, mais quand même j'étais heureux. Le dimanche je ne pouvais pas m'arrêter, je montais aux arbres.
On rit.
— Quand ça a été le moment de décamper, j'étais attaché en haut d'un poteau télégraphique. Les autres sont partis sans moi, mais dans le mauvais sens. Quand je suis descendu il n'y avait plus personne. J'ai décampé tout seul, mais dans le bon sens. J'ai eu de la veine.
Il rit de tout son cœur.
— Ah ! la guerre, quelquefois on rit à la guerre.
— Et après, demanda-t-il au bout d'un moment, pendant la résistance ?
— J'étais à Vichy avec le ministère.
Il se tut comme si cela demandait des explications supplémentaires.
— J'ai fait des faux actes d'état civil pour des Juifs qui se cachaient, surtout des actes de décès, forcément.
— Ah oui, je comprends. Et tu n'as jamais été ennuyé ?
— Jamais. Seulement, après la guerre, comme j'avais passé trois ans à Vichy, j'ai été rétrogradé.
— Et tes Juifs, ils ne pouvaient pas le dire que tu les avais aidés, non ?
— Je n'ai jamais pu en retrouver un seul, dis-je en riant.
— Quand même. Tu te laisses faire comme ça ?
Il me lorgna encore une fois. Il crut que je mentais.
— Je n'ai pas beaucoup cherché. Même si je n'avais pas été rétrogradé, je serais resté à l'État civil, alors…
— Quand même, dit-il encore.
Il ne me croyait pas.
— C'est vrai, dis-je — je lui souris —, je n'ai pas de raison de te mentir.
— Je te crois, dit-il enfin.
Je me mis à rire.
— D'habitude je mens beaucoup. Mais pas aujourd'hui. Il y a des jours comme ça.
— Tout le monde, il ment, dit-il après une hésitation.
— Je mens à tout le monde, à elle, à mes chefs de service. J'en ai pris l'habitude au bureau, parce que j'arrive souvent en retard. Comme je ne peux plus dire que mon travail me dégoûte, j'ai inventé une maladie de foie.
Il rit, mais pas de très bon cœur.
— Ça, dit-il, ce n'est pas mentir.
— Il faut bien parler de quelque chose, de temps en temps, c'est quand même parler de quelque chose. Mon foie, c'est la chose dont je parle le mieux, tous les jours je décris les tours qu'il me joue. Au ministère, au lieu de me dire bonjour, on me dit : « Et ce foie, comment va-t-il ? »
— Elle, elle croit ?
— Je ne sais pas, elle ne m'en parle pas.
Il réfléchit.
— Et la politique, tu la fais ?
— J'en ai fait quand j'étais étudiant.
— Et maintenant tu ne fais plus du tout ?
— J'en ai fait de moins en moins. Maintenant je n'en fais plus du tout.
— Communiste, tu étais ?
— Oui.
Il se tut. Longuement.
— J'ai commencé trop tôt, dis-je, la fatigue…
— Oh ! je comprends, dit-il doucement.
Il se tut encore, aussi longuement, et il dit tout à coup :
— Viens à Rocca pour le week-end.
L'État civil contenait toute ma vie et à côté de cette calamité, trois jours à Rocca, qu'est-ce que c'était ? Pourtant je compris ce qu'il voulait dire, que la vie était si dure parfois, et il le savait bien, qu'il fallait de temps en temps aller à Rocca pour comprendre qu'elle pouvait parfois l'être moins.
— Pourquoi pas ? dis-je.
— Je ne sais pourquoi, mais moi, j'aime Rocca, dit-il.
Nous arrivâmes à Empoli.
— Ici, dit-il, on fait la verrerie.
Je lui dis que je trouvais la ville belle. Il n'en parla pas, il pensait à autre chose, à moi je crois. Après Empoli, la chaleur diminua encore. On quitta l'Arno mais peu importait. J'étais content. Je ne perdais pas mon temps. Il me regarde, il m'écoute, je vois bien que j'en vaux des tas d'autres pour faire le voyage entre Pise et Florence. Je me défends. On peut m'avoir pour copain. Je n'avais pas l'habitude d'être content. Lorsque je l'étais, ça m'épuisait, j'en avais pour une semaine à me remettre. Les cuites me faisaient moins d'effet.
Читать дальше