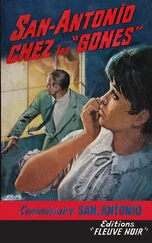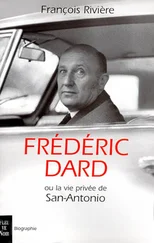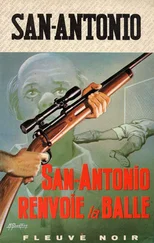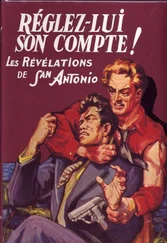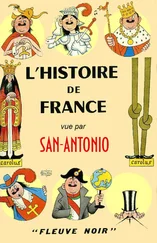San-Antonio
Béru contre San-Antonio
Affalé sur son bureau, les bras en arc de cercle, le chapeau en avant, Pinaud ressemble à un Martien timoré qui n’oserait pas sortir de sa capsule.
— Qu’est-ce qui lui prend ? demandavoixbassé-je à Béru, lequel contemple son coéquipier d’un œil lourd de compassion.
— Pinuche est en train de trépigner des cellules grises, révèle le Dodu ; figure-toi que cette vieille loque fait des mots écrasés pour un concoure dont à propos duquel le premier prix est une mobylette !
Sa Majesté rafistole sa cigarette éventrée avec le contour blanc d’un carnet de timbres, et grommelle :
— Je te demande un peu, une mobylette, à son âge ! Une supposition qu’il décrochasse le prelot, c’est la pneumonie double aussi sec pour Pépère ! Déjà, quand il passe entre deux mecs qui bâillent, il est obligé de se calorifuger l’horloge à la ouate Thermogène pour éviter les complications pulmonaires ! Tu t’imagines la Vieillesse sur deux-roues, à jouer les Fend-la-Bise ? Ah ! dis donc ! le lendemain, il glaviote ses éponges, recta.
— Pourrais-je avoir un peu de silence ? interroge la voix bêlante du mot-croiseur par-dessous le large rebord de son chapeau flétri.
Je m’approche de lui.
— Tu vas vers une distorsion du cervelet, Pinuchet, prophétisé-je.
Mon organe lui fait relever la tête. Il a les yeux gothiques, notre cher Détritus ; la prunelle rendue ogivale par l’effort cérébral.
— Oh ! c’est toi, se réjouit-il (et comme on le comprend !). Tu vas pouvoir me donner un petit coup de main, San-A.
— Tu sais, moi, les mots croisés, je ne suis pas médaillé olympique !
— C’est pas des mots croisés, c’est des charades.
— V’là autre chose ! ronchonne Béru, qui n’a jamais su et ne saura jamais ce qu’est une charade !
— Alors, je suis partant, dis-je à l’Emmitouflé de fraie. Annonce la couleur qu’on s’explique.
Il rallume l’extrémité de sa langue où adhère un souvenir de mégot, et lit :
— Mon premier est une perturbation atmosphérique. Je croie que c’est orage, qu’en penses-tu ?
— Ça me paraît valable ; ensuite ?
— Ensuite, ça se complique, lamente le Chétif. Paul Claudel a écrit mon deuxième au maréchal Pétain, puis au général de Gaulle.
— Ode ! dis-je sans hésiter, car j’ai une culture tellement vaste que j’envisage de faire appel à la main-d’œuvre étrangère au moment de la récolte.
Le Débris note ma réponse, de confiance, et poursuit :
— Mon troisième est un village haut perché de la Côte d’Azur, cher à Francis Blanche.
— Eze ! du tac-au-tac’je, très à l’aise. Il y en a encore ?
— Quand il écrivit mon quatrième, on ne pouvait pas prévoir qu’il deviendrait ministre de la République.
— Espoir !
Pinaud écrit, docilement.
— Mon tout est un vers fameux de Corneille, annonce-t-il enfin.
— Orage-Ode Eze-Espoir, résumé-je. O rage ! O désespoir !…
— On se demande où que tu vas chercher tout ça, bée Béru. Note bien, en ce qui me concerne moi-même, c’est pas que j’aie pas d’instruction, c’est que je m’en rappelle plus ! En attendant, c’est la mobylette à brève déchéance pour Pinaud ; tu peux déjà y acheter des peaux de matou et une bonbonne de sirop des Vosges !
« T’auras une lourde responsabilité dans sa prochaine congection pulmonaire, mec, il prophétise vigoureusement. »
Mais, tout de go, Alexandre-Benoît cesse de promettre des culpabilités sournoises et des refroidissements irrémédiables pour s’écrier :
— Maverdave ! J’oubliais de te honnir : y a le Décrêpé qui demande après toi. Ça fait quatre fois qu’y me turlute comme quoi faut que je te rabatte chez lui dès que t’arriveras. M’est avis qu’une affaire carabinée se mijote, gars, et je te parie que dans un peu moins de pas longtemps on va jouer Troïka sur la chaude piste blanche.
Abandonnant charades et copains, je me dirige vers le bureau du Vieux, en fonctionnaire conciencieux qui tient à justifier l’enveloppe que l’État lui remet à chaque fin de mois. Voilà plusieurs jours que ça mollassonne à la Grande Taule, et l’inaction me pèse. C’est toujours pareil, mes amis. Lorsque ça chicote trop, je prends la ferme résolution de démissionner pour monter une manufacture de layette, mais dès que le calme est revenu, il me semble que la vie bat de l’aile et que j’ai une activité aussi débordante que celle d’un photographe du Monde [1] Rappelons qu’aucune photo n’illustre jamais cet honorable quotidien. (Note de l’Éditeur.)
.
La porte matelassée du dabe est ouverte et je constate que son bureau est vide. Je m’y risque néanmoins afin d’y attendre le Big Boss. Un délicat parfum flotte dans la pièce. J’avise une magnifique corbeille de roses. Les fleurs ont l’air autant à leur place dans ce bureau qu’une photo des Beatles sur la table de travail du professeur Sauvy. Et pourtant, des roses, ça va partout, non ! Ici, elles ont l’air de souiller quelque chose, elles portent atteinte à la gravité inévitable du lieu.
J’attends, debout prés du fauteuil ou le Big Boss va me convier à m’asseoir. Avec cette indiscrétion qui fait mon charme, je file un coup de périscope sur le sous-main du Tondu, comme pour chercher les prémices de ce qui m’attend. Précisément, une photographie de format 18 x 24 est posée bien en évidence sur le buvard vert, vierge de toute tache d’encre.
Je me contorsionne le bol pour essayer de mater le portrait ! Je ne sais pas pourquoi, il me semble que je vais reconnaître le personnage qu’il représente. Comme je suis seul, je risque deux enjambées qui m’amènent de l’autre côté du burlingue sinistre. C’est drôlement téméraire, moi je vous le dis. Y a que le Vieux et sa femme de ménage qui se soient jamais hasardés jusqu’au fauteuil directorial. Je commets un crime de lèse-majesté, mes chéries. Du moins, me permet-il de reconnaître en effet le zig de la photo, il s’agit ni plus ni moins de Martial Vosgien, le leader politique. Un de ceux qui, depuis les événements d’Algérie, ont déclaré au régime une guerre sans merci. Il a été mis hors la loi, et il vit désormais en proscrit ; mais depuis l’étranger, il continue de manœuvrer ses troupes. À cause de sa haine avouée pour les hommes en place, il fomente des complots, et organise des attentats, bref, ses guerriers de l’ombre donnent bien du tintouin aux services de sécurité. Sur le cliché, il ne se ressemble plus beaucoup, Vosgien, et il faut un sagace de flic émérite pour le reconnaître. Il n’est plus brun, mais blond pâle, il s’est laissé pousser la moustache et porte des lunettes à monture d’écaille. Y a pas de problème, mes aminches : quand un homme veut modifier ces apparences, il change sa couleur de crins, se laisse pousser les baffies (ou se les fait raser) et met des lunettes s’il n’en portait pas. Marrant, mais ça rajeunit le bonhomme, ces bricolages. Martial Vosgien, là-dessus, on lui donne quarante berges à peine, alors qu’il doit en trimbaler une dizaine de plus. Son regard est moins aigu car les verres le voilent d’un reflet adoucissant et ses traits sont moins anguleux : il a dû s’empâter en exil. Les gens qui s’ennuient bouffent plus que les autres. Il a perdu son côté Bonaparte et ressemble plus à un homme d’affaires qu’à un condottiere.
— Vous l’avez reconnu ? demande la voix du Vieux.
Je tressaille comme s’il m’avait découvert avec l’œil au trou de la serrure pendant qu’il est aux toilettes.
Читать дальше