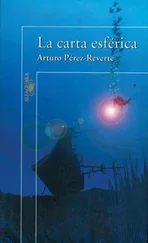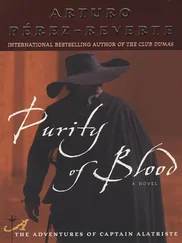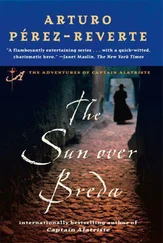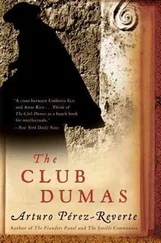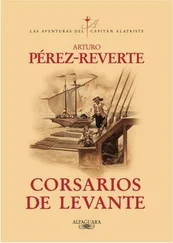J’étais sincère. Ce serait un tableau magnifique et le monde, peut-être, se souviendrait de notre malheureuse Espagne, embellie sur cette toile où il n’était pas difficile de deviner le souffle de l’immortalité, sorti de la palette du plus grand peintre de tous les temps. Mais la réalité, mes vrais souvenirs résidaient au second plan de la scène qui attirait irrésistiblement mon regard, derrière la composition centrale dont je me moquais bien : dans le vieux drapeau échiqueté d’azur et de blanc, porté sur l’épaule par un homme hirsute et moustachu qui aurait bien pu être l’enseigne Chacón, lui que je vis mourir alors qu’il essayait de le sauver sur la côte du réduit de Terheyden ; parmi les arquebusiers – Rivas, Llop et les autres qui ne rentrèrent jamais en Espagne ni ailleurs – tournant le dos à la scène principale, ou dans le buisson des piquiers disciplinés et anonymes auxquels je pouvais cependant donner le nom de camarades vivants et morts qui avaient parcouru l’Europe, au prix de leur sueur et de leur sang, pour que se vérifient ces vers écrits en leur honneur :
Et toujours sur le pied de guerre ils combattirent et furent grands, en Allemagne et chez Flamands, et en France et en Angleterre. Et la terre se prosterna toute tremblante sous leurs pas ; eux qui furent simples soldats, en si prodigieuse campagne, portèrent le soleil d’Espagne de l’Orient jusqu’au Couchant.
C’est à eux, Espagnols de langues et de terres différentes, mais solidaires dans l’ambition, la superbe et les souffrances, et pas à ces poseurs représentés au premier plan du tableau, que le Hollandais remettait sa maudite clé. À cette troupe sans nom ni visage que le peintre laissait seulement entrevoir sur le flanc d’une colline qui n’avait jamais existé ; j’avais, moi, à dix heures du matin, le cinq juin de l’an mille six cent vingt-cinq, alors que Philippe IV régnait sur l’Espagne, assisté à la reddition de Breda avec le capitaine Alatriste, Sebastián Copons, Curro Garrote et les autres survivants de son escouade décimée. Et, neuf ans plus tard, à Madrid, debout devant le tableau peint par Diego Velázquez, je crus entendre de nouveau le tambour pendant que je voyais avancer lentement, entre les forts et les tranchées ensevelis dans la fumée, au loin, devant Breda, les vieux escadrons impassibles, les piques et les drapeaux de celle qui fut la meilleure infanterie du monde : celle des Espagnols haïs, cruels, arrogants, disciplinés seulement à l’heure du combat. Eux qui supportaient tout, sauf qu’on leur parle de haut.
Fin du Tome 3