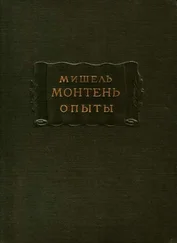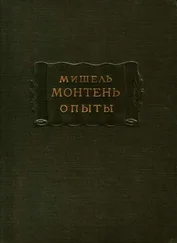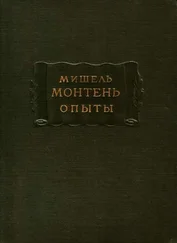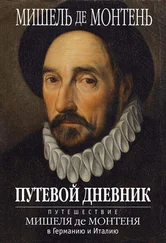Мишель Монтень - Les Essais - Livre II
Здесь есть возможность читать онлайн «Мишель Монтень - Les Essais - Livre II» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Старинная литература, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Les Essais - Livre II
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Les Essais - Livre II: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Les Essais - Livre II»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Les Essais - Livre II — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Les Essais - Livre II», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
89Pline Histoire naturelle XXII, 24, C.
90Tout le développement qui suit, jusqu'à la fin de ce chapitre, est un ajout manuscrit sur l'« exemplaire de Bordeaux », donc postérieur à 1588. Il est caractéristique de l'évolution des Essais vers la « peinture du Moi ».
91La formule est plaisante, qui montre bien les méfaits d'une position trop radicale... Aujourd'hui, on dirait peut-être : « On jette le bébé avec l'eau du bain » ?
92P. Villey croit devoir faire remarquer dans son Lexique que les « brides pour les veaux n'existent pas. ». Outre le fait qu'il ne devait pas souvent fréquenter les marchés aux bestiaux... et même s'il ne s'agissait pour Montaigne que d'une boutade à propos d'un lien imaginaire, l'acception actuelle (et populaire !) de « veaux » m'a semblé justifier amplement mon choix de conserver l'expression.
93Montaigne écrit « se jetter bien avant sur le trottoir » et « jeter sur le trottoir » est aujourd'hui équivoque. Mais il s'agissait bien sûr pour lui, homme de cheval, de l'endroit où l'on faisait trotter les chevaux pour en montrer la valeur. J'ai été tenté d'utiliser « plateau » — malgré l'anachronisme !
94Les voisins en question sont les Protestants, dont les confessions étaient publiques.
95Montaigne utilise ici le mot « skeletos », que Paré et Ronsard entre autres avaient déjà francisé en « squelette » à l'époque. Mais plutôt que d'un « squelette », Montaigne veut manifestement parler d'un corps destiné à l'étude anatomique, et c'est pourquoi j'ai utilisé « écorché ».
96Le texte (manuscrit) de l'« exemplaire de Bordeaux » comporte ici « ou pres de la » — et non « tout a fait ». Il peut donc s'agir d'une erreur faite par les éditeurs de 1595 — à moins qu'ils n'aient jugé que « tout à fait » s'accordait mieux avec le sens de la phrase ? Dans ma traduction, je combine un peu les deux versions.
97L'édition de 1595 a omis « Il peut estre», que l'on peut lire sur la partie manuscrite de l'« exemplaire de Bordeaux », malgré la rature qui se trouve à cet endroit. Je réintroduis donc cette petite phrase — qui a tout de même son importance — dans ma traduction.
98A. Lanly traduit ici : « qui se voient [seulement en second lieu] après leurs affaires ». Je ne partage pas son point de vue. « Après » peut fort bien signifier « d'après » en marquant une cause et non une succession temporelle. Du moins si j'en crois l'exemple donné (malheureusement sans référence !) par le Dictionnaire du Moyen Age et de la Renaissance de Greimas/Keane : « Après le naturel, d'après nature. » Je me risque donc à traduire « d'après la réussite de leurs affaires », car cela me semble plus convaincant, de toutes façons, dans le contexte ?
99« baissera la tête » par humilité, bien sûr. Mais...« l'expression est belle, il nous la faut choyer » !
100Selon P. Villey , ce chapitre aurait été écrit par Montaigne à l'occasion de « la création de l'Ordre du Saint-Esprit, destiné à remplacer l'Ordre de Saint-Michel, qui était tombé dans un grand discrédit. »
101Jules César, le vainqueur des Gaules.
102A l'origine, ces « ordres » avaient été créés pour lutter contre les « infidèles ». Devenus souvent trop puissants et/ou trop riches (Templiers), ils furent peu à peu réduits par la royauté et transformés en effet en ordres purement honorifiques.
103Cet ordre fut fondé en 1469 par Louis XI. Si l'on en croit Montluc, il avait encore tout son prestige sous Henri II vers 1550. Ce serait sous Charles IX que des abus (évoqués par Montaigne) lui auraient ôté sa réputation.
104Il me semble qu'il faut ainsi comprendre « ...le dancer, ...le parler... » Pour « le voltiger », il s'agit de figures exécutées à cheval, que Montaigne a déjà évoquées ailleurs.
105Cette phrase, déjà présente dans le texte de 1588, a été oubliée dans la traduction d'A. Lanly (II, 57).
106En latin, « virtus » est en effet de la même racine que « vis », la force. Cf. ma traduction, Livre I, XIX, §4. Cette étymologie (?) vient en fait de Cicéron : Tusculanes , II, 18.
107Madame d'Estissac est la mère de Charles d'Estissac qui accompagnera Montaigne dans son voyage en Italie. Elle était veuve depuis 1565 et avait une fille, Claude, qui épousa en 1587 le comte de La Rochefoucauld.
108D'après Montaigne lui-même, c'est en 1571 que, lassé de ses charges publiques, il avait décidé de se retirer dans sa « librairie ».
109Elle était probablement très jeune encore en effet, en 1565. On sait qu'elle se remaria d'ailleurs en 1580 (donc peu de temps après que Montaigne eut composé ce texte), avec Robert de Combaut, premier maître d'Hôtel d'Henri III.
110On est encore loin de « l'Homme-machine » ; ce n'est même pas encore Descartes, bien sûr. Mais Montaigne emploie bel et bien le mot « machine », qu'il faut certainement entendre ici au sens large de « construction, assemblage ». Traduire par « mécanique » comme le fait A. Lanly II, p. 60 me semble aller un peu loin.
111Comment rendre « actions toutes formées » ? Il m'a semblé que cette « forme » était celle de l'esprit et du raisonnement.
112Aristote Politiques VII, 16.
113Platon République V.
114Platon Lois VIII.
115La traduction d'A. Lanly a omis la deuxième partie de cette parenthèse qui figure pourtant bien dans le texte de 1580, déjà.
116Il s'agit de Jean d'Estissac, doyen de Saint Hilaire de 1542 à 1571, et qui mourut en 1576. Selon Jean Plattard Montaigne a pu le voir en effet en 1574, lorsqu'il se rendit au camp de Ste Hermine.
117Le Maréchal de Monluc, qui a écrit ses souvenirs, intitulés Commentaires est mort en 1577, et son fils en 1566.
118Note de l'édition P. Villey : « Ce terme de droit désigne une disposition par laquelle on appelle successivement un ou plusieurs héritiers à succéder pour que celui qu'on a institué le premier ne puisse pas aliéner les biens soumis à la substitution.[...] Il s'agit ici de substitution en faveur des mâles. Un commentateur a observé que Montaigne a cédé aux préoccupations dont il signale ici les exagérations : mû par le désir de perpétuer son nom, il a fait un testament par lequel il disposait de plus qu'il ne possédait, et institué le puîné de ses descendants héritier de sa terre et du nom, ce qui a donné lieu par suite du second mariage de sa fille Léonore, à un procès qui ne s'est terminé que deux siècles après. » (P. Villey II, Sources et annotations p. 041).
119Platon Lois XI.
120Il s'agit de la « Loi salique », c'est-à-dire celle des Francs Saliens, écrite selon la tradition d'abord sous le règne de Clovis, puis de Charlemagne. Elle excluait les femmes de la succession à la terre, et fut ensuite étendue à la couronne, sous les Valois. A l'époque où écrivait Montaigne, cette question était d'actualité, puisqu'on pensait que Henri III n'aurait pas d'enfants. P. Villey fait observer que Montaigne défend cette loi comme « raisonnable » et non comme historiquement fondée sur quelque texte ancien. (P. Villey II, Sources et annotations p. 041).
121Cette « fille » est toute spirituelle puisqu'il s'agit de son roman L'Histoire éthiopique qui a été traduit par Amyot.
122Il s'agit en fait de Cremutius Cordus, dont parle Tacite Annales , IV, 34.
123Saint Augustin avait bel et bien des enfants : ses « Confessions » nous l'apprennent ; Montaigne n'avait certainement pas lu cet ouvrage...
124Montaigne écrit : « mousquetaires » ; mais il ne s'agit pas de bretteurs gascons façon Dumas : ce sont les soldats porteurs de mousquets, ancêtres de nos fusils, et non de rapières. J'ai donc préféré parler de mousquetsplutôt que de mousquetaires...Montaigne écrit : « mousquetaires » ; mais il ne s'agit pas de bretteurs gascons façon Dumas : ce sont les soldats porteurs de mousquets, ancêtres de nos fusils, et non de rapières. J'ai donc préféré parler de mousquetsplutôt que de mousquetaires...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Les Essais - Livre II»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Les Essais - Livre II» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Les Essais - Livre II» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
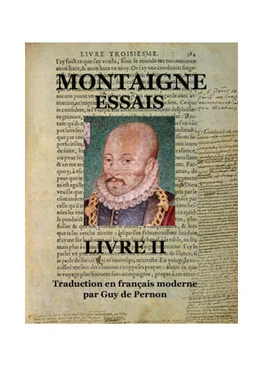

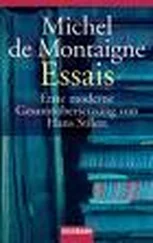
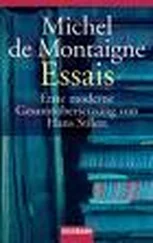
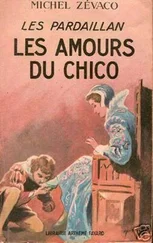
![Мишель Монтень - Путевой дневник. Путешествие Мишеля де Монтеня в Германию и Италию [litres]](/books/394936/mishel-monten-putevoj-dnevnik-puteshestvie-mishelya-thumb.webp)