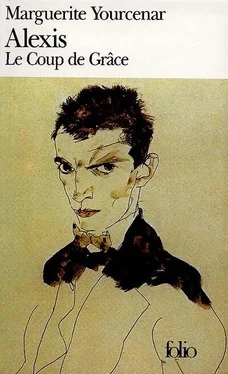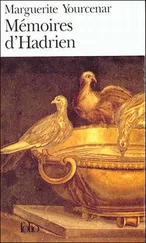Маргерит Юрсенар - Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce
Здесь есть возможность читать онлайн «Маргерит Юрсенар - Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2012, Издательство: Aelred - TAZ, Жанр: Старинная литература, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce
- Автор:
- Издательство:Aelred - TAZ
- Жанр:
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Vous aviez vingt-quatre ans. C’était, à peu près, l’âge de mes sœurs aînées. Mais vous n’étiez pas, comme elles, effacée ou timide : il y avait en vous une vitalité admirable. Vous n’étiez pas née pour une existence de petites peines ou de petits bonheurs ; vous étiez trop puissante. Jeune fille, vous vous étiez fait de votre vie d’épouse une idée très sévère et très grave, un idéal de tendresse plus affectueux qu’aimant. Et cependant, sans le savoir vous-même, dans l’enchaînement étroit de ces devoirs ennuyeux et souvent difficiles, qui devaient selon vous composer tout l’avenir, vous glissiez autre chose. L’usage ne permet pas aux femmes la passion : il leur permet seulement l’amour ; c’est pour cela peut-être quelles aiment si totalement. Je n’ose dire que vous étiez née pour une existence de plaisir ; il y a dans ce mot quelque chose de coupable, ou du moins d’interdit ; j’aime mieux dire, mon amie, que vous étiez née pour connaître et pour donner la joie. Il faudrait tâcher de redevenir assez purs pour comprendre toute l’innocence de la joie, cette forme ensoleillée du bonheur. Vous aviez cru qu’il suffisait de l’offrir pour l’obtenir en retour ; je n’affirme pas que vous étiez déçue : il faut beaucoup de temps pour qu’un sentiment, chez une femme, se transforme en pensée : vous étiez seulement triste.
Ainsi, je ne vous aimais pas. Vous aviez renoncé à me demander ce grand amour, que sans doute aucune femme ne m’inspirera jamais, puisqu’il ne m’est pas donné de l’éprouver pour vous. Mais cela, vous l’ignoriez. Vous étiez trop raisonnable pour ne pas vous résigner à cette vie sans issue, mais vous étiez trop saine pour ne pas en souffrir. La souffrance que l’on cause est celle dont on s’aperçoit la dernière ; et puis, vous la cachiez ; dans les premiers temps, je vous crus presque heureuse. Vous vous efforciez en quelque sorte de vous éteindre pour me plaire, vous portiez des vêtements sombres, épais, dissimulant votre beauté, parce que le moindre effort de parure m’effrayait (vous le compreniez déjà) comme une offre d’amour. Sans vous aimer, je m’étais pris pour vous de l’affection la plus inquiète ; une absence d’un moment m’attristait tout un jour, et l’on n’aurait pu savoir si je souffrais d’être éloigné de vous, ou si, tout simplement, j’avais peur d’être seul. Moi-même, je ne le savais pas. Et, puis, j’avais peur d’être ensemble, d’être seuls ensemble. Je vous entourais d’une atmosphère de tendresse énervante ; je vous demandais, vingt fois de suite, si vous teniez à moi ; je savais trop bien que c’était impossible.
Nous nous forcions aux pratiques d’une dévotion exaltée, qui ne correspondait plus à nos vraies croyances : ceux auxquels tout manque s’appuient sur Dieu et c’est à ce moment que Dieu leur manque aussi. Souvent, nous nous attardions dans ces vieilles églises accueillantes et sombres qu’on visite en voyage ; nous avions même pris l’habitude d’y prier. Nous revenions le soir, serrés l’un contre l’autre, unis du moins par une ferveur commune ; nous trouvions des prétextes pour rester dans la rue à regarder la vie des autres ; la vie des autres paraît toujours facile parce qu’on ne la vit pas. Nous savions trop bien que notre chambre nous attendait quelque part, une chambre de passage, froide, nue, vainement ouverte sur la tiédeur de ces nuits italiennes, une chambre sans solitude, et pourtant sans intimité. Car nous habitions la même chambre, c’est moi qui le voulais. Nous hésitions chaque soir à allumer la lampe ; sa lumière nous gênait, et cependant, nous n’osions plus l’éteindre. Vous me trouviez pâle ; vous ne l’étiez pas moins ; j’avais peur que vous n’eussiez pris froid ; vous me reprochiez doucement de m’être fatigué à des prières trop longues : nous étions l’un pour l’autre d’une désespérante bonté. Vous aviez à cette époque des insomnies intolérables ; j’avais, moi aussi, du mal à m’endormir ; nous simulions la présence du sommeil, pour n’être pas forcés de nous plaindre l’un l’autre. Ou bien, vous pleuriez. Vous pleuriez, le plus silencieusement possible, pour que je ne m’en aperçusse pas, et je feignais alors de ne pas vous entendre. Il vaut peut-être mieux ne pas s’apercevoir des larmes, lorsqu’on ne peut les consoler.
Mon caractère changeait : je devenais fantasque, difficile, irritable, il semblait qu’une vertu me dispensât des autres. Je vous en voulais de ne pas réussir à me donner ce calme, sur lequel j’avais compté, et que je ne demandais, mon Dieu, pas mieux que d’obtenir. J’avais pris l’habitude des demi-confidences ; je vous torturais d’aveux, d’autant plus inquiétants qu’ils étaient incomplets. Nous trouvions, dans les larmes, une sorte de satisfaction misérable : notre double détresse finissait par nous unir, autant que du bonheur. Vous aussi, vous vous transformiez. Il semblait que je vous eusse ravi votre sérénité d’autrefois, sans être parvenu à me l’approprier. Vous aviez, comme moi, des impatiences et des tristesses soudaines, impossibles à comprendre ; nous n’étions plus que deux malades s’appuyant l’un sur l’autre.
J’avais complètement abandonné la musique. La musique faisait partie d’un monde où je m’étais résigné à ne plus jamais vivre. On dit que la musique est l’univers de l’âme ; cela se peut, mon amie : cela prouve simplement que l’âme et la chair ne sont pas séparables, et que l’une contient l’autre, comme le clavier contient les sons. Le silence qui succède aux accords n’a rien des silences ordinaires : c’est un silence attentif ; c’est un silence vivant. Bien des choses insoupçonnées se murmurent en nous à la faveur de ce silence, et nous ne savons jamais ce que va nous dire une musique qui finit. Un tableau, une statue, voire même un poème, nous présentent des idées précises, qui d’ordinaire ne nous mènent pas plus loin, mais la musique nous parle de possibilités sans bornes. Il est dangereux de s’exposer aux émotions dans l’art, lorsqu’on a résolu de s’en abstenir dans la vie. Ainsi, je ne jouais plus et je ne composais plus. Je ne suis pas de ceux qui demandent à l’art la compensation du plaisir ; j’aime l’une et l’autre ; et non pas l’une pour l’autre, ces deux formes un peu tristes de tout désir humain. Je ne composais plus. Mon dégoût de la vie s’étendait lentement à ces rêves de la vie idéale, car un chef-d’œuvre, Monique, c’est de la vie rêvée. Il n’était pas jusqu’à la simple joie que cause à tout artiste l’achèvement d’un ouvrage, qui ne se fût desséchée, ou pour mieux dire, qui ne se fût congelée en moi. Cela tenait peut-être à ce que vous n’étiez pas musicienne : mon renoncement, ma fidélité n’eussent pas été complets, si je m’étais engagé, chaque soir, dans un monde d’harmonie où vous n’entriez pas. Je ne travaillais plus. J’étais pauvre : jusqu’à mon mariage, j’avais peiné pour vivre. Je trouvais maintenant une sorte de volupté à dépendre de vous, même de votre fortune : cette situation un peu humiliante était une garantie contre l’ancien péché. Nous avons tous, Monique, certains préjugés bien étranges : il est seulement cruel de trahir une femme qui nous aime, mais il serait odieux de tromper celle dont l’argent nous fait vivre. Et vous, si laborieuse, n’osiez blâmer tout haut mon inaction complète : vous craigniez que je ne visse dans vos paroles un reproche à ma pauvreté.
L’hiver, puis le printemps, passa ; nos excès de tristesse nous avaient épuisés ainsi qu’une grande débauche. Nous éprouvions cette sécheresse du cœur qui suit l’abus des larmes, et mon découragement ressemblait à du calme. J’étais presque effrayé de me sentir si calme ; je croyais m’être conquis. On est si prompt, hélas, à se dégoûter de ses conquêtes ! Nous accusions de notre accablement la fatigue des voyages : nous nous fixâmes à Vienne. J’éprouvais quelque répugnance à rentrer dans cette ville, où j’avais vécu seul, mais vous teniez, par une délicatesse de cœur, à ne pas m’éloigner de mon pays natal. Je m’efforçais de croire que j’allais être, à Vienne, moins malheureux que naguère ; j’étais surtout moins libre. Je vous laissai choisir les meubles et les tentures des chambres ; je vous regardais, avec un peu d’amertume, aller et venir dans ces pièces encore nues, où nos deux existences seraient emprisonnées. La société viennoise s’était éprise de votre beauté brune, et cependant pensive : la vie mondaine, dont ni l’un ni l’autre nous n’avions l’habitude, nous permit quelque temps d’oublier combien nous étions seuls. Puis, elle nous fatigua. Nous mettions une sorte de constance à supporter l’ennui dans cette maison trop neuve, où les objets pour nous étaient sans souvenir, et où les miroirs ne nous connaissaient pas. Mon effort de vertu, et votre tentative d’amour, n’aboutissaient même pas à nous distraire l’un l’autre.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.