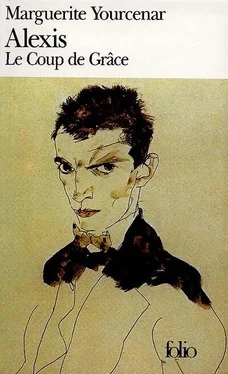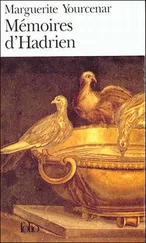Маргерит Юрсенар - Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce
Здесь есть возможность читать онлайн «Маргерит Юрсенар - Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2012, Издательство: Aelred - TAZ, Жанр: Старинная литература, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce
- Автор:
- Издательство:Aelred - TAZ
- Жанр:
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Je me disais qu’il serait vôtre, votre enfant, Monique, beaucoup plus que le mien. Il hériterait de vous, non seulement cette fortune, qui depuis si longtemps manquait à Woroïno (et la fortune, mon amie, ne donne pas le bonheur, mais le permet souvent) ; il hériterait aussi de vos beaux gestes calmes, de votre intelligence et de ce clair sourire qui nous accueille dans les tableaux français. Du moins, je le souhaite. Je m’étais, par un sentiment aveugle du devoir, rendu responsable de sa vie, qui courait quelque risque de n’être pas heureuse, puisqu’il était mon fils ; et ma seule excuse était de lui avoir donné une admirable mère. Et cependant, je me disais qu’il était un Géra, qu’il appartenait à cette famille où les gens se transmettent précieusement des pensées si anciennes qu’elles sont maintenant hors d’usage, comme les traîneaux dorés et les voitures de cour. Il descendait, comme moi, d’ancêtres de Pologne, de Podolie et de Bohême ; il aurait leurs passions, leurs découragements subits, leur goût pour les tristesses et les plaisirs bizarres, toutes leurs fatalités, auxquelles s’ajoutent les miennes. Car nous sommes d’une race bien étrange, où la folie et la mélancolie alternent de siècle en siècle, comme les yeux noirs et les yeux bleus. Daniel et moi, nous avons les yeux bleus. L’enfant dormait maintenant dans le berceau placé près du lit ; les lampes, posées sur la table, éclairaient confusément les choses, et les portraits de famille, que d’habitude on ne regarde plus à force de les voir, cessaient d’être une présence pour devenir une apparition. Ainsi, la volonté qu’exprimaient ces figures d’ancêtres s’était réalisée : notre mariage avait abouti à l’enfant. Par lui, cette vieille race se prolongerait dans l’avenir ; il importait peu, maintenant, que mon existence continuât : je n’intéressais plus les morts, et je pouvais disparaître à mon tour, mourir, ou bien recommencer à vivre.
La naissance de Daniel ne nous avait pas rapprochés : elle nous avait déçus, tout autant que l’amour. Nous n’avions pas repris notre existence commune ; j’avais cessé de me blottir contre vous, le soir, comme un enfant qui a peur des ténèbres, et l’on m’avait rendu la chambre où je dormais lorsque j’avais seize ans. Dans ce lit, où je retrouvais, avec mes rêves d’autrefois, le creux que jadis avait formé mon corps, j’avais la sensation de m’unir à moi-même. Mon amie, nous croyons à tort que la vie nous transforme : elle nous use et ce qu’elle use en nous, ce sont les choses apprises. Je n’avais pas changé ; seulement, les événements s’étaient interposés entre moi et ma propre nature ; j’étais ce que j’avais été, peut-être plus profondément qu’autrefois, car à mesure que tombent l’une après l’autre nos illusions et nos croyances, nous connaissons mieux notre être véritable. Tant d’efforts et de bonne volonté aboutissaient à me retrouver tel que j’étais jadis : une âme un peu trouble, mais que deux ans de vertu avaient désabusée. Monique, cela décourage. Il semblait aussi que ce long travail maternel, accompli en vous, ramenât votre nature à sa simplicité première : vous étiez, comme avant le mariage, un jeune être désireux du bonheur, mais seulement plus ferme, plus calme, et moins encombré d’âme. Votre beauté avait acquis une sorte de paisible abondance : c’était moi, maintenant, qui me savais malade, et m’en félicitais. Une pudeur m’empêchera toujours de vous dire combien de fois, durant ces mois d’été, j’ai désiré la mort ; et je ne veux pas savoir si, vous comparant à des femmes plus heureuses, vous m’en avez voulu de vous gâcher l’avenir. Nous nous aimions, pourtant, autant qu’on peut s’aimer sans passion l’un pour l’autre ; la belle saison (c’était la seconde depuis notre mariage) finissait, un peu hâtivement, comme font les belles saisons dans les pays du Nord ; nous achevions de goûter en silence cette fin d’un été et d’une tendresse, qui avaient porté leurs fruits et n’avaient plus qu’à mourir. Ce fut dans cette tristesse que la musique revint à moi.
Un soir, en septembre, le soir qui précéda notre retour à Vienne, je cédai à l’attirance du piano, qui jusqu’alors était resté fermé. J’étais seul dans le salon presque sombre ; c’était, je vous l’ai dit, mon dernier soir à Woroïno. Depuis de longues semaines, une inquiétude physique s’était glissée en moi, une fièvre, des insomnies, contre lesquelles je luttais et dont j’accusais l’automne. Il est des musiques fraîches où l’on se désaltère : du moins je le pensais. Je me mis à jouer. Je jouais ; je jouais d’abord avec précaution, doucement, délicatement comme si j’avais mon âme à endormir en moi. J’avais choisi les morceaux les plus calmes, de purs miroirs d’intelligence, Debussy ou Mozart, et l’on aurait pu dire, comme autrefois à Vienne, que je craignais la musique trouble. Mais mon âme, Monique, ne voulait pas dormir. Ou, peut-être, ce n’était même pas l’âme. Je jouais vaguement, laissant chaque note flotter sur du silence. C’était (je vous l’ai dit) mon dernier soir à Woroïno. Je savais que mes mains ne s’uniraient plus jamais à ces touches, que jamais plus cette chambre, grâce à moi, ne s’emplirait d’accords. J’interprétais mes souffrances physiques comme un présage funèbre : je m’étais résolu à me laisser mourir. Abandonnant mon âme au sommet des arpèges, comme un corps sur la vague quand la vague redescend, j’attendais que la musique me facilitât cette retombée prochaine vers le gouffre et l’oubli. Je jouais avec accablement. Je me disais que ma vie était à refaire et que rien ne guérit, pas même la guérison. Je me sentais trop las pour cette succession de rechutes et d’efforts, également épuisants, et cependant je jouissais déjà, dans la musique, de ma faiblesse et de mon abandon. Je n’étais plus capable, comme autrefois, d’éprouver du mépris pour la vie passionnée, dont pourtant j’avais peur. Mon âme s’était plus profondément enfoncée dans ma chair ; et ce que je regrettais, remontant, de pensées en pensées, d’accords en accords, vers mon passé le plus intime et le moins avoué, c’étaient, non pas mes fautes, mais les possibilités de joie que j’avais repoussées. Ce n’était pas d’avoir cédé trop souvent, c’était d’avoir trop longtemps et trop durement lutté.
Je jouais, désespérément. L’âme humaine est plus lente que nous : cela me fait admettre qu’elle pourrait être plus durable. Elle est toujours un peu en arrière de notre vie présente. Je commençais seulement à comprendre le sens de cette musique intérieure, de cette musique de joie et de désir sauvage, que j’avais étouffée en moi. J’avais réduit mon âme à une seule mélodie, plaintive et monotone ; j’avais fait de ma vie du silence, où ne devait monter qu’un psaume. Je n’ai pas assez de foi, mon amie, pour me borner aux psaumes ; et si je me repens, c’est de mon repentir. Les sons, Monique, se déploient dans le temps comme les formes dans l’espace, et, jusqu’à ce qu’une musique ait cessé, elle reste, en partie, plongée dans l’avenir. Il y a quelque chose d’émouvant, pour l’improvisateur, dans cette élection de la note qui va suivre. Je commençais à comprendre cette liberté de l’art et de la vie, qui n’obéissent qu’aux lois de leur développement propre. Le rythme suit la montée du trouble intérieur : cette auscultation est terrible, quand le cœur bat trop vite. Ce qui, maintenant, naissait de l’instrument où, pendant deux années, j’avais séquestré tout moi-même, ce n’était plus le chant du sacrifice, ce n’était même plus celui du désir, ni de la joie toute proche. C’était la haine ; la haine pour tout ce qui m’avait falsifié, écrasé si longtemps. Je pensais, avec une sorte de cruel plaisir, que de votre chambre vous m’entendiez jouer ; je me disais que cela suffisait comme aveu et comme explication.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.