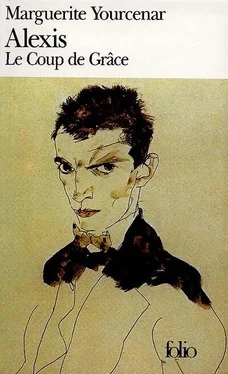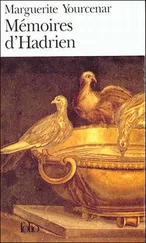Маргерит Юрсенар - Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce
Здесь есть возможность читать онлайн «Маргерит Юрсенар - Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2012, Издательство: Aelred - TAZ, Жанр: Старинная литература, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce
- Автор:
- Издательство:Aelred - TAZ
- Жанр:
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Je me rappelle mon entrée sur la scène, à mon premier concert. L’assistance était très peu nombreuse, mais c’était déjà trop pour moi. J’étouffais. Je n’aimais pas ce public pour qui l’art n’est qu’une vanité nécessaire, ces visages composés dissimulant les âmes, l’absence des âmes. Je concevais mal qu’on pût jouer devant des inconnus, à heure fixe, pour un salaire versé d’avance. Je devinais les appréciations toutes faites, qu’ils se croyaient obligés de formuler en sortant ; je haïssais leur goût pour l’emphase inutile, l’intérêt même qu’ils me portaient, parce que j’étais de leur monde, et l’éclat factice dont se paraient les femmes. Je préférais encore les auditeurs de concerts populaires, donnés le soir dans quelque salle misérable, où j’acceptais parfois de jouer gratuitement. Des gens venaient là dans l’espoir de s’instruire. Ils n’étaient pas plus intelligents que les autres, ils étaient seulement de meilleure volonté, ils avaient dû, après leur repas, s’habiller le mieux possible ; ils avaient dû consentir à avoir froid, pendant deux longues heures, dans une salle presque noire. Les gens qui vont au théâtre cherchent à s’oublier eux-mêmes ; ceux qui vont au concert cherchent plutôt à se retrouver. Entre la dispersion du jour et la dissolution du sommeil, ils se retrempent dans ce qu’ils sont. Visages fatigués des auditeurs du soir, visages qui se détendent dans leurs rêves et semblent s’y baigner. Mon visage... Et ne suis-je pas aussi très pauvre, moi qui n’ai ni amour, ni foi, ni désir avouable, moi qui n’ai que moi-même sur qui compter, et qui me suis presque toujours infidèle ?
L’hiver qui suivit fut un hiver pluvieux. Je pris froid. J’étais trop habitué à être un peu malade pour m’inquiéter quand je l’étais vraiment. J’avais, pendant l’année dont je vous parle, été repris par les troubles nerveux éprouvés dans l’enfance. Ce refroidissement, que je ne soignai pas, vint m’affaiblir davantage : je retombai malade, et cette fois très gravement.
Je compris alors le bonheur d’être seul. Si j’avais succombé, à cette époque, je n’aurais eu à regretter personne. C’était l’absolu détachement. Une lettre de mes frères vint justement m’apprendre que ma mère était morte, depuis un mois déjà. Je fus triste, surtout de ne pas l’avoir su plus tôt ; il semblait qu’on m’eût volé quelques semaines de douleur. J’étais seul. Le médecin du quartier, qu’on avait fini par appeler, cessa bientôt de venir, et mes voisins se fatiguèrent de me soigner. J’étais content ainsi. J’étais si tranquille que je n’éprouvais même pas le besoin de me résigner. Je regardais mon corps se débattre, étouffer, souffrir. Mon corps voulait vivre. Il y avait en lui une foi en la vie que j’admirais moi-même : je me repentais presque de l’avoir méprisé, découragé, cruellement puni. Quand j’allai mieux, quand je pus me soulever sur mon lit, mon esprit, encore faible, demeurait incapable de réflexions bien longues ; ce fut par l’entremise de mon corps que me parvinrent les premières joies. Je revois la beauté, presque sacrée, du pain, l’humble rayon de soleil où je réchauffai mon visage, et l’étourdissement que me causa la vie. Il vint un jour où je pus m’accouder à la fenêtre ouverte. Je n’habitais qu’une rue grise dans un faubourg de Vienne, mais il est des moments où il suffit d’un arbre, dépassant une muraille, pour nous rappeler que des forêts existent. J’eus, ce jour-là, par tout mon corps étonné de revivre, ma seconde révélation de la beauté du monde. Vous savez quelle fut la première. Comme à la première, je pleurai, non pas tant de bonheur, ni de reconnaissance ; je pleurai à l’idée que la vie fût si simple, et serait si facile si nous étions nous-mêmes assez simples pour l’accepter.
Ce que je reproche à la maladie, c’est de rendre le renoncement trop aisé. On se croit guéri du désir, mais la convalescence est une rechute, et l’on s’aperçoit, avec toujours la même stupeur, que la joie peut encore nous faire souffrir. Durant les mois qui suivirent, je crus pouvoir continuer à regarder la vie avec les yeux indifférents des malades. Je persistais à penser que, peut-être je n’en avais plus pour longtemps ; je me pardonnai mes fautes, comme Dieu, sans doute, nous pardonnera après la mort. Je ne me reprochais plus d’être ému à l’excès par la beauté humaine ; je voyais, dans ces légers tressaillements du cœur, une faiblesse de convalescent, le trouble excusable d’un corps redevenu, pour ainsi dire, nouveau devant la vie. Je repris mes leçons, mes concerts. Il le fallait, car ma maladie avait été très coûteuse. Presque personne n’avait songé à demander de mes nouvelles ; les gens chez lesquels j’enseignais ne s’aperçurent pas que j’étais encore très faible. Il ne faut pas leur en vouloir. Je n’étais pour eux qu’un jeune homme fort doux, apparemment fort raisonnable, dont les leçons n’étaient pas chères. C’était le seul point de vue dont ils m’envisageassent, et mon absence n’était pour eux qu’un contretemps. Dès que je fus capable d’une promenade un peu longue, j’allai chez la princesse Catherine.
Le prince et la princesse de Mainau passaient alors à Vienne, quelques mois chaque hiver. Je crains, mon amie, que leurs petits travers mondains nous aient empêchés d’apprécier ce qu’il y avait de rare dans ces gens d’autrefois. C’étaient les survivants d’un monde plus raisonnable que le nôtre parce qu’il était plus léger. Le prince et la princesse avaient cette affabilité facile qui suffit, dans les petites choses, à remplacer la vraie bonté. Nous étions un peu parents par les femmes ; la princesse se souvenait d’avoir été élevée, avec ma grand-mère maternelle, chez des chanoinesses allemandes. Elle aimait à rappeler cette intimité si lointaine, car elle était de ces femmes qui ne voient dans l’âge qu’une noblesse de plus. Peut-être, son unique coquetterie consistait à rajeunir son âme. La beauté de Catherine de Mainau n’était plus qu’un souvenir ; au lieu de miroirs, elle avait dans sa chambre ses portraits d’autrefois. Mais on savait qu’elle avait été belle. Elle avait, dit-on, inspiré des passions très vives ; elle en avait ressenti ; elle avait eu des peines, qu’elle n’avait pas longtemps portées. Il en était de ses chagrins, je suppose, comme de ses robes de bal, qu’elle ne mettait qu’une fois. Mais elle les gardait toutes ; elle avait, ainsi, des armoires de souvenirs. Vous disiez, mon amie, que la princesse Catherine avait une âme de dentelle.
J’allais assez rarement à ses soirées intimes, mais elle me recevait toujours bien. Elle n’avait pour moi, je le sentais, aucun attachement véritable, rien qu’une affection distraite de vieille dame indulgente. Et pourtant je l’aimais presque. J’aimais ses mains, un peu gonflées, que serrait l’anneau des bagues, ses yeux fatigués et son accent limpide. La princesse, comme ma mère, employait ce doux français fluide du siècle de Versailles, qui donne aux moindres mots la grâce attardée d’une langue morte. Je retrouvais chez elle, comme plus tard chez vous, un peu de mon parler natal. Elle faisait de son mieux pour me former au monde ; elle me prêtait les livres des poètes ; elle les choisissait tendres, superficiels et difficiles. La princesse de Mainau me croyait raisonnable ; c’était le seul défaut qu’elle ne pardonnait pas. Elle m’interrogeait, en riant, sur les jeunes femmes que je rencontrais chez elle ; elle s’étonnait que je ne m’éprisse d’aucune ; ces simples questions me mettaient au supplice. Naturellement, elle s’en apercevait : elle me trouvait timide et plus jeune que mon âge ; je lui savais gré de me juger ainsi. Il y a quelque chose de rassurant, lorsqu’on est malheureux et qu’on se croit très coupable, à être traité comme un enfant sans importance.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Alexis ou le Traité du Vain Combat - Le Coup de Grâce» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.