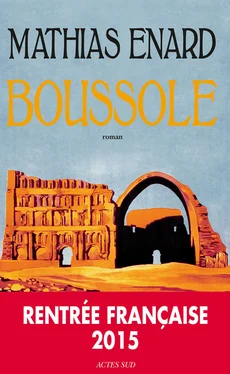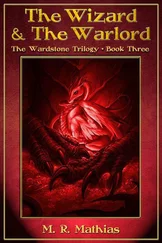Les grands discours de Bilger avaient quelque chose d’obscène : on aurait dit un militant écologiste drapé dans un manteau de renard doré ou d’hermine qui explique pourquoi et comment il faut préserver la vie animale, avec de grands gestes d’augure antique. Ce fut une soirée particulièrement arrosée et embarrassante, où tous les présents (jeunes chercheurs, petits diplomates) ressentirent une honte terrifiante, au milieu des canapés noirs et des néons verts, lorsque Bilger, l’élocution appesantie par l’alcool, debout au centre du demi-cercle de ses convives, se mit à déclamer ses dix commandements de l’archéologie, les raisons absolument objectives pour lesquelles il était le plus compétent des savants étrangers présents en Syrie et comment, grâce à lui, la science allait bondir vers l’avenir — le jeune Hassan, assis par terre à ses côtés, lui lançait des regards admiratifs ; le verre de whisky vide dans la main de Bilger, secoué par ses effets de manche, versait par moments quelques gouttes de glaçons fondus sur les cheveux bruns du Syrien, horrible baptême païen dont le jeune homme, perdu dans la contemplation du visage de son maître, concentré pour comprendre son anglais raffiné à la limite de la pédanterie, ne semblait pas s’apercevoir. J’ai raconté cette scène biblique à Sarah, qui n’y avait pas assisté, et elle ne m’a pas cru ; comme toujours elle pensait que j’exagérais et j’eus toutes les difficultés du monde à la convaincre que cet épisode avait bel et bien eu lieu.
Nous devons tout de même à Bilger de magnifiques expéditions au désert, et surtout une nuit dans une tente de Bédouins entre Palmyre et Rusafa, une nuit où le ciel est si pur et les étoiles si nombreuses qu’elles descendent jusqu’au sol, plus bas que le regard, une nuit comme seuls, j’imagine, les marins peuvent en voir, en été, quand la mer est aussi calme et sombre que la badiyé syrienne. Sarah était enchantée de pouvoir vivre, à quelques détails près, les aventures d’Annemarie Schwarzenbach ou de Marga d’Andurain soixante ans plus tôt dans le Levant du mandat français ; elle était là pour ça ; elle ressentait, me confiait-elle dans ce bar de l’hôtel Baron à Alep, ce qu’Annemarie écrivait au même endroit le 6 décembre 1933 à Klaus Mann :
Il m’arrive souvent, au cours de cet étrange voyage, à cause de la fatigue, ou lorsque j’ai beaucoup bu, que tout devienne flou : plus rien d’hier ; plus un seul visage n’est là. C’est une grande frayeur et, aussi, une tristesse.
Annemarie évoque ensuite la figure inflexible d’Erika Mann qui se tient au milieu de cette désolation et dont elle imagine que son frère sait le rôle qu’elle joue dans ce chagrin — elle n’a d’autre choix que de continuer son voyage, où irait-elle en Europe ? La famille Mann elle aussi va devoir commencer son exil, qui la mènera aux États-Unis en 1941 et sans doute, si elle avait pu se résoudre à fuir définitivement l’illusion suisse et l’emprise de sa mère, Annemarie Schwarzenbach n’aurait jamais eu ce stupide accident de vélo qui lui coûta la vie en 1942 et la fige à jamais dans la jeunesse, à l’âge de trente-quatre ans — elle en a vingt-cinq lors de ce premier voyage au Moyen-Orient, plus ou moins comme Sarah. Ce premier soir à Alep, après nous être installés au Baron et avoir fêté la découverte de la fiche d’arrivée d’Annemarie dans le registre de l’hôtel, nous sommes allés dîner à Jdaydé, faubourg chrétien de la vieille ville, où les demeures traditionnelles étaient petit à petit restaurées pour être transformées en hôtels et en restaurants luxueux — le plus ancien et le plus célèbre d’entre eux, au début d’une ruelle étroite donnant sur une petite place, s’appelait Sissi House, ce qui avait beaucoup fait rire Sarah, elle me disait “mon pauvre, tu es poursuivi par Vienne et Franz Josef, rien à faire” et avait insisté pour que nous y dînions : il faut avouer que, même si je ne suis pas ce qu’on peut appeler un sybarite ni un gourmet, le cadre, la nourriture et l’excellent vin libanais qu’on y servait (surtout la compagnie de Sarah, dont la beauté était mise en valeur par le cortile ottoman, les pierres, les tissus, les moucharabiehs de bois) ont ancré ce soir-là dans mon souvenir ; nous étions des princes, des princes d’Occident que l’Orient accueillait et traitait comme tels, avec raffinement, obséquiosité, suave langueur et cet ensemble, conforme à l’image que notre jeunesse avait construite du mythe oriental, nous donnait l’impression d’habiter enfin les terres perdues des Mille et Une Nuits , réapparues pour nous seuls : aucun étranger, dans ce début de printemps, pour en gâcher l’exclusivité ; nos commensaux étaient une riche famille alépine célébrant l’anniversaire d’un patriarche et dont les femmes, en bijoux, vêtues de chemises en dentelle blanches et de stricts gilets de laine noirs, souriaient sans cesse à Sarah.
Le houmous, le moutabbal ou les grillades nous paraissaient meilleurs qu’à Damas, transcendés, sublimés ; le soujouk était plus sauvage, la bastourma plus parfumée et le nectar de la Bekaa plus entêtant qu’à l’accoutumée.
Nous sommes rentrés à l’hôtel par le chemin des écoliers, dans la pénombre des ruelles et des bazars fermés — aujourd’hui tous ces lieux sont en proie à la guerre, brûlent ou ont brûlé, les rideaux de fer des boutiques déformés par la chaleur de l’incendie, la petite place de l’Évêché maronite envahie d’immeubles effondrés, son étonnante église latine à double clocher de tuiles rouges dévastée par les explosions : est-ce qu’Alep retrouvera jamais sa splendeur, peut-être, on n’en sait rien, mais aujourd’hui notre séjour est doublement un rêve, à la fois perdu dans le temps et rattrapé par la destruction. Un rêve avec Annemarie Schwarzenbach, T. E. Lawrence et tous les clients de l’hôtel Baron, les morts célèbres et les oubliés, que nous rejoignions au bar, sur les tabourets ronds à l’assise en cuir, devant les cendriers publicitaires, les deux bizarres cartouchières de chasseur ; un rêve de musique alépine, le chant, le luth, la cithare — il vaut mieux penser à autre chose, se retourner, s’endormir pour effacer, effacer le Baron, Alep, les obus, la guerre et Sarah, essayons plutôt, d’un mouvement d’oreiller, de la retrouver au Sarawak mystérieux, coincé entre la jungle de Bornéo et les pirates de la mer de Chine.
Dieu sait par quelle association j’ai maintenant cette mélodie dans la tête ; même les yeux fermés en essayant de respirer profondément il faut que le cerveau travaille, que ma boîte à musique intime se mette à jouer au moment le plus importun, est-ce que c’est un signe de folie, je l’ignore, je n’entends pas de voix, j’entends des orchestres, des luths, des chants ; ils m’encombrent les oreilles et la mémoire, se déclenchent tout seuls comme si, alors qu’une agitation s’éteint, une autre, comprimée sous la première, débordait la conscience — je sais qu’il s’agit d’une phrase du Désert de Félicien David, ou je crois le savoir, il me semble reconnaître ce vieux Félicien, premier grand musicien oriental, oublié comme tous ceux qui se sont consacrés corps et âme aux liens entre l’Est et l’Ouest, sans s’arrêter aux combats des ministres de la Guerre ou des Colonies, rarement joué aujourd’hui, peu enregistré et pourtant adulé par les compositeurs de son temps comme ayant brisé quelque chose , comme ayant fait naître un grondement neuf, une sonorité nouvelle , Félicien David natif du Sud de la France, du Vaucluse ou du Roussillon et mort (cela j’en suis sûr, c’est suffisamment idiot pour qu’on se le rappelle) à Saint-Germain-en-Laye, affreuse commune des environs de Paris qui s’organise autour d’un château rempli jusqu’aux meneaux de silex taillés et de pierrailles bien gauloises, Félicien David mort lui aussi de la tuberculose en 1876, un saint homme, parce que tous les saint-simoniens étaient des saints, des fous, des fous et des saints, comme Ismaÿl Urbain le premier Français algérien, ou premier Algérien de France, dont il serait temps que les Français se souviennent, le premier homme, premier orientaliste à avoir œuvré à une Algérie pour les Algériens dès les années 1860, contre les Maltais, les Siciliens, les Espagnols et les Marseillais qui formaient l’embryon des colons rampant dans les ornières tracées par les bottes des militaires : Ismaÿl Urbain avait l’oreille de Napoléon III et peu s’en fallut que le sort du monde arabe n’en fût changé, mais les politiciens français et anglais sont des couards retors qui se regardent surtout le fait-pipi dans la glace, et Ismaÿl Urbain l’ami d’Abd el-Kader mourut, et il n’y avait plus rien à faire, la politique de la France et de la Grande-Bretagne était prise de bêtise, engluée dans l’injustice, la violence et la veulerie.
Читать дальше