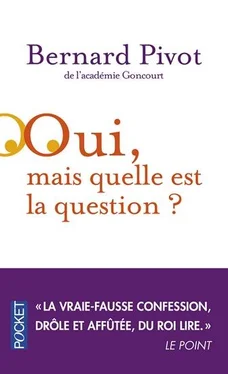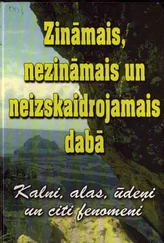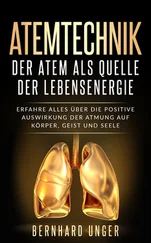Puisqu’on a le temps, comme au football, passer par les ailes. Élargir la perspective. Donner de l’air. Puis, centrer devant ou en retrait, reprendre de volée, décocher les questions au but qu’on a préparées et qui justifient le bien-fondé de l’interview. On peut ensuite soit, dans une stratégie offensive, continuer d’occuper le terrain dans sa partie la plus sensible, soit, telle une digression, repartir par les ailes pour redonner une certaine légèreté à l’entretien avant la dramaturgie finale.
Quant à l’interview de quelques minutes, elle ne peut être qu’une série de tirs au but.
À la radio et à la télévision, les silences sont coupés au montage. Dommage ! Parfois, ils en disent beaucoup. En direct, l’éloquence de certains silences.
Pourquoi ? Toujours « pourquoi » ? Le mot le plus utilisé dans les questions. On veut toujours savoir pourquoi. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi demain ? Pourquoi jamais ? Pourquoi ici ? Pourquoi pas là ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ? Pourquoi faut-il… ? Expliquez-nous pourquoi. Ça va du philosophique « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » au prosaïque « Pourquoi es-tu en retard ? »
Pourquoi le savoir ? Pour savoir pourquoi.
Dans les régimes autoritaires, les sociétés oppressives, les religions tyranniques, le mot pourquoi est si craint et haï qu’il est interdit. Les lanceurs de pourquoi sont des héros et des martyrs. Primo Levi raconte dans Si c’est un homme qu’à Auschwitz il demanda à un gardien pourquoi il lui interdisait de prendre dehors un glaçon pour étancher sa soif. « Warum ? — Hier ist kein warum » (Pourquoi ? — Ici il n’y a pas de pourquoi), répondit le SS.
On ne dit plus « plaît-il ? » quand l’on n’a pas entendu ou pas compris. « Quésaco ? » pour exprimer son étonnement ou sa méconnaissance est trop familier. « Quid ? » est désuet. J’emploie l’expression interrogative « c’est-à-dire ? » Elle va pour tout. Lorsque la réponse me paraît obscure, incomplète ou relevant de la langue de bois, je relance par un simple « c’est-à-dire ? » Lorsque, ça arrive, la réponse me surprend, me déstabilise et que je cherche à gagner du temps pour recouvrer la pleine maîtrise de la conversation, « c’est-à-dire ? » est une discrète bouée de sauvetage.
« Mais encore ? » n’est pas mal non plus.
Ou, tout simplement, « pardon ? »
D’un intervieweur la notoriété a fait de moi un interviewé. Je déteste ça. Je prête à mes confrères journalistes les ruses ou les audaces dont je sais user dans le même exercice. Leurs ficelles délient les miennes, mes questions sont banalisées par les leurs. De même que Groucho Marx refusait d’entrer dans un club qui se serait abaissé en l’admettant, je juge qu’être l’interviewé — et, à travers moi, tous les journalistes et animateurs de l’audiovisuel — retire du prestige à l’art de l’interview. Je suis invité en quelque sorte à déprécier mon métier. Modestie ou orgueil ? Ni l’une ni l’autre. Une juste appréciation de mes intérêts professionnels. Trop d’interviews tuent l’interview. Trop d’interviewés discréditent les interviewés. Et les intervieweurs.
Un jour, je fus invité à un débat télévisé sur le thème « Prêt-à-porter ou haute couture ? ». J’avais fait de longs entretiens avec les grands créateurs de mode : Givenchy, Saint Laurent, Ungaro, Lagerfeld, Lacroix, Galliano, etc. La productrice de l’émission avait jugé utile d’avoir mon témoignage. Dans un moment de faiblesse ou de vanité j’avais accepté. Je le regrettai dès que je fus assis sur le plateau du direct. Qu’est-ce que je foutais là, coincé entre la critique de mode du Figaro et le patron de Zara pour la France ? Mon boulot était de poser des questions, pas d’apporter des réponses. Je regardais avec envie le fauteuil de l’animateur. C’était là que je serais efficace et que j’aurais du plaisir, alors qu’à la place que j’occupais j’étais à contre-emploi. J’éprouvais le désagréable sentiment d’être un imposteur. Adam, pourquoi t’es-tu fourvoyé ?
À un certain moment, l’animateur me demanda quel était le créateur de mode qui m’avait le plus impressionné. Certain que j’allais dire des platitudes, me réfugier derrière des clichés — le prêt-à-porter de la conversation —, je répondis que mon opinion était sans importance, mais que, profitant de la présence de Karl Lagerfeld, je voulais lui demander pourquoi un homme de sa culture, de sa créativité, de sa stature, acceptait de se commettre parfois dans des émissions racoleuses ou ringardes.
La conversation s’étant longuement égarée, l’animateur éprouva bien des difficultés à la ramener sur les chiffons industriels et élitaires. Sitôt l’émission terminée, il fondit sur moi avec fureur. Je le priai de m’excuser. Contre le naturel, voyez-vous, cher confrère, on ne peut rien… Je ne fus pas réinvité. Tant mieux.
Je proposerai à Jean-Manuel T. d’intituler mon livre Oui, mais quelle est la question ? , et de mettre en épigraphe la célèbre boutade de Woody Allen : « La réponse est oui. Mais quelle était la question ? » Conjuguée chez lui à l’imparfait, sa question je la mettrai au présent. « Quelle était la question ? » ne relève plus que de l’histoire, alors que « quelle est la question ? » est intemporel. La question est toujours vivante, elle est ouverte, illimitée, énigmatique, prosaïque ou métaphysique, scientifique ou romanesque. Au présent, la question a l’avenir en elle.
S’ils répondaient plus souvent à mes questions, j’aimerais les chats.
Enfin, si, je les aime bien. Comment ne pas être conquis par leur gracieuse et insolente beauté ? Par leur égoïsme d’élus de la Fortune ? Même nés dans le ruisseau ce sont des aristocrates. Mais ils ne sont pas coopératifs. Toujours drapés dans leur fourrure et leur quant-à-soi. Affectueux, familiers, couchés en rond sous la couette ou sur nos genoux, et cependant distants par orgueil, retranchés derrière d’impénétrables méditations poursuivies de génération en génération.
Les chats de mes parents s’appelaient Lévi et Strauss. Les deux frères devaient leur nom à l’animalerie du Collège de France où ils étaient nés et d’où mon père les avait sauvés avant qu’ils ne servent de chair à labo. De leur nom et de leur évasion d’un destin cruel ils tiraient beaucoup de fierté. Lévi et Strauss ne se prenaient pas pour de la crotte. Jamais l’un sans l’autre. Pour manger, dormir, chasser, observer, écouter, réfléchir, toujours en duo. Ils avaient compris que Lévi sans Strauss et Strauss sans Lévi n’étaient rien, et que leur prestige tenait à leur identité complémentaire. Inséparables, ils sont morts le même jour, à quelques heures d’intervalle.
Plus de vingt ans après, lors de l’enregistrement chez lui d’une interview de Claude Lévi-Strauss — aimable, modeste, ouvert, tout le contraire des deux chats —, je n’ai pas osé lui raconter leur histoire. Il aurait pu croire que mon père avait distribué son double nom aux chats, non par admiration pour le professeur au Collège de France et l’auteur de Tristes tropiques , mais pour plaisanter, peut-être se moquer de lui.
Lévi et Strauss ne répondirent à aucune de mes questions d’étudiant-journaliste. Pas un ronronnement, pas un mouvement de paupières. Ils devaient se méfier de la presse. Ou considéraient-ils que je n’étais pas intellectuellement de leur niveau ? Chats anthropologues, félins des sciences humaines, m’auraient-ils snobé si j’avais été un futur psychanalyste ?
Читать дальше