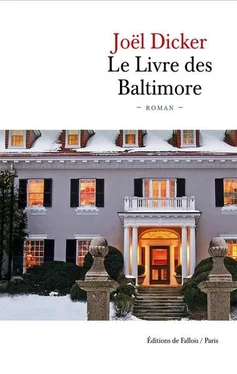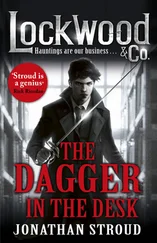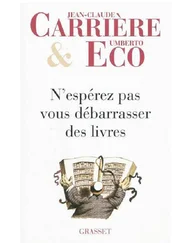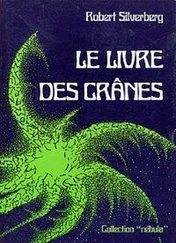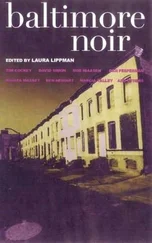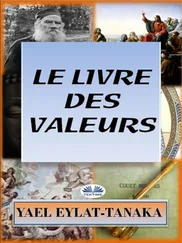Max Goldman est comblé : ses fils sont complémentaires. Ils ne sont pas rivaux : bien au contraire, chacun a son propre sens des affaires. Les soirs d'été, il aime se promener avec eux dans le quartier. Ils ne refusent jamais. Ils marchent, bavardent, et en chemin, ils s'assoient sur un banc. S'il est sûr que personne ne les voit, Max Goldman tend son paquet de cigarettes à ses fils. Il les traite comme des hommes. « Ne dites rien à votre mère. » Ils peuvent parfois rester sur le banc plus d'une heure : ils refont le monde et oublient le temps qui passe. Max Goldman parle du futur et il voit ses deux fils qui conquièrent le pays. Il passe ses bras autour de leurs épaules et leur dit : « Nous ouvrirons une succursale sur l'autre Côte, et des camions aux couleurs des Goldman traverseront le pays. »
Ce que Max Goldman ignore, c'est que ses deux fils lorsqu'ils en discutent ensemble, poussent les rêves encore plus loin : leur père veut ouvrir deux usines ? Ils en imaginent dix. Ils voient le monde en grand. Ils se voient vivre dans le même quartier, dans deux maisons proches, et les soirs d'été, se promener ensemble. Acheter ensemble une maison d'été au bord d'un lac, et y passer les vacances avec leurs familles respectives. Dans le quartier, on les appelle les frères Goldman. Ils n'ont qu'une année de différence, montrent le même goût pour l'excellence. Il est rare de voir l'un sans l'autre. Ils partagent tout et, le samedi soir, ils sortent ensemble. Ils vont à New York et hantent la Première Rue. On peut toujours les trouver chez Schmulka Bernstein, le premier restaurant chinois casher de New York. Debout sur les chaises, la tête couverte d'un chapeau chinois, ils y écrivent les plus belles pages de leur jeunesse et vivent leurs plus beaux exploits.
Des décennies ont passé. Tout a changé.
*
Vous ne retrouverez pas les bâtiments de l'entreprise familiale. Ou du moins pas tels qu'ils étaient. Une partie a été rasée et l'autre, restée à l'abandon, est devenue une ruine, depuis que le projet immobilier qui devait naître à leur place a été bloqué par une association de riverains. Goldman & Cie a été rachetée en 1985 par la firme technologique Hayendras.
Vous ne retrouverez pas non plus les lieux de leur jeunesse. Schmulka Bernstein n'existe plus. À la place, sur la Première Rue, il y a désormais un restaurant branché bobo qui sert d'excellents sandwichs au fromage grillé. La seule trace du passé est une vieille photo de ce qu'avait été cet endroit, accrochée près de l'entrée du restaurant. On y voit, debout sur des chaises, deux adolescents aux traits assez similaires, coiffés de chapeaux chinois.
Si Grand-mère Ruth ne m'en avait pas parlé, je n'aurais jamais pu imaginer que mon père et Oncle Saul avaient été un jour liés par une telle connivence. Les scènes dont j'avais été témoin, à Baltimore lors de Thanksgiving ou durant les vacances d'hiver en Floride, me semblaient à des années-lumière des récits de leur enfance. Tout ce que j'avais pu déceler entre eux n'avait été que leurs différences.
Je me souviens bien de nos sorties en famille à Miami. Mon père et Oncle Saul s'accordaient d'avance sur le restaurant où nous allions dîner, choisissant en général parmi une liste de quelques-uns qui se valaient et où nous aimions tous aller. A la fin du repas, malgré les protestations de Grand-père, l'addition était payée à parts égales par mon père et Oncle Saul, au nom d'une fraternité absolument symétrique. Mais parfois, environ une fois par saison, Oncle Saul nous emmenait dans un restaurant de meilleur standing. Il annonçait d'avance « je vous invite », ce qui indiquait à l'assemblée des Goldman, un peu impressionnée, que c'était un restaurant hors de portée du porte-monnaie de mes parents. En général, tout le monde était ravi : Hillel, Woody et moi nous réjouissions de découvrir un nouvel endroit. Grand-père et Grand-mère, eux, s'extasiaient devant tout, que ce soit la variété du menu, la beauté de la salière, la qualité de la vaisselle, le tissu des serviettes, le savon des toilettes ou la limpidité des urinoirs automatiques. Seuls mes parents se plaignaient. Avant de partir au restaurant, j'entendais ma mère pester : « Je n'ai rien à me mettre, je n'ai pas prévu de grandes tenues. On est en vacances, pas au cirque ! Enfin, Nathan, tu pourrais quand même dire quelque chose. » Après le dîner, en sortant du restaurant, mes parents restaient en arrière de la procession des Goldman, et ma mère déplorait la nourriture qui ne valait pas son prix et le service obséquieux.
Je ne comprenais pas pourquoi elle traitait Oncle Saul de la sorte, au lieu de reconnaître sa générosité. Une fois, j'entendis même ma mère utiliser à son encontre des termes particulièrement virulents. À cette époque, on parlait de licenciements dans la compagnie où travaillait mon père. Je n'en savais rien, mais mes parents avaient failli renoncer aux vacances en Floride pour mettre de l'argent de côté en cas de coup dur, avant de décider de les maintenir malgré tout. Dans ces moments-là, j'en voulais à Oncle Saul parce qu'il rendait mes parents petits. Il leur jetait le sort maudit de l'argent, qui les faisait rapetisser jusqu'à n'être que deux vermisseaux pleurnichards, qui devaient se déguiser pour sortir et se faire offrir une nourriture qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer. Je voyais également le regard débordant de fierté de mes grands-parents. Les jours qui suivaient ces sorties, j'entendais Grand-père Goldman raconter à qui voulait l'entendre combien son fils, le grand Saul, roi de la tribu des Baltimore, avait réussi dans la vie. « Ce restaurant, disait-il, si vous aviez vu ça ! Du vin français comme vous n'en avez jamais bu, de la viande qui fond dans la bouche. Le personnel aux petits soins ! Vous n'avez pas le temps de dire ouf que votre verre est à nouveau rempli. »
À Thanksgiving, Oncle Saul offrait des billets d'avion en première classe à mes grands-parents pour venir à Baltimore. Ils s'extasiaient du confort des sièges, de l'excellence du service à bord, des repas servis dans de la vaisselle et du fait qu'ils pouvaient embarquer avant tout le monde. « Embarquement prioritaire ! s'exclamait Grand-père, triomphant, en nous narrant ses exploits de voyageur. Et pas parce qu'on est vieux et impotents, mais parce que grâce à Saul on est des clients importants ! »
Toute ma vie, je vis mes grands-parents porter mon oncle en triomphe. Ses choix étaient perfection, et sa parole vérité. Je les vis aimer Tante Anita comme si elle était leur fille, je les vis vénérer les Baltimore. Comment imaginer qu'il y avait eu une période de douze ans pendant laquelle Grand-père et Oncle Saul ne s'étaient pas parlé !
Il me revient également en mémoire nos séjours familiaux en Floride avant la Buenavista, à l'époque où nous habitions tous dans l'appartement de mes grands-parents. Il était fréquent que nos avions atterrissent presque en même temps et que nous arrivions ensemble à l'appartement. Mes grands-parents, en nous ouvrant la porte, embrassaient toujours Oncle Saul en premier. Puis ils nous disaient : « Allez poser vos valises, mes chéris. Les enfants, on vous a installés dans le salon ; Nathan et Deborah, dans la pièce de la télévision. Saul et Anita, vous êtes dans la chambre d'amis. » Chaque année, ils annonçaient la répartition des lits comme s'il s'agissait d'une grande loterie, mais chaque année, c'était pareil : Oncle Saul et Tante Anita héritaient de la chambre d'amis tout confort, avec grand lit et salle de bains attenante, et mes parents étaient réduits au canapé-lit de la pièce étriquée dans laquelle mes grands-parents regardaient la télévision. Cette pièce présentait à mes yeux deux déshonneurs. D'abord, parce qu'elle avait été secrètement rebaptisée la « puanterie » par le Gang des Goldman, en raison de l'odeur rance qui y persistait (mes grands-parents n'y faisaient jamais fonctionner la climatisation). Chaque année en arrivant, Hillel et Woody, qui, eux, croyaient à un hasard authentique dans la loterie des lits, tremblaient à l'idée de devoir y dormir. Et au moment de l'annonce des lots par Grand-père, je les voyais se tenir la main et implorer le ciel en disant : « Pitié, pas la "puanterie" ! Pitié, pas la "puanterie" ! » Mais ce qu'ils ne comprirent jamais, c'est que la « puanterie » était le supplice de mes parents : c'était toujours eux qui étaient condamnés à y séjourner.
Читать дальше